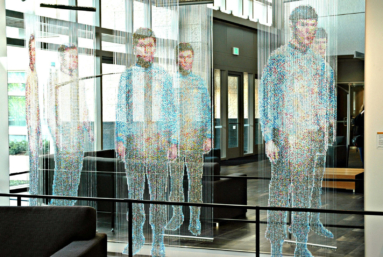Au Festival d’Avignon, le théâtre cherche sa langue
Dans le contexte politique incertain des dernières semaines, le Festival a manqué de langues fortes et singulières pour accompagner la pensée et nourrir l’espoir. Face à une majorité de créations revendiquant un fort ancrage au réel, de rares percées de l’imaginaire furent précieuses. Et non moins politiques.
dans l’hebdo N° 1818 Acheter ce numéro

© CLÉMENT MAHOUDEAU / AFP
Festival d’Avignon, Jusqu’au 21 juillet.
À défaut de grand bouleversement artistique, c’est la « Nuit d’Avignon » annoncée par le directeur du festival, Tiago Rodrigues, au lendemain des résultats du premier tour des élections législatives qui fit événement dans la cité papale entre le 30 juin et le 7 juillet, jour de soulagement. Au milieu de cette période d’attente, tendue pour le secteur du spectacle vivant, à qui l’arrivée au pouvoir du Rassemblement national fait alors craindre, comme à tous les autres acteurs du service public, des heures sombres, l’événement se veut « populaire ».
Sur les tracts réalisés en vitesse par l’équipe du festival et distribués à l’entrée de chaque pièce du In, la « Nuit » se présente comme un moment de lutte contre « l’inéluctabilité supposée de la victoire de l’extrême droite ». Fixée à minuit et demi, l’invitation est très largement honorée par les festivaliers. Ils remplissent entièrement les 2 000 places de la cour d’honneur du Palais des papes, dont la symbolique forte pour les arts et la culture a donné de l’ampleur à la manifestation en contribuant à sa bonne médiatisation. Les articles et émissions relatant cette soirée permirent en effet de la sortir quelque peu du cercle d’initiés où, en dépit des bonnes intentions d’ouverture affichées par le festival, elle s’est tenue.
Difficile ouverture
Composé d’interventions d’artistes, de personnes issues du secteur public, syndical, politique et associatif, le rendez-vous ne fut guère tout à fait l’agora populaire promise. Sans le QR code reçu sur inscription par mail, minces étaient les chances de pénétrer dans la fameuse enceinte. Les peurs, les colères exprimées par les paroles des uns, les morceaux ou encore les poèmes des autres ont témoigné à la fois d’une puissante solidarité interne et de l’ouverture compliquée à l’extérieur que nous évoquions la semaine dernière dans ces mêmes colonnes.
La pièce Hécube, pas Hécube, de Tiago Rodrigues, venait illustrer malgré elle cette double tendance. Bien en peine d’habiter l’immense arc cintré de pierre de la carrière de Boulbon, où ils semblent presque avoir été projetés par erreur, les acteurs de la troupe de la Comédie-Française – Elsa Lepoivre, Éric Génovèse, Denis Podalydès, Loïc Corbery, Gaël Kamilindi, Élissa Alloula et Séphora Pondi – y interprètent un tissage entre deux écritures : celles d’Euripide et de Tiago Rodrigues. Ce mélange produit hélas bien peu de sens.
La tragédie de l’héroïne éponyme d’Euripide, dont la quête de vengeance de ses enfants morts pendant la guerre de Troie nous est jouée par bribes désordonnées, ne gagne rien à être entrelacée au parcours de Nora (Elsa Lepoivre). Laquelle est une comédienne d’aujourd’hui dont les répétitions d’Hécube sont perturbées par la bataille qu’elle mène au nom de son fils autiste, maltraité par l’institution où il a été placé. Le statut de mère et la bataille qu’elles mènent au nom de leurs enfants ne suffisent pas à justifier le désir de Tiago Rodrigues de faire se superposer les histoires de ces femmes. Le cadre de la répétition théâtrale choisi par l’auteur et metteur en scène comme point d’union entre Nora et Hécube est, à l’image de cette rencontre manquée, artificiel.
Gagnons la bataille des mots et demain, après-demain, nous pourrons gagner la guerre des idées.
C. Viktorovitch
Menée tambour battant, l’alternance de moments de travail théâtral et de discussions juridiques est trop systématique pour donner vraiment corps aux questions multiples que brasse le spectacle, d’ordre aussi bien théâtral que politique, éthique et social. Lieu d’hésitation, d’instabilité constante, la langue du spectacle n’aide pas. Hécube, pas Hécube est en cela au diapason de cette 78e édition du Festival d’Avignon, où les écritures fortes se font rares. Or, durant la « Nuit », le politologue, auteur et chroniqueur Clément Viktorovitch alertait : « Nous devons être plus que jamais attentifs au langage, gagnons la bataille des mots et demain, après-demain, nous pourrons gagner la guerre des idées. »
Timides apparitions
Les classiques, réserves inépuisables de récits et de styles, ne firent cette année à Avignon que quelques timides apparitions. Outre Tiago Rodrigues et la Péruvienne Chela De Ferrari, qui monte La Mouette de Tchekhov, Gwenaël Morin met en scène une adaptation des plus fines et réjouissantes. Il ose Quichotte, d’après le célèbre roman de Miguel de Cervantès. Connu pour les aventures hors normes qu’il a menées – notamment en résidence aux Laboratoires d’Aubervilliers puis au Théâtre du Point du Jour à Lyon – avec son Théâtre permanent, où jeu, répétitions et transmission étaient des activités continues et ouvertes à tous, l’artiste réalise cette nouvelle pièce dans un cadre un peu particulier. Ce qui lui convient très bien.
Invité par le festival à venir créer chaque année une pièce à partir du répertoire dans un même lieu, le charmant jardin de la rue de Mons à la Maison Jean-Vilar, il y poursuit le double travail qu’il mène de longue date sur les classiques et le territoire, qu’il habite pleinement et avec grâce. Le rapport qu’il entretient avec le monde et la langue de Cervantès diffère profondément du traitement d’Euripide décrit plus tôt. Morin se fond dans la logique du roman au point de réussir à la faire adopter par un trio de comédiens pleins de dispositions pour pareil fol et audacieux exercice.
Jouant respectivement les rôles de Don Quichotte, du narrateur et de Sancho Panza, ainsi que de plusieurs personnages secondaires, Jeanne Balibar, Marie-Noëlle et Thierry Dupont, accompagnés par Léo Martin, aident avec leurs outils à eux le chevalier à la triste figure dans son entreprise de transformation du monde. Après une introduction fidèle à la traduction de Jean-Raymond Fanlo, ils se coulent avec un naturel délicieux dans le style de Cervantès et semblent inventer devant nous leurs trouvailles à base de carton et d’objets du quotidien.
Cette apparente simplicité qui cache un geste d’une grande précision et d’une grande exigence nous offre un accès direct à ce que cherche la joyeuse bande orchestrée par Gwenaël Morin. Soit un théâtre si proche du réel que les métamorphoses qui y prennent corps peuvent être vues comme des coups d’essai de divers combats. Chacun son moulin à vent, même si à Avignon beaucoup avaient le même au moment où se jouait le spectacle : le RN. Cette façon qu’a Quichotte d’appréhender le politique, de biais, est plus riche que bien des démarches plus frontales dont le festival n’a pas manqué. Ces dernières s’y sont manifestées sous différentes formes, tantôt très documentaires, tantôt inspirées du modèle feuilletonnesque.
Au nombre des premières, on peut citer Los Días Afuera, de l’Argentine Lola Arias, qui met platement en scène un groupe de femmes cisgenres et de personnes transgenres sorties de prison. La rencontre avec ces ex-détenues est rendue impossible par la quasi-absence de geste théâtral. Faute d’un cadre précis, elles s’exposent avec une superficialité qui conforte les idées reçues plutôt que de les contrer. Parmi les spectacles de facture plus fictionnelle qui revendiquent eux aussi une portée politique, il y a par exemple Lieux communs, de Baptiste Amann, déjà venu au Festival d’Avignon en 2021 avec sa trilogie Des territoires.
Thriller confus
Autour d’un meurtre, cet auteur et metteur en scène développe ici un thriller confus où les questions du patriarcat, des violences faites aux femmes et celle de la représentation de ces sujets en art se mêlent vainement. Avec Lacrima, Caroline Guiela Nguyen fait preuve de beaucoup plus de talent dans ce même registre théâtral dont elle a fait sa spécialité depuis Saïgon, qu’elle créait en 2019 au Festival d’Avignon. On y assiste à la confection de la robe de mariée d’une certaine « princesse d’Angleterre » dans trois ateliers : à Paris pour la couture, à Alençon pour la dentelle et en Inde pour la broderie.
La découverte de ces métiers et de celles et ceux qui les exercent est passionnante ; on aurait aimé qu’elle soit davantage approfondie, au profit des histoires de violences intimes ajoutées à la trame. La richesse de la structure a tendance à affaiblir les parties qui l’habitent, ainsi que la langue, sans laquelle une pensée complexe a ici encore du mal à s’épanouir.
Pour aller plus loin…

« Memory of Mankind », l’archive en actes

« n degrés de liberté » : sept acteurs font cause commune

Gisèle Halimi, écho et ferveur d’un combat