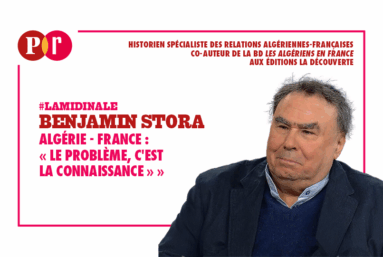Des certifications au rabais
L’Union européenne et des institutions internationales tentent d’imposer des critères environnementaux aux agrocarburants. Mais, selon Nina Holland, du Corporate Europe Observatory, à Amsterdam, ils ignorent les droits des populations des pays du Sud.
dans l’hebdo N° 954 Acheter ce numéro
Peut-on se féliciter du fait que l’Union européenne exige une garantie de « durabilité » pour les agrocarburants ? Ceux-ci bénéficieront de financements publics importants, ils sont supposés contribuer à la lutte contre le changement climatique, et une telle volonté contraste avec l’absence d’exigences similaires concernant, par exemple, les cultures destinées à l’alimentation humaine, animale ou à la pâte à papier. Mais on doit se demander quels critères pourraient garantir cette fameuse durabilité des agrocarburants~: d’énormes intérêts économiques sont en jeu, et leur image «~verte~» ne doit pas être bradée.
Trois pays de l’Union, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et l’Allemagne, tentent de définir leurs propres critères. Des institutions internationales, comme Global Bioenergy Partnership (une initiative du G8) et Round Table on Sustainable Biofuels (avec le WWF, World Economic Forum, les principales compagnies pétrolières, les gouvernements néerlandais et suisse), y travaillent aussi.
Hélas, tous ont omis d’impliquer les ONG du Sud. Ainsi, le travail de la Commission Cramer, aux Pays-Bas, a été vivement critiqué par Global Forest, World Rainforest Movement et d’autres pour « n’avoir pas consulté les organisations de la société civile du Sud, où la plupart des agrocarburants seront produits. Les préoccupations des petits producteurs, des communautés locales et des peuples indigènes, principales victimes des conséquences de l’expansion des monocultures, n’ont pas été prises en compte, ce qui a empêché une analyse solide des problèmes sociaux et environnementaux liés à la monoculture ». En particulier, les indicateurs ainsi obtenus ne résolvent pas les problèmes graves engendrés par les déplacements de populations. Le rapport Cramer se contente de confier au gouvernement néerlandais la responsabilité d’exercer son influence sur les pays producteurs si les problèmes sociaux y sont trop importants…
Ces méthodes de certification sont inspirées de celles des organismes mis en place par l’industrie Table ronde pour l’huile de palme soutenable (RSPO) ou Table ronde pour le soja responsable (RTRS) , qui ont pourtant échoué dans l’implication des acteurs locaux. Ces systèmes de certification sont, en effet, très difficiles à élaborer, tant les conflits d’intérêts entre populations locales, propriétaires de plantations et agro-industrie sont considérables, et tant est écrasante la différence de pouvoir entre les acteurs.
De nombreuses organisations locales ont ainsi décidé de ne pas prendre part à la RSPO, perçue comme incapable d’empêcher l’expansion des plantations de palmiers à huile. Quant à la RTRS, aux enjeux similaires, elle a été rejetée par la société civile paraguayenne tout entière. Mouvements d’agriculteurs, syndicats et ONG ont déclaré~: « Qui va prendre la responsabilité de la pollution environnementale causée par les quelque 20 millions de litres de produits chimiques largués sur le Paraguay~? La destruction des ruisseaux, des rivières, des sources et des marécages~? L’éviction de la plupart des 100 000 petits fermiers paraguayens de leurs maisons et de leurs champs~? L’assassinat de plus de 100 leaders paysans~? Le déplacement forcé et l’ethnocide des peuples et communautés indigènes~? Les charges pesant sur plus de 2 000 petits fermiers pour leur résistance légitime à ce système prédateur~? Les monocultures de soja à large échelle ne sont pas possibles sans une litanie d’impacts négatifs. »
En Colombie, pays qui affiche le pire des bilans en matière de droits de l’homme, des producteurs d’huile de palme ont plus d’une douzaine d’étiquettes «~vertes~» et «~éco~». Ce qui rend la bataille encore plus difficile, puisque les consommateurs du Nord sont convaincus d’acheter un produit «~propre~».
Malgré son discours sur la durabilité des agrocarburants, destiné à leur attribuer des aides fiscales, l’Union européenne ne demande qu’un bon bilan CO2 et une absence d’impact sur « les secteurs à haute valeur écologique » . Aucun critère social, économique ou spécifiquement lié aux droits de l’homme n’est exigé puisqu’il ne serait pas «~compatible avec les règles de l’OMC » . C’est un choix peu courageux, qui reporte sur l’Organisation internationale du travail (OIT) la responsabilité de s’opposer aux violations des droits des employés.
Les ONG sont donc fortement mobilisées contre ces critères scandaleusement peu exigeants, et contre la démarche des acteurs du Nord qui les développent sur le dos de populations du Sud en proie aux conséquences dramatiques de l’expansion des agrocarburants.
Pour aller plus loin…

« La LGV Lyon-Turin est la quintessence du déni de démocratie »

Justice climatique : quatorze citoyens en colère

« Que l’État joue enfin son rôle avec un vrai plan d’adaptation climatique »