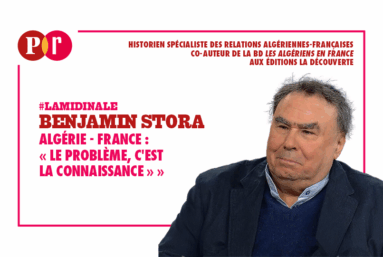Des impacts alarmants
Sous leurs verts atours, les agrocarburants ont rapidement endossé tous les travers des cultures de rente, au détriment des paysans du Sud. Témoignage du député Vert Alain Lipietz, après un voyage en Colombie.
dans l’hebdo N° 954 Acheter ce numéro
Lors d’une récente visite en Colombie, comme président de la délégation pour la Communauté andine, j’ai reçu les confidences alarmées de l’Église : dans l’immense plaine bananière du nord-ouest, où les paramilitaires ont massacré toute résistance, les communautés paysannes qui reviennent sur les terres dont elles ont été chassées par la guerre civile les retrouvent occupées par des plantations de palmier à huile ! Gardées par les paramilitaires, devenus gens respectables depuis leur quasi-amnistie par la loi « Justice et paix ». Cette brutale invasion répondait, me disait-on, à un plan précis : étancher par la production d’un agrocarburant la soif inextinguible des automobiles nord-américaines.
Une plantation de palmiers à huile. Cette culture se fait au détriment de la production vivrière et menace la biodiversité. DR
L’Union européenne, de son côté, s’est fixé l’objectif de couvrir, d’ici à 2010, 5,75 % de sa consommation automobile par des agrocarburants. Une proposition de la Commission avance même le chiffre de 20 % à l’horizon 2020. Débattue en janvier dernier au Parlement européen, cette proposition a été largement approuvée. Mais contre l’avis des Verts, car un de leurs amendements, stipulant que les cultures d’agrocarburants ne feraient concurrence ni à la production d’aliments ni à la préservation des forêts primitives, a été rejeté par les autres partis !
Voici donc cette ancienne proposition des Verts valoriser la biomasse pour produire de l’énergie adoptée à contre-emploi : une nouvelle percée du productivisme, pour échapper à l’étau du « triangle des risques énergétiques ». À savoir : les risques des hydrocarbures fossiles (effet de serre, pollutions locales), les risques du nucléaire (Tchernobyl, déchets radioactifs, prolifération militaire ou terroriste), et la compétition pour l’usage du sol (nourriture, préservation de la biodiversité, production d’agrocarburants).
Certes, le remplacement d’hydrocarbures fossiles par des carburants d’origine végétale peut contribuer au respect du protocole de Kyoto… à condition, toutefois, que la quantité de pétrole consommée pour faire pousser et transporter cette biomasse soit nettement inférieure à celle que remplace l’agrocarburant. C’est, hélas, loin d’être acquis, mais c’est une autre histoire. Les impacts socio-économiques sont déjà suffisamment alarmants, en particulier sur les trois points suivants.
Le ravage des monoproductions de rente. Le palmier à huile est un nouvel exemple de ces cultures de rente (canne à sucre, hévéa, café, coton, etc.) qui se succèdent depuis l’époque coloniale dans les pays tropicaux. Pour les jeunes nations qui veulent se « développer » en achetant des machines et des produits finis dans le monde industrialisé, il est légitime de miser sur de telles cultures. Tous les altermondialistes tempêtent ainsi contre les subventions versées par les États-Unis à leurs producteurs de coton, qui empêchent les paysanneries africaines de gagner quelques sous avec le coton qu’ils cultivent pour l’exportation. Le problème commence quand ces cultures tournent aux monoproductions, et s’aggrave quand elles concurrencent la production vivrière ou la préservation de la biodiversité.
La concurrence aux cultures vivrières. Cultiver des plantes à agrocarburants dans le tiers monde est d’autant plus choquant qu’il s’agit de dispenser d’effort un monde industriel glouton, au détriment des besoins de base des populations pauvres. Ainsi, à la fin de la dictature brésilienne, quand fut lancé le premier Plan pro-alcool, la canne à sucre du Nordeste a envahi les microfundia où les ouvriers des plantations cultivaient leurs productions vivrières. Chaque voiture de São Paulo privait de terres quatre familles du Nordeste. Aujourd’hui, tout le maïs des États-Unis, converti en éthanol, ne satisferait que 17 % de la consommation des automobiles du pays, qui se tourne désormais vers l’Amérique du Sud. D’ores et déjà, la demande de terre à maïs pour l’automobile a augmenté le prix de la tortilla mexicaine. Même logique pour le palmier à huile : il colonise des terres qui auraient été plus utiles à la subsistance alimentaire et dévore des forêts primitives. Arbres coupés dont on n’utilise même pas l’énergie de combustion : ils sont brûlés sur place avant qu’on ne plante les palmiers !
La violation des droits sociaux et humains. Pour obtenir un substitut bon marché au pétrole, on assiste en Colombie comme en Indonésie au rétablissement d’un quasi-servage. Au XVIIIe siècle, les maîtres sucriers brandissaient le fouet, au XXIe siècle, les paramilitaires manient la mitraillette. Les terres à agrocarburants sont, la plupart du temps, volées aux paysans, aux communautés des descendants d’esclaves évadés, aux peuples indigènes des forêts.
Alors, ces agrocarburants ? À consommer quoi qu’il arrive avec modération, sous contrôle de normes sociales et écologiques labellisées. Mais d’abord, commençons par de massives économies d’énergie ! Puis consommons « notre » biomasse locale, nos déchets urbains et ruraux. Après, on pourra songer à éponger l’éthanol issu des excédents mondiaux de production de sucre…
Pour aller plus loin…

« La LGV Lyon-Turin est la quintessence du déni de démocratie »

Justice climatique : quatorze citoyens en colère

« Que l’État joue enfin son rôle avec un vrai plan d’adaptation climatique »