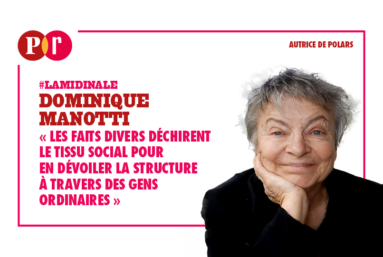Poursuivre l’histoire de la Révolution française
Lors du bicentenaire de la Révolution française, l’historien britannique Eric Hobsbawm a retracé l’évolution de ses multiples interprétations, s’opposant notamment à celles de François Furet. Un classique enfin traduit en français.
dans l’hebdo N° 978 Acheter ce numéro
Paris, 1989: le bicentenaire de la Révolution française est célébré en grande pompe, selon les voeux du Président Mitterrand. Dans le même temps, triomphent les thèses du (très libéral) François Furet, l’un des plus connus des spécialistes français de cet événement. Or, ce double mouvement constitue un vrai paradoxe, comme l’histoire et les historiens en produisent parfois : alors que l’on commémore ces « jours sacrés du monde, jours bienheureux pour l’histoire » , selon la formule de Jules Michelet dans sa préface de 1847 à sa monumentale Histoire de la Révolution française [^2], François Furet défend une interprétation de 1789 qui tend à nier la dimension de « rupture créatrice » de la Révolution telle qu’elle fut traditionnellement considérée en France par la plupart des grands courants d’historiens, depuis Georges Lefebvre ou Albert Soboul (du côté marxiste), mais aussi chez les libéraux depuis le XIXe siècle. Aussi, Eric Hobsbawm n’hésite pas à qualifier l’entreprise de François Furet de véritable « révision libérale de l’histoire de la Révolution française », qui, selon le grand historien britannique, « est entièrement dirigée, via 1789, contre 1917 » . François Furet ne s’en cache d’ailleurs pas puisque, dans un article du numéro de novembre-décembre 1989 de la revue le Débat , intitulé justement « 1789-1917 : aller et retour », il écrivait, au moment où le Rideau de fer commence à s’entrouvrir : « L’étoile d’Octobre qui s’efface refait voir celle de 1789 qu’elle avait cru éteindre » [^3]….
Sans être un spécialiste de la question, Eric Hobsbawm, qui fut lontemps un « historien marxiste », décide alors de se pencher, depuis le début du XIXe siècle, sur l’évolution des interprétations historiques de la Révolution. Il constate à cette occasion la formidable vitalité des recherches contemporaines anglaises ou américaines sur le sujet, alors que celles menées en France sont souvent moins originales et nettement moins nombreuses. Surtout, à côté de ce constat purement quantitatif, il note aussi que « l’historiographie récente sur la Révolution française, surtout en France, est particulièrement biaisée »… S’il prend la plume, c’est d’abord « agacé » par cette « rencontre de l’idéologie et de l’air du temps, associée à la force des médias modernes, [qui] fait que le bicentenaire est largement dominé par ceux qui n’apprécient guère la Révolution » . Et de citer un Premier ministre socialiste français Michel Rocard déclarer, un jour de 1989, que 1789 a permis de convaincre que « la Révolution, c’est dangereux, et que, si l’on peut en faire l’économie, ce n’est pas plus mal ! »
Eric Hobsbawm revient en premier lieu sur les analyses des jeunes libéraux sous la Restauration. Or, contrairement aux historiens « révisionnistes » actuels, qui se revendiquent pourtant les héritiers de ces premiers penseurs du libéralisme, jamais ces derniers ne s’en prennent à l’idée d’une Révolution comme « acte créateur d’une société nouvelle » (Tocqueville), ni ne pensent rompre avec l’héritage révolutionnaire. Ainsi, Guizot, en 1821, écrit que la Révolution « a été la lutte terrible mais légitime du droit contre le privilège, de la liberté légale contre l’arbitraire » . Dans leur esprit, il ne fait donc aucun doute que la Révolution française a marqué irrémédiablement l’histoire, induisant ainsi un avant et un après. Eric Hobsbawm peut alors pointer cette nouvelle « ironie de l’histoire » qui veut aujourd’hui que la « révision libérale s’en prenne ainsi […] à l’interprétation de la Révolution qui fut élaborée et popularisée dans sa forme première par l’école du libéralisme modéré, dont les révisionnistes se considèrent comme les héritiers » !
Aussi, après avoir analysé les diverses interprétations de la Révolution depuis le XIXe siècle où l’on voit d’ailleurs que les marxistes ont repris nombre d’analyses des libéraux (pour en tirer d’autres enseignements) comme le concept de « révolution bourgeoise » , l’auteur déplore le processus de marginalisation des historiens français de la Révolution durant les années 1980 et 1990, trop occupés à Penser la Révolution française, selon le titre de l’ouvrage de François Furet, au lieu de rechercher des faits nouveaux. Bien informé sur les débats d’idées dans l’Hexagone, Eric Hobsbawm ose une explication de l’existence de ce courant « révisionniste » au sein de la recherche historique française : « L’attaque révisionniste contre la Révolution reflète davantage un règlement de comptes sur la rive gauche de Paris » , lié « au passé des acteurs » et, en premier lieu, « au rapport qu’ils ont entretenu avec le marxisme » . La remarque vaut en effet pour nombre d’entre eux…
Aujourd’hui, cependant, il lui semble que « la révolution furétienne est terminée » , sans pour autant que la recherche française renoue avec les interprétations d’inspiration strictement marxiste qui, dans les années 1950, eurent une grande place. Dans une postface inédite, rédigée pour cette traduction tardive de ce classique outre-Manche et outre-Atlantique, Eric Hobsbawm salue aujourd’hui le fait qu’enfin « le « social » [ait] retrouvé une place essentiel au sein de l’histoire de la Révolution, mais une place qui ne suppose plus la séparation, encore moins l’opposition, avec le culturel, le politique et la sphère des idées et des sentiments » . Au travail, historiens !
[^2]: Rééditée chez Folio-Gallimard (4 tomes), sous la direction de Gérard Walter, 4~811~p., 24euros.
[^3]: in la Révolution française, François Furet, Gallimard, « Quarto », fév. 2007
Pour aller plus loin…

« La science est la meilleure alliée des luttes pour la santé environnementale »

Cette encombrante démocratie

Palestine : quatre auteurs pour l’histoire