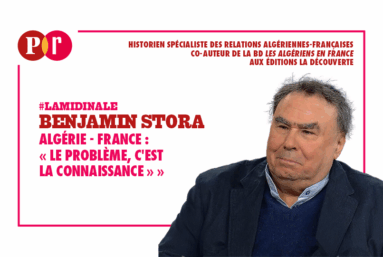La répression silencieuse
De retour d’un voyage à travers le pays birman, le philosophe Jean-Louis Deotte* analyse la situation, quelques mois après le soulèvement populaire de la fin septembre contre la junte.
dans l’hebdo N° 987 Acheter ce numéro
À Rangoon, les signes tangibles de la répression sont rares, seuls quelques sacs de sable subsistent à certains carrefours dans le quartier des ministères. Le couvre-feu a été levé le 20 octobre et on compte désormais moins de militaires dans les villes que dans une gare parisienne. Mais la population est quadrillée par quartier, et on recense 800 000 informateurs directs ou indirects dans le pays, dont des chauffeurs de taxi. Les touristes sont rares, sauf dans la région de Bagan, où le pouvoir de séduction des 4 000 édifices religieux, stupa et temples, reste intact. Si le degré de liberté d’une société se jauge à la visibilité de ses forces de l’ordre, leur invisibilité est-t-elle la marque d’une dictature en exercice ?
Jeunes moines devant un temple à Myawadi, à la frontière avec la Thaïlande. BRONSTEIN/GETTY IMAGES
Un certain nombre de régions frontalières et les zones minières restent interdites aux étrangers. De même, la zone du gazoduc exploité par Total (Kanbauk). Non parce que l’armée y pratique le travail forcé, comme on l’entend dire (Total y respecte la Charte sur les conditions de travail), mais en raison des incursions possibles des «~rebelles~» Karen et des détrousseurs Môn.
Plus au nord, sur la frontière thaïlandaise, la guerre de maquis se poursuit, avec ses embuscades, ses représailles et ses destructions de villages et de cultures. L’armée pourchasse les groupes qui se réfugient en Thaïlande. Un accord a certainement été passé entre le pouvoir thaï et les Karen : l’hospitalité contre l’approvisionnement en énergie. Passer de la Birmanie à la Thaïlande rappellera aux voyageurs des années 1970-1980 le contraste entre la RDA et la RFA, le côté déglingué et provincial de l’une, l’américanisation oublieuse de l’autre. Le « socialisme dans un seul pays » a coupé la Birmanie des circuits financiers internationaux et restreint la communication avec l’extérieur : il est difficile et fort coûteux de téléphoner à l’étranger, et on ne trouve qu’à Rangoon des cafés-Internet où d’habiles techniciens peuvent contourner la censure.
L’étranger doit arriver avec des liasses de dollars et trouver le commerçant qui prendra le risque de les échanger en kyats à un taux avantageux. Pour interdire ce trafic quotidien, la junte diffuse des dollars locaux (FEC), qui n’ont d’utilité que dans les hôtels de luxe et les agences qu’elle contrôle et qui refusent les kyats…
La junte multiplie les signes d’un pouvoir ubuesque. Rangoon est devenu la ville la plus calme d’Asie depuis qu’elle a interdit la circulation des deux-roues. La rumeur raconte que c’est parce que la voiture du numéro 1, Than Shwe, a été prise dans un embouteillage et harcelée par un groupe de motards casqués… Résultat : surencombrement des vieux bus, dont certains doivent dater de l’occupation nippone. La junte a aussi déclaré l’indépendance énergétique du pays et s’est convertie à l’écologie : ses experts ont donc programmé un vaste plan de culture du jatropha , une mauvaise herbe toxique, mais dont la graine distillée peut donner un excellent biocarburant. Problème : il n’y a pas de raffinerie pour élaborer ce produit ! La junte est aussi le principal agent économique du pays, les militaires et leurs familles se convertissant en habiles managers dans des sociétés comme Air Bagan, Myanmar Airways, Yuzana hôtels, Aureum Palace…
Si, en 1988 un an avant Tienanmen, la junte a «~montré~» aux camarades chinois comment on réprime une révolte estudiantine (manifestants abattus, corps immédiatement évacués, absence d’images), les dernières manifestations ont connu un tout autre traitement. La présence des télévisions étrangères, les téléphones satellitaires, Internet, les appareils photo numériques, l’existence d’une opposition bien organisée avec sa radio-TV ont servi de relais efficaces. Il faut y ajouter un refus probable par une partie de l’armée de brutaliser les moines, des défections, des mises aux arrêts, des négociations entre les leaders du mouvement et la police pour déterminer les parcours des cortèges, etc.
La répression a donc été modulée. Mais l’espace politique birman est appareillé. Le classique couvre-feu, progressivement reculé, a permis à la jeunesse birmane de continuer à festoyer et à l’armée d’arrêter massivement dans les monastères, sans témoins.
Aujourd’hui, on estime les forces militaires équivalentes à celles des moines dans le pays (400 000). En septembre dernier, les nervis reçurent individuellement 30 000 kyats (20 dollars) par jour pour se déguiser en militants pro-junte. Dans les régions, la junte a organisé des contre-manifestations et des meetings en procédant à des recrutements forcés dans les villages. La répression a été sévère (une trentaine de morts), mais les personnes arrêtées ont été assez facilement libérées. Et puis Internet a été bloqué, et les photos de manifestation saisies, de même que les données (photos, vidéos) des institutions internationales. Souvent, des informaticiens de l’armée sont restés dans les bureaux vides, probablement pour pirater les ordinateurs. Ce qui invite aujourd’hui tout utilisateur du web à la prudence. L’ONU n’a pas protesté contre les violations de domicile. Le contrôle de la presse a été renforcé, la télévision a diffusé des danses folkloriques et des messages de propagande. Dans les villages, les générateurs ont été coupés pour empêcher les paysans de capter les télévisions satellisables. Ils ont donc suivi les événements sur la BBC.
La junte a cru frapper ces fourmilières du bouddhisme politique que sont certains monastères. Mais les fourmis se sont dispersées : les moines ont troqué leur robe pour un habit civil et sont retournés dans leurs villages. Quand on visite certains monastères, les moines n’hésitent pas à entrer en contact avec l’étranger et à donner des informations sur la situation. Pourquoi alors boycotter le tourisme en Birmanie ?
En se retirant dans sa capitale astrologique, pour échapper à une invasion américaine comme en Irak, le pouvoir manifeste surtout la peur que lui procure le peuple. Rangoon s’en trouve appauvri, les riches s’étaient fait bâtir des demeures délirantes. Il est étonnant de retrouver cette architecture à Bangkok, surplombant les tours prétentieuses de la seconde vague internationale. Qu’il est difficile de « finaliser » une architecture industrielle. La seule solution cohérente, c’est de parachever l’ensemble par un mat de télécom. La communication n’est-elle pas devenue notre universelle destination ?
Pour aller plus loin…

Michaël Fœssel : « Nous sommes entrés dans un processus de fascisation »

Rose Lamy : « La gauche doit renouer avec ceux qu’elle considère comme des ‘beaufs’ »

Sur le protectionnisme, les gauches entrent en transition