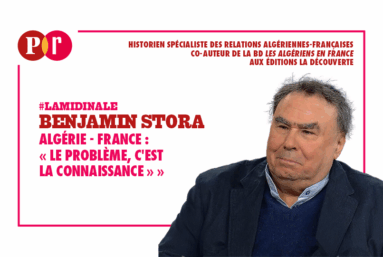Les idéologies économiques en procès
La parution des « Essais » de Karl Polanyi est l’occasion de découvrir des textes inédits en français de l’économiste, porteurs d’une critique de la société de marché. L’analyse de Jean-Louis Laville et Jérôme Maucourant*.
dans l’hebdo N° 1019 Acheter ce numéro
Comment expliquez-vous le regain d’intérêt pour l’auteur de « la Grande Transformation » ?
Jean-Louis Laville : L’importance grandissante de Karl Polanyi, dont atteste l’augmentation régulière des références le concernant dans différentes parties du monde, est indéniable. Elle tient à ce qu’il apparaît comme un penseur du socialisme démocratique dans une période où la gauche s’interroge sur son identité et sur son projet.
Jérôme Maucourant : Les Essais contiennent des textes peu connus des années 1920, qui montrent l’inéluctable échec de l’économie planifiée centralement, ce qui n’était alors pas évident pour beaucoup, libéraux ou non. Polanyi élabore ainsi des outils permettant de concevoir une société qui donne une place au marché, tout en n’étant pas déterminée par lui. C’est ainsi qu’il tente de penser une alternative au capitalisme.
J.-L. L. : La force de son argumentaire tient à ce qu’il mobilise tout un ensemble d’apports anthropologiques pour penser les rapports entre économie et société, comme en témoigne la première partie de l’ouvrage, « Économies primitives et archaïques ». À partir de cet éclairage, il critique « le sophisme économiciste [^2] » qui confond économie et marché. Pour lui, la naturalisation du marché occulte le fait que celui-ci relève de choix politiques et qu’il suppose, pour s’instituer, un rôle actif, voire violent, de l’État.
**
La pensée de Karl Polanyi prolonge-t-elle celle de Karl Marx, qui reste une référence en matière de critique du capitalisme ?**
J.-L. L. : Contre le sens commun qui fait du marché la condition de la démocratie, Polanyi montre, en s’appuyant sur Aristote, que la démocratie ne procède pas du marché. Il met en cause, dans la deuxième partie du livre, « Crise de la société de marché, socialismes et fascismes », le projet d’une société de marché.
J. M. : Ce projet implique une séparation rigide entre économie et politique. Il suppose aussi une subordination de la démocratie et de toutes les formes de socialités à l’impératif de la production marchande. Or, l’État libéral est conduit à affronter la réalité, c’est-à-dire que les marchés ne sont pas autorégulateurs et que l’interventionnisme est une nécessité.
J.-L. L. : Le caractère irréaliste de ce projet engendre donc des réactions de grande ampleur, qui ont emprunté au XXe siècle les formes régressives des totalitarismes et, en particulier, des fascismes.
J. M. : Selon Polanyi, le fascisme est un interventionnisme conservant la domination de classe. Mais, surtout, il examine les fondements idéologiques de cet anti-individualisme absolu, qui réunit la politique et l’économie pour surmonter l’impasse libérale en produisant un homme nouveau, absolument aliéné, simple pièce d’une nouvelle communauté organique. Le but du fascisme est de liquider tout l’héritage libéral et la possibilité même du socialisme. Cette critique des idéologies anti-individualistes, que peuvent susciter les difficultés de la modernisation et les impasses de la politique internationale, est d’une actualité brûlante.
J.-L. L. : Pour lui, l’ordre libéral n’est donc pas le stade ultime de l’histoire : il fait même peser des menaces sur la paix et sur la démocratie. Ce message à contre-courant des idées reçues est pourtant crucial dans la période que nous vivons, où se ravivent les inquiétudes sur le devenir d’un système économique désormais financiarisé et globalisé [^3]. En cela, il se rapproche de Marx, mais il se démarque aussi des messianismes marxistes en réfutant une visée d’abolition du marché et la dissolution de la société dans l’État. Il aborde cette question dans la troisième partie, intitulée « Dépasser la société de marché ».
Avec Marx et Polanyi, assiste-t-on à un retour de la contestation des idéologies économiques ?
J.-L. L. : Les chapitres « La mentalité du marché est obsolète ! » et « Faut-il croire au déterminisme économique ? », écrits en 1947, sont emblématiques de la contestation des idéologies économiques. Polanyi y considère que l’économie dans toutes les sociétés humaines résulte d’un processus institutionnalisé. En cela, il accorde une grande importance à l’éthique et au politique, et il parie sur les capacités de changement des institutions et des individus, elles-mêmes interdépendantes.
J. M. : Le livre comporte aussi des développements sur la guerre sociale que connut l’Europe durant les années 1930-1940 : l’analyse qu’il fait des errements de la politique britannique, possédée par son passé hégémonique, les avertissements qu’il adresse aux États-Unis et son analyse de la situation balkanique sont d’une pertinence étonnante, quasi prophétique. Selon Polanyi, le monde d’après 1945 ne peut être gouverné par un quelconque empire porteur d’une idéologie économique. Il oppose au « capitalisme universel » la « planification régionale » , seule façon d’éviter un retour aux conséquences létales du cosmopolitisme libéral. La crise présente de l’imperium américain, le défi que lancent certaines nations à la mondialisation impériale, parfois pour le pire, illustrent à merveille la perspective polanyienne.
Le véritable apport – et la modernité – de la ?pensée de Polanyi n’est-il pas dans la recherche d’une alternative aux représentations économiques du monde ?
J.-L. L. : Dans la postface, écrite avec Alain Caillé, nous mettons en rapport Polanyi avec Marx, mais également avec Weber. La position convergente de ces trois auteurs tient à ce que leur travail scientifique invalide cette conception aujourd’hui prévalente selon laquelle le sujet humain serait de tout temps un homme économique [^4], c’est-à-dire un individu ne songeant qu’à maximiser sa propre utilité.
J. M. : Mais il ne s’agit pas ici de renier un individualisme de l’émancipation, que Polanyi tente de penser avec Rousseau, par-delà les apories du projet rousseauiste.
[^2]: Cf. Revue du Mauss, n° 29, premier semestre 2007, « Karl Polanyi, contre la société du tout-marchand », dans lequel est publiée, sous ce titre, l’une de ses célèbres contributions.
[^3]: Cf. l’ouvrage collectif, Peut-on critiquer le capitalisme ?, Paris, La Dispute, 2008.
[^4]: Sur cette anthropologie caractéristique de la normativité occidentale moderne, cf. l’Homme économique. Essai sur les racines du néolibéralisme, Christian Laval, Gallimard, Paris 2007.
Pour aller plus loin…

Michaël Fœssel : « Nous sommes entrés dans un processus de fascisation »

Rose Lamy : « La gauche doit renouer avec ceux qu’elle considère comme des ‘beaufs’ »

Sur le protectionnisme, les gauches entrent en transition