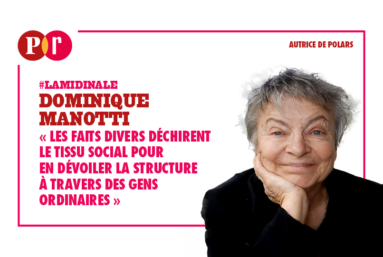Une leçon pour Sarkozy
Un ouvrage collectif de spécialistes de l’histoire de l’Afrique montre la grande méconnaissance et les stéréotypes contenus dans le discours de Dakar du président de la République.
dans l’hebdo N° 1030 Acheter ce numéro
Remettre les pendules à l’heure ! Cette expression bien française pourrait sans doute résumer l’objectif de la bonne vingtaine de chercheurs en histoire africaine – Occidentaux ou Africains – réunis autour de l’historienne malienne Adame Ba Konaré, scandalisés par le fameux « discours de Dakar » prononcé le 26 juillet 2007 par Nicolas Sarkozy, président de la République française, ancienne puissance coloniale, devant un parterre de responsables politiques, d’étudiants et d’intellectuels à l’université Cheikh Anta Diop. D’emblée, ce nom a le plus souvent été gommé par le président français et ses conseillers, alors qu’il rend hommage à ce savant sénégalais de premier plan qui, toute sa vie, lutta contre les « falsifications de l’histoire » particulièrement fréquentes vis-à-vis de l’Afrique, et contribua à réhabiliter l’histoire africaine (Le discours est en effet consultable à l’adresse suivante : ^2. Mais, refusant de se limiter à une nouvelle protestation collective, c’est sur le terrain scientifique qu’ils ont décidé de répondre, « dans une démarche de construction de connaissances dépouillée de toute considération émotive pour éclairer au mieux le président français et son entourage ». Car, outre de nombreuses réactions indignées dans l’Hexagone, une large partie de l’opinion publique africaine a déjà exprimé ses vives réprobations à l’encontre de propos présidentiels semblant appartenir à un autre âge[^3].
Parmi bien d’autres, les deux aspects les plus scandaleux de l’allocution de Nicolas Sarkozy furent en effet, d’une part, la vieille rengaine déniant une histoire au continent africain, et, d’autre part, la présentation de la colonisation sous un jour quasi favorable, proche du fameux « rôle positif de la France outre-mer » que les députés UMP avaient introduit dans une loi de la République du 23 février 2005 – loi toujours en vigueur, en dépit de l’abrogation de son article 4, où était vanté ce « rôle ». Citons tout d’abord un petit florilège de la logorrhée présidentielle : « Le drame de l’Afrique, c’est que l’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire. Dans cet univers où la nature commande tout, […] jamais l’homme ne s’élance vers l’avenir. Jamais il ne lui vient à l’idée de sortir de la répétition pour s’inventer un destin. » Puis, après avoir tout de même pris soin de reconnaître certains méfaits de l’impérialisme européen, il poursuivait en ces termes : « [Le colonisateur] a aussi donné. Il a construit des ponts, des routes, des hôpitaux. […] Il a donné sa peine, son travail, son savoir. Je veux le dire ici, tous les colons n’étaient pas des voleurs, tous les colons n’étaient pas des exploiteurs. […] La colonisation n’est pas responsable de toutes les difficultés actuelles de l’Afrique. Elle n’est pas responsable des guerres sanglantes que se font les Africains entre eux, des génocides, des dictateurs. »
*
En réponse, avec ses 25 contributions, l’ouvrage dirigé par Adame Ba Konaré se propose de *« réfuter point par point les poncifs hérités de l’ethnologie coloniale véhiculés par le discours de Dakar et de prodiguer plus largement une véritable leçon d’histoire pour en finir avec le regard statique porté sur l’Afrique ». Le groupe d’historiens, qui compte parmi les meilleurs spécialistes du continent africain (dont Elikia M’Bokolo, Catherine Coquery-Vidrovitch, Olivier Le Cour Grandmaison, Doulaye Konaté, Bogumil Jewsiewicki, etc.), apportera sans doute à de nombreux lecteurs les premières bases de leur discipline, puisque l’enseignement de cette histoire est plutôt succinct, voire rare dans les écoles de l’Hexagone. Le déni d’histoire à l’encontre de l’Afrique, que bien des esprits occidentaux imaginent marquée par une certaine intemporalité, est en effet si courant que, dans sa remarquable contribution sur « Les visions françaises de l’Afrique et des Africains », Pierre Boilley rappelle que, « de fait, annoncer que l’on est historien de l’Afrique suscite invariablement » l’interrogation : l’Afrique a-t-elle bien une histoire ? Au fil des sujets qu’il aborde, ce volume parvient à détruire un grand nombre d’idées reçues et d’inexactitudes dont Nicolas Sarkozy et Henri Guaino, sa « plume », avaient reprises sans plus de précautions. Mais l’analyse du discours de Dakar est aussi l’occasion pour ces historiens de « mesurer l’ampleur des stéréotypes entêtés sur l’histoire de l’Afrique » : le texte, « sous-tendu par une telle méconnaissance » , met en fait en lumière « la pauvreté de la connaissance des sociétés africaines par les élites françaises, et plus largement occidentales ». Sur ce point, Olivier Le Cour Grandmaison montre précisément combien que ces sociétés demeurent, « dans le regard de l’Occident, depuis le XIXe siècle au moins, captives de l’éternelle répétition de la bibliothèque coloniale »…
C’est donc bien une véritable « remise à niveau » que propose l’ouvrage, d’abord pour Nicolas Sarkozy, mais aussi pour le lecteur, en matière d’histoire de l’Afrique et de ses rapports avec ses voisins. D’un essai passionnant sur la « périodisation » en histoire africaine (Catherine Coquery-Vidrovitch) à des études sur « le rôle de la colonisation dans “l’immobilisme” des sociétés africaines » (John O. Igué), « l’enseignement du fait colonial » (Tayeb Chenntouf) ou la question de l’esclavage et des différentes traites – transatlantique (Kinvi Logossah) ou interne à l’Afrique (Ibrahima Thioub) –, ce petit « Précis » fait œuvre de pédagogie, en nous éclairant non seulement sur l’histoire de ce continent, mais en nous apprenant aussi beaucoup sur nous-mêmes et notre façon d’appréhender l’Autre.
[^3]: cf. notamment la trentaine d’interventions d’intellectuels africains, L’Afrique répond à Sarkozy. Contre le discours de Dakar, Makhily Gassama (dir.), Éditions Philippe Rey, fév. 2008, 480 p., 19,80 euros. (cf. Politis n° 992 du 6 mars 2008).
Pour aller plus loin…

« La science est la meilleure alliée des luttes pour la santé environnementale »

Cette encombrante démocratie

Palestine : quatre auteurs pour l’histoire