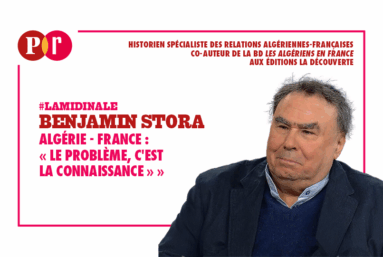La face cachée de la reforestation
Au nom de la lutte contre la pollution, les forêts sont devenues un enjeu financier face auquel les droits des peuples autochtones ne pèsent guère.
dans l’hebdo N° 1052 Acheter ce numéro

C’est avec un grand sourire que le prince de Galles visite en novembre 2008 « l’une des plus grandes initiatives de restauration des forêts tropicales jamais tentées » sur l’île de Sumatra (Indonésie). En 2002, le gouvernement indonésien a attribué pour cent ans 53 000 hectares des forêts d’Harapan à un consortium d’organisations non gouvernementales environnementales, « afin de les protéger contre la pression des plantations de palmiers à huile et de bois à pâte, de l’exploitation forestière illégale et du feu ». Il y aurait même des emplois pour les communautés en bordure des forêts.
Une réalité tronquée, selon Sarwadi Sukiman, paysan originaire de l’île : « Lorsque le consortium a pris le contrôle de la région, des paysans et des indigènes ont été intimidés, arrêtés, interrogés et expropriés de leurs terres, forcés d’accepter par lettre de ne jamais revenir. L’un d’entre eux a été détenu pendant six mois pour avoir défendu la terre de la communauté touchée. » Selon le Mouvement mondial pour les forêts tropicales (WRM), l’établissement d’aires protégées est souvent suivi d’expropriations, faisant des réfugiés de la conservation une nouvelle catégorie de migrants en pleine expansion (voir encadré). Dès 2002, le WRM estimait leur nombre à 600 000 en Inde. En Afrique centrale, la création de neuf parcs nationaux aurait entraîné le déplacement forcé de 51 000 résidents, sans qu’aucune aire d’accueil ne leur soit proposée.
Le cas du parc national de Mount Elgon, en Ouganda, est emblématique. Deux ans après sa création en 1992 – qui généra les premiers déplacements –, un accord fut signé entre les autorités de ce pays et la fondation Face, créée par des entreprises électriques néerlandaises, pour y planter 9 000 hectares d’arbres destinés à stocker du carbone en compensation d’émissions de CO2 de centrales à charbon aux Pays-Bas. Le parc bénéficie de la certification écologique FSC, dont un des principes est d’assurer aux peuples autochtones leurs droits, les terres et leurs ressources. Février 2008 marque pourtant l’expulsion de plus de 4 000 résidents du parc. Pour le service de la faune et de la flore ougandaises (UWA), l’installation de ces communautés était « illégale ». Or, deux ans et demi plus tôt, la justice ougandaise avait autorisé la communauté des Benet « à s’y adonner à des activités agricoles ».
Plusieurs conventions et déclarations internationales reconnaissent pourtant les droits des peuples autochtones [^2]. Mais l’intégration prochaine des forêts et des terres agricoles des pays du Sud dans le marché mondial du carbone, sous l’égide de l’accord qui succédera dès 2012 au Protocole de Kyoto, risque encore d’en compliquer l’application.
Ainsi, le propriétaire d’une forêt ou d’un champ pourra vendre un droit à polluer correspondant aux quantités de carbone qui y sont stockées. La Banque mondiale estime que ces mécanismes (dits REDD) vont offrir aux populations locales des compléments de ressources. « Ils risquent plutôt de créer une compétition croissante pour l’accès aux ressources productives, selon Via Campesina. Les terres ne serviront plus à nourrir les communautés locales, mais à stocker du carbone pour que le Nord puisse continuer à en émettre. »
Pour Sylvain Angerand, chargé de campagne pour la protection des forêts aux Amis de la Terre France, « c’est un néocolonialisme écologique. On réquisitionne de la terre au Sud pour compenser la surconsommation du Nord. Les peuples autochtones et les communautés locales se retrouvent coincés entre des plantations de palmiers à huile et les rares forêts restantes mises sous cloche. Tant que les États n’auront pas résolu ces conflits fonciers, les mécanismes de type REDD exacerberont ces tensions. »
Il devient donc urgent de transposer dans les droits nationaux les conventions et déclarations relatives aux droits des peuples autochtones, et en particulier le principe de « consentement prioritaire, libre et informé ». Une étude a montré que, quand les communautés indigènes acquièrent des droits, elles défendent avec succès leur territoire contre l’exploitation commerciale. Ainsi, 1 % des territoires octroyés aux indigènes sont touchés par la déforestation en Amazonie (au Brésil), contre 2 % dans les aires uniquement protégées par des mesures environnementales, et 19 % dans les zones non protégées.
Relégués actuellement au rang d’observateurs dans les négociations internationales sur le climat, les peuples indigènes demandent donc une suspension immédiate des projets de type REDD sur leurs territoires tant que leurs droits ne seront pas pleinement reconnus, protégés et promus.
.
[^2]: Convention 169 de l’Organisation internationale du travail, Convention sur la diversité biologique et, surtout, Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.
Pour aller plus loin…

« La LGV Lyon-Turin est la quintessence du déni de démocratie »

Justice climatique : quatorze citoyens en colère

« Que l’État joue enfin son rôle avec un vrai plan d’adaptation climatique »