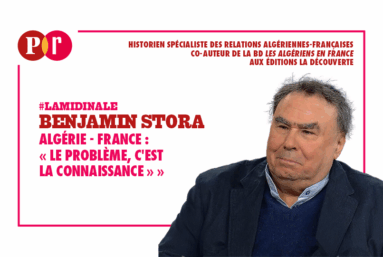La parenthèse de Foucault
Un collectif de jeunes chercheurs a imaginé
un recueil d’archives
de l’enfermement et de l’exclusion qu’avait envisagé Michel Foucault sans jamais
le réaliser.
dans l’hebdo N° 1061 Acheter ce numéro
En 1977, Michel Foucault publiait un texte à l’écriture très personnelle qui devait être l’introduction d’un « recueil » dont l’idée lui était « venue un jour où [il] lisai [t] à la Bibliothèque nationale un registre d’internement rédigé au tout début du XVIIIe siècle ». Ce projet – jamais abouti – était censé rassembler des documents relatant les « vies singulières » d’hommes et de femmes, « à la fois obscures et infortunées » , croisées au fil des explorations de ce boulimique d’archives qu’était l’auteur de Surveiller et punir. Elles devaient toutes provenir de la « même source » : archives « de l’enfermement » (de l’Hôpital général ou de la Bastille), « de la police, des placets au roi et des lettres de cachets » des XVIIe et XVIIIe siècles… Ces « vies ordinaires » , dont Foucault voulait publier les fragments dans une sorte d’ « herbier », auraient pourtant dû rester totalement inconnues, si la « rencontre avec le pouvoir » ne les avait un jour « arrachées à la nuit où elles auraient pu, et peut-être toujours dû, rester ».
Ce texte lui-même, « la Vie des hommes infâmes », aurait sans doute lui aussi dû rester mineur dans l’œuvre de Michel Foucault. Au contraire, dès sa publication (dans une revue), il acquit rapidement une place singulière et connut un fort retentissement chez nombre de lecteurs attentifs du philosophe. Il donnait en effet d’abord à lire quelques-unes de ses émotions ressenties face aux « rencontres » qu’il faisait durant ses longues journées passées à la « Nationale », à ces « vies infimes » enfouies depuis plusieurs siècles dans des cartons d’archives. Mais ces quelque vingt-quatre pages destinées à introduire la découverte de ces « exempla » , que Foucault comptait livrer bruts au lecteur, semblaient également illustrer une démarche chère au philosophe : en donnant à lire ces morceaux de la « petite histoire », il écrivait également un pan de la grande « histoire des mécanismes du pouvoir ».
Cette « préface », on l’a dit, ne connut jamais de suite. Aujourd’hui, un collectif réunissant, « quelque part entre histoire, philosophie et sociologie » , cinq chercheurs de ces différentes disciplines, généralement considérés parmi quelques-uns des plus brillants « foucaldiens » de leur génération [^2], se sont essayés à produire ce livre jamais abouti. Ils ont tout d’abord choisi de donner à leur « petite équipe » (comme nous l’a dénommée Mathieu Potte-Bonneville) le nom de « Maurice Florence », qui fut le pseudonyme (aux mêmes initiales) choisi par Foucault quelque temps avant sa disparition pour signer une notice présentant sa propre œuvre. Ce choix vient d’ailleurs rappeler le goût du philosophe pour l’anonymat ou le pseudonyme, qui, dans une sorte de démarche inversée, aimait autant à « disparaître » qu’il éclairait soudain d’un « faisceau de lumière » ces existences découvertes au détour d’un document jauni datant de plusieurs siècles et extrait du fonds d’une bibliothèque.
Plus qu’un livre, le fruit du travail de ce collectif est un véritable objet, original et multiforme. Commençant par une lecture contemporaine (d’une grande finesse) de ce « bref traité de l’écriture, du pouvoir et de l’exclusion » que constitue « la Vie des hommes infâmes », placé lui-même en début de volume, les auteurs invitent ensuite le lecteur, grâce à des photographies de belle facture, à une véritable plongée dans les archives, non pas celles que Foucault avait lui-même explorées, mais d’autres, parfois très récentes, qui, de la même manière, donnent à découvrir les traces de ceux que le pouvoir a relégués, souvent avec une violence inouïe, et des résistances qu’ils ont essayé ou pu lui opposer. Ayant considéré que « la Vie des hommes infâmes » constituait une « parenthèse ouverte, et jamais refermée » , les auteurs ont donc rassemblé fichiers, lettres à des autorités sonnant comme des suppliques, notes et autres objets, qui sont autant de « traces multipliées » de nos vies que le pouvoir garde « en mémoire » et qui sont même, à l’heure de l’informatique, « sauvegardées ». Serions-nous en train de redevenir « infâmes » ? Cet ouvrage insolite en donne parfois le frisson.
[^2]: Le collectif « Maurice Florence » est composé des philosophes Pascal Michon, Mathieu Potte-Bonneville et Judith Revel, de l’historien Philippe Artières et du sociologue Jean-François Bert. À partir de ce travail, ces derniers ont monté une exposition, visible actuellement à la Bibliothèque municipale de Lyon (jusqu’à la fin août), dont les documents présentés dans cet ouvrage constituent une partie.
Pour aller plus loin…

Michaël Fœssel : « Nous sommes entrés dans un processus de fascisation »

Rose Lamy : « La gauche doit renouer avec ceux qu’elle considère comme des ‘beaufs’ »

Sur le protectionnisme, les gauches entrent en transition