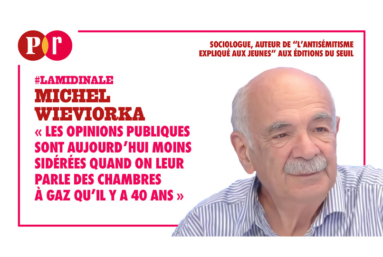Une crise politique et institutionnelle
La défaite de la droite ouvre une période d’incertitudes et de tensions. Au sein de la « majorité » mais surtout dans le pays, où le scrutin de dimanche encourage la contestation des réformes.
dans l’hebdo N° 1095 Acheter ce numéro
Les deux dernières années du quinquennat de Nicolas Sarkozy n’auront rien d’un long fleuve tranquille. Depuis dimanche, la majorité UMP apparaît tellement minoritaire que son pouvoir en est ébranlé. Juridiquement, on ne peut donner tort à François Fillon quand il déclare qu’« on ne gouverne pas un grand pays comme la France au rythme des élections locales, mais en gardant le cap fixé par les élections nationales ». En démocratie, un scrutin ne peut être annulé que par un scrutin de même nature. Rien ne peut contraindre le président de la République à dissoudre l’Assemblée nationale, encore moins à remettre son mandat en jeu. Le Premier ministre peut donc se prévaloir de la légalité pour « poursuivre dans la voie des réformes engagées ».
Il a pour lui la légalité, mais quelle légitimité ? Le décalage entre le pays réel et sa représentation officielle n’a jamais paru aussi grand que depuis dimanche. Avec 35 % des suffrages (17 % des inscrits) l’UMP et ses alliées trustent 70 % des élus à l’Assemblée nationale et 55 % des sénateurs. Mais aussi 90 % des membres du Conseil constitutionnel et des membres du CSA, organisme de contrôle de l’objectivité audiovisuelle. Et une proportion équivalente des responsables des chaînes de télévision et des détenteurs du pouvoir économique, ce que l’on appelait naguère l’oligarchie économico-financière. Sans oublier, bien sûr, la présidence de la République et le gouvernement. Dans ce décalage devenu fossé, résident tous les ingrédients d’une crise politique et institutionnelle.
Crise politique si le gouvernement s’entête, comme il en a manifesté l’intention dès dimanche soir, à conduire à son terme une réforme des retraites qui entraînerait, notamment, une individualisation du système de retraites, le recul de l’âge de départ et une baisse drastique du montant des pensions; s’il s’obstine à vouloir réduire les déficits publics aux prix d’une dégradation des prestations sociales de toute nature, y compris de la couverture de santé, d’une déstructuration des services publics et d’une augmentation de la TVA – hypothèse relancée par Nicolas Sarkozy lui-même dans son entretien au Figaro-magazine , à la veille du premier tour.
Crise institutionnelle, enfin, si le pouvoir maintient son projet de réforme des collectivités territoriales, auquel sont opposées 90 % des régions gagnées dimanche par la gauche, et qui a pour principal objet de permettre à l’UMP de gagner, par un changement de mode de scrutin, les régions qu’elle n’est pas capable de conquérir avec les règles actuelles, qu’elle a pourtant dictées en 2003. Ou s’il confirme vouloir imposer son « Grand Paris » malgré le désaveu cinglant des électeurs franciliens qui, en votant à plus de 56 % pour la liste de rassemblement de la gauche et des écologistes de Jean-Paul Huchon, ont nettement manifesté leur refus de ce projet défendu par la perdante du scrutin, Valérie Pécresse.
De ce point de vue, le mini-remaniement ministériel de lundi n’augure rien de bon. Avant tout conçu pour faire taire les critiques au sein de l’UMP, il se limite à l’éviction du ministre du Travail, Xavier Darcos, responsable de la plus importante contre-performance électorale. Celui-ci est remplacé par Éric Woerth, qui devra conduire la réforme des retraites, et est lui-même remplacé au Budget par un chiraquien, François Baroin. Un centriste entre également au gouvernement, Marc-Philippe Daubresse, qui prend les fonctions laissées par Martin Hirsch, ainsi qu’un villepiniste, Georges Tron, nommé secrétaire d’État à la Fonction publique. Il y a peu de chance que cette « ouverture » à droite apaise la fronde qui monte dans les rangs de l’UMP. « Les villepinistes n’entrent pas au gouvernement avec Georges Tron », a déjà prévenu le député François Goulard, pour qui « cela n’entraîne évidemment aucune conséquence pour les partisans de Dominique de Villepin » . « Ce n’est pas en changeant quelques ministres que l’on change de politique dans un régime où toutes les décisions sont prises à l’Élysée », a-t-il ajouté.
Confronté au désaveu du pays, le sarkozysme est en effet contesté au sein d’une UMP qui doute désormais de la capacité de son chef à la conduire à la victoire. La colère de ses députés s’est exprimée sans détours, mardi matin, au cours d’une réunion convoquée par Jean-François Copé, à huis clos et sans la présence des ministres. Parmi les griefs exprimés, au cours de cette séance très animée, par les députés contre l’exécutif, figurent « le manque de lisibilité des réformes », « le fouillis », « l’ouverture » et « la taxe carbone » , dont François Fillon a annoncé une heure plus tard l’abandon.
Si cette thérapie de groupe était inévitable, il est peu probable qu’elle vide totalement l’abcès. Dès les résultats du premier tour, plusieurs élus de la majorité n’ont pas ménagé leurs critiques contre la direction du mouvement et le chef de l’État, sur leur stratégie électorale, et leur « déni » du revers subi par l’UMP qui a cédé au PS le titre de premier parti de France. La réunification de la droite au sein d’une seule formation totalement soumise aux diktats de l’exécutif est remise en cause par quelques francs-tireurs. « D’où vient le mal ? Du parti unique. L’union, c’est bien, le parti unique, ça ne marche pas », affirme Hervé de Charette, député Nouveau Centre du Maine-et-Loire qui appelle la « reconstitution de la force politique du centre » . Signe que les forces centrifuges agitent de nouveau la droite, Dominique de Villepin doit annoncer ce jeudi la création d’un nouveau mouvement politique qui, assure la présidente de son club, Brigitte Girardin, ne se situera pas « dans l’orbite de l’UMP », mais aura vocation à rassembler au-delà des clivages politiques.
Même la personne du chef de l’État n’est plus taboue depuis qu’une majorité de Français ne souhaite pas qu’il se représente. Lassé de la « France Hauts-de-Seine » , Bernard Reynès, proche de M. Copé, assène : « Après Sarkozy I, il faut un Sarkozy II ! » Le sénateur lorrain Jean-Louis Masson, certes non-inscrit, va plus loin et se demande ouvertement si Nicolas Sarkozy est toujours « le meilleur candidat de la droite pour 2012 ou si une alternative doit être recherchée » citant « Villepin, Juppé ou Copé ».
Le dogme de l’infaillibilité du chef en a pris un coup.