Les pyramides de Benjamin
Les Prairies ordinaires rééditent l’ouvrage de Daniel Bensaïd sur Walter Benjamin. Dans l’extrait que nous publions ici, il évoque la pensée du philosophe comme un puzzle, sa méthode comme un art du montage.
dans l’hebdo N° 1115 Acheter ce numéro
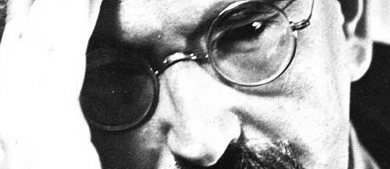
Un livre sur Benjamin, une dissertation seraient contradictoires à leur sujet, qui impose de recourir aux procédés de montage, collage, citations explicites ou cachées, pratiqués par Benjamin lui-même. Pour nous, Benjamin devient à son tour une image dialectique, le point de cristallisation d’une pensée messianique aux prises avec les hypostases de la raison historique.
L’histoire rythmique du possible ne se laisse pas réduire en système. Pareils aux mosaïques médiévales, à leur fragmentation majestueuse, l’essai ou le traité assignent à l’intelligence un « travail micrologique » sur les éclats dispersés de la pensée. Le propre de l’époque, c’est que « tout se brise en morceaux et ces morceaux se brisent eux-mêmes en mille autres » . Voici venu le temps d’une pensée de résistance minuscule, de courage dans l’infime, de sauvetage par le détail, travaillant obscurément dans les intervalles de la totalité brisée. « Le concept de style philosophique n’a rien de paradoxal. Il a ses postulats. Ce sont : l’art du discontinu, par opposition à la chaîne des déductions ; la démarche patiente et obstinée du traité par opposition au geste du fragment, la répétition des motifs par opposition à la platitude de l’universalisme ; la plénitude concise de la positivité, par opposition
