Lordon, marxiste tendance Spinoza
L’économiste Frédéric Lordon nous propose une passionnante réflexion
sur les processus de domination dans la société capitaliste, et quelques pistes pour en sortir.
dans l’hebdo N° 1121 Acheter ce numéro
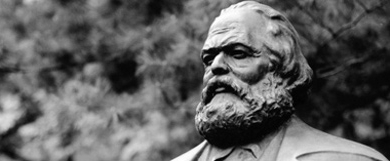
En lisant le dernier ouvrage de l’économiste Frédéric Lordon, on pense à ce critique de théâtre qui demandait : « Quoi de neuf en cette rentrée ? », et qui, invariablement, répondait : « Shakespeare ! » Lordon, lui, répondrait plutôt : « Spinoza et Marx ». Il n’organise pas la rencontre improbable des deux hommes que deux siècles séparent, mais le croisement de deux philosophies – disons de deux « pensées », pour ne pas froisser Marx, auteur fameux de Misère de la philosophie… L’auteur commence par poser cette question simple : comment le capitalisme s’y prend-il pour soumettre le plus grand nombre à l’intérêt de quelques-uns ? Ce qui le conduit à cette autre interrogation : comment, pour « faire oublier la domination », « rendre les dominés contents » ? Car le capitalisme ne « fait » pas, il « fait faire ». Et pour « faire faire » par autrui (pléonasme assumé), l’employeur dispose de deux gammes sur lesquelles il joue au gré de l’histoire : il peut terroriser son employé, mais il peut aussi l’amener à un consentement. On conviendra que la première option est vulgaire et, au fond, peu intéressante.
C’est la dictature. La seconde correspond mieux à notre époque et à nos contrées, et mérite examen. L’employeur peut effectuer un véritable transfert sur son employé jusqu’à ce que celui-ci désire ce que l’employeur désire, c’est-à-dire en l’occurrence la réalisation d’un produit et le gain qui s’ensuit. Il y a tout de même quelque chose de mystérieux dans ce déplacement, puisque, si le désir de l’employeur est réalisé, la réalisation de celui de l’employé est limitée aux nécessités de la simple reproduction de sa force de travail. Où est l’intérêt de l’employé ? Par quelle magie en vient-il à adhérer à un intérêt qui n’est pas le sien, et à épouser un désir qui est, de prime abord, celui de l’employeur ? Et c’est ici que, pour répondre à ces questions, Lordon, économiste, directeur de recherche au CNRS, convoque Marx et Spinoza. Il souligne aussi leur complémentarité qui va, selon lui, à l’envers de la chronologie : c’est Spinoza qui complète Marx et lui apporte un supplément de modernité. Le second analyse les structures du capitalisme, il en démonte la mécanique, il scrute la place de l’argent dans le rapport salarié-employeur. Il montre que, dans la relation capitalistique la plus primaire, l’employé ne tient l’argent dont il a besoin pour vivre que de l’employeur, tandis que celui-ci le tient surtout du financier qui lui fait crédit.
Se référant aux travaux de Michel Aglietta, l’un des fondateurs de l’école de la régulation, Lordon montre comment Marx vide la monnaie de toute valeur substantielle intrinsèque, pour ne garder que son contenu de relation sociale. Quand la monnaie devient « argent ». Et c’est cet argent qui peut devenir objet de désir. Il faut alors se tourner vers Spinoza. Car c’est lui qui apporte dans la relation sociale cet ingrédient passionnant : le désir. Cet affect qui peut conduire à s’identifier au capitaliste quand on est son employé, mais aussi à vivre dans la passion sa relation de travail.
Bien sûr, ce désir ne va pas de soi. Il n’y a pas « de servitude volontaire », écrit Lordon. Pour parvenir à cet état qui fait oublier la domination et crée chez l’employé l’illusion qu’il y consent spontanément, le capitalisme moderne déploie des trésors de séduction. C’est ce que Lordon appelle le travail « d’enrôlement ». Nous plongeons ici dans les ressorts de plus en plus complexes de la domination, et nous côtoyons Foucault et Bourdieu. Avec eux, nous comprenons que le processus de domination est aujourd’hui « moins simple » « que ne le suggère l’antagonisme bipolaire dont Marx a fait l’analyse ». « Le face-à-face d’un patron-propriétaire et d’une masse de prolétaires encadrés par quelques contremaîtres, analyse Lordon, a cédé la place à des structures d’entreprise de plus en plus feuilletées du fait de l’approfondissement de la division du travail et de la spécialisation interne ». Les rapports de domination sont diffractés « en une myriade de rapports de domination secondaire ». Il reprend la notion de « chaîne de dépendance » chère à Norbert Elias. À force de raffinement, c’est l’institution qui finit par produire du désir. Mais, au fond, la tentative d’enrôlement idéologique et affectif, et la résistance qu’elle rencontre ne sont-elles pas la version la plus moderne du conflit social ? Car, comme Lordon le montre bien, le « constructivisme affectif de l’entreprise néolibérale », avec son arsenal de « coaching » et ses armées de psychologues maison et leurs pratiques de motivation, ne parvient jamais durablement à faire oublier la violence sociale dont il est porteur.
Lordon n’est jamais antimarxiste. Mais, paradoxe de l’économiste – ou modernité de l’économiste ? –, ce sont les processus liés à l’affect qui le passionnent. Et c’est contre eux, suggère-t-il, qu’il faut finalement se préserver et se révolter si l’on veut combattre le capitalisme sans lui substituer des relations sociales qui porteront en elles les mêmes rapports de domination. Il ne suffit pas de remettre en cause la propriété privée des moyens de production, estime Lordon. C’est, dit-il, une condition nécessaire mais pas suffisante.
Le véritable combat, porteur d’une société véritablement différente, « communiste » – osons le mot puisque Lordon l’emploie –, exige que l’on s’attaque à la perversité psychologique des relations sociales, peaufinées au fil du temps par le système néolibéral. « La sortie des rapports sociaux du capitalisme ne nous fait pas sortir de la servitude passionnelle », analyse-t-il. Au-delà de la transformation marxienne, il faut aussi substituer la raison à la passion. Une raison qui admet que l’appropriation, c’est-à-dire la rivalité entre les hommes, n’est pas le but. D’où cette conclusion : « Le communisme est une longue patience » et « un effort continu » qui s’apparente au conatus de Spinoza. Lordon est un sage. Et son livre, une passionnante réflexion proposée à tous ceux qui ne se résignent pas.
Pour aller plus loin…

« La science est la meilleure alliée des luttes pour la santé environnementale »

Cette encombrante démocratie

Palestine : quatre auteurs pour l’histoire







