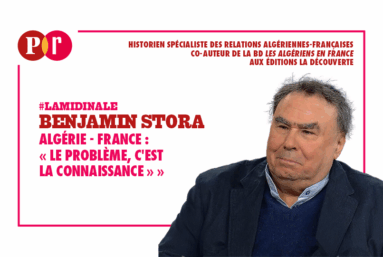L’intelligence collective de la société
Les politiques à gauche
doivent travailler en étroite relation avec les citoyens
et les associations, seule façon de réussir vraiment à faire
de la politique autrement.
dans l’hebdo N° 1168 Acheter ce numéro

« Politique autrement ». Depuis vingt-cinq ans d’utilisation, ces mots sont vilipendés, synonymes d’utopie et d’éloignement de la vraie vie. Pourtant, face à l’abstention, à la crise de confiance généralisée des citoyens pour le personnel politique, qui oserait penser qu’il n’est pas urgent de faire « autrement » ? Mais que cela veut-il dire, au-delà de quelques questions sensibles comme le cumul des mandats, la représentation de la diversité ou la parité ?
Prenons en vrac les questions des salles de consommation pour toxicomanes, de la vidéosurveillance, des installations temporaires dans des immeubles vacants ou sur des friches longtemps inoccupées, de l’accessibilité des villes et des bâtiments. Elles sont considérées par la politique « routinière » comme secondaires quand la politique « autrement » souligne qu’elles rendent visible la nécessité de réponses concrètes à la crise du logement, à celle de la santé publique, au manque d’espaces verts, à la construction d’une société du bien-vivre ensemble. Réponses proches du vécu quotidien des citoyens et raisonnables en matière de dépenses de l’argent public.
Par exemple, investir dans des salles de consommation est une économie à moyen et à long terme sur les dépenses de santé : un toxicomane « débutant » pris en charge précocement coûtera moins cher au bout du compte. Installer des caméras à tous les coins de rues coûtera des millions (à l’échelle de Paris) et des milliards (à celle de la France), alors que la moitié du même budget suffirait à développer la prévention, l’embauche de personnels spécialisés dans les commissariats, etc. S’attaquer au lourd chantier de la mise en accessibilité des lieux publics permet de réfléchir à la nature de nos villes, à qui elles sont autorisées et ouvertes, et ouvre l’accès à la citoyenneté d’une partie délaissée de la population.
Défendre ces réponses à moyen et à long terme, économes, efficaces et constructives, c’est, pour la politique autrement, assumer trois choses. D’abord, qu’il est nécessaire de sortir de « la » réponse, unique et quasi miraculeuse — l’angélisme n’est pas là où on le croit ! –, qui serait « la » solution. Ensuite, qu’il faut garder à l’esprit que le temps de la réalité sociale n’est pas celui du politique, limité à l’échéance électorale. Et qu’enfin — contrairement à ce que croient les populistes –, les citoyens ont l’intelligence de comprendre que, dans nos sociétés complexes, aux problèmes intriqués et imbriqués, le simplisme ne résout pas leurs difficultés.
La promesse électorale est facile et légère, mais que vaut-elle dès lors qu’elle ne s’appuie sur rien de tangible ? Les politiques doivent être en capacité de construire des programmes éloignés des slogans réducteurs et des promesses qui, dans un premier temps, flattent les évidences de l’électorat, font plaisir à soi-même et aux autres, mais qui, une fois abandonnées ou — pire ! — appliquées, ne font que décevoir, creusant encore plus le fossé avec les citoyens.
Mais tout cela n’est possible que si les propositions présentées aux citoyens sont construites en étroite collaboration avec ceux et celles qui sont en premier lieu concernés par les enjeux. Cela revient à mettre fin au mythe de l’« homme politique omniscient ». Si, par exemple, il y a quinze ans, nous proposions avec les jeunes des Verts les solutions qui semblent maintenant évidentes à tous sur les questions des drogues — salles d’injection, légalisation du cannabis, etc. –, ce n’est pas que nous savions tout : c’est que nous avions tout appris des associations d’usagers, Act Up, Asud, le Circ et d’autres.
De même, je peux témoigner qu’aujourd’hui mes propositions d’élue sur la vidéosurveillance, sur l’accessibilité universelle, sur la sexualité des personnes handicapées naissent des réflexions menées, parfois depuis des années, par des associations ou des collectifs, et de la rencontre avec les personnes, les « vrais gens » qui ont vécu ces questions, parfois au plus profond de leur être.
La politique « autrement », c’est aussi dire à ces collectifs, ces associations, ces personnes : « Inversez le flux : “utilisez” les élus pour porter ces problématiques sur le devant de la scène publique et politique. » C’est cet aller-retour incessant qui développe la question, chaque passage, chaque échange enrichissant les réponses à apporter. Au bout de deux ans d’exercice du pouvoir, Jospin et son gouvernement rompaient les liens avec les mouvements sociaux — chômeurs, sans-papiers… –, devenant timides et sans imagination, préparant une déception qui serait fatale au candidat socialiste en 2002.
Une victoire durable de la gauche en 2012 n’est possible que si les élus écolos sont capables d’emmener dans leurs cartables parlementaires (et de le faire partager à d’autres) cet aspect de la politique autrement : dialoguer avec l’intelligence collective de la société.
Pour aller plus loin…

Michaël Fœssel : « Nous sommes entrés dans un processus de fascisation »

Rose Lamy : « La gauche doit renouer avec ceux qu’elle considère comme des ‘beaufs’ »

Sur le protectionnisme, les gauches entrent en transition