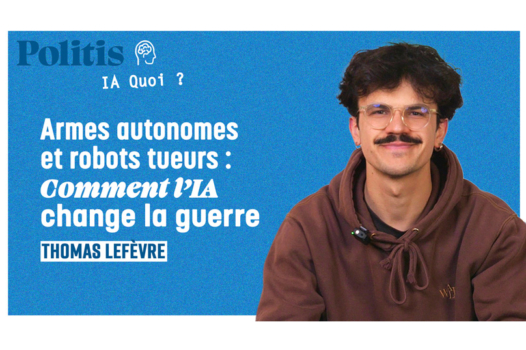Vlan, dans les dents
La France s’entête à utiliser des plombages au mercure, pourtant limités ou interdits dans de nombreux pays.
dans l’hebdo N° 1175 Acheter ce numéro
Les pays scandinaves ont interdit l’usage des amalgames dentaires. Le Conseil de l’Europe a adopté en juin dernier une résolution qui les restreint, voire les prohibe. Et la plupart des pays d’Europe en ont considérablement réduit l’utilisation. La France est aujourd’hui le seul pays de l’Union à s’opposer encore à l’arrêt de ces matériaux d’obturation.
Les dentistes de l’Hexagone continuent ainsi à poser 70 % de « plombages » pour traiter les caries. Ceux-ci sont constitués à 50 % de mercure, métal lourd et toxique pour les dentistes comme pour les patients, qui se libère sous forme de vapeurs, notamment après mastication, et va se nicher dans l’organisme : sang, système nerveux, cerveau…
« Le mercure élémentaire est neurotoxique, génotoxique, immunotoxique, reprotoxique, perturbateur endocrinien… » , alertent les associations ATC Toxicologie, Non au mercure dentaire et le Réseau environnement santé (RES), réunis le 28 octobre à Paris pour alerter sur « la position incohérente et isolée de la France » . Alors que se tient, jusqu’au 4 novembre à Nairobi et sous l’égide de l’ONU, une conférence internationale sur le mercure dentaire, la communauté internationale négocie un traité d’interdiction.
Les pays africains ont adopté une résolution en faveur d’une dentisterie sans mercure, et le gouvernement de Barack Obama s’est prononcé en avril 2011 pour une suppression progressive des amalgames. Comment expliquer l’entêtement de la France ? « Même schéma que pour le Mediator » , tranchent les associations qui dénoncent « l’incurie de la matériovigilance » française et le poids des lobbies. « Les métaux lourds restent un grand problème de santé publique dans ce pays, déclare Jean Huss, député honoraire du Luxembourg, auteur du rapport du Conseil de l’Europe sur “Les risques sanitaires des métaux lourds” (mai 2011). Le mercure est le plus problématique, loin devant le plomb… »
« On est plus ou moins sensible au mercure, et plus ou moins capable de l’éliminer, précise Marie Grossman, conseillère scientifique de Non au mercure dentaire. D’où la difficulté de définir des doses minimums. » « Mais, devant l’accumulation de centaines d’études internationales, la toxicité du mercure n’est scientifiquement plus discutable » , ajoute André Cicolella du RES.
La France continue malgré tout de se fonder sur un rapport de l’OMS de 1997, réalisé par le lobby dentaire, et sur une étude de l’Afssaps datant de 2005. Or, d’une part, l’OMS vient de réviser sa position ; d’autre part, l’étude de l’Afssaps a souffert d’un véritable « défaut de compétence » et se « contredit elle-même » . Une nouvelle étude serait en cours.
« On sous-estime l’importance des professions dentaires en France et l’explosion du marché de la carie » , rappellent les associations. « Les maladies professionnelles liées à l’exposition au mercure sont bien documentées » , mais les premiers exposés sont sous-informés et non formés. Si les dentistes disposent à présent de protocoles de précautions, ceux-ci ne sont ni obligatoires ni contrôlés. Il existe des alternatives aux amalgames : pansements constitués de résines composites, verre ionomère, céramiques…, mais elles ont longtemps été considérées comme plus coûteuses et moins solides alors qu’elles sont seulement plus longues à poser. D’où la réticence des dentistes.
En attendant l’émergence de ce nouveau scandale sanitaire, les associations conseillent un peu de bon sens, comme par exemple éviter de courir se faire retirer tous ses amalgames au risque de libérer d’un coup une forte dose de mercure dans la bouche ; ou bien éviter de poser des plombages chez les femmes qui sont enceintes ou allaitantes, ainsi que chez les enfants ; ne pas se faire poser des couronnes à intervalles trop réduits.
Par ailleurs, la France ne distribuant pas de tests de dépistage du taux de mercure, il faut trouver un généraliste sensibilisé qui puisse prescrire des examens (salive, urine, sang) et interpréter les résultats.
Pour aller plus loin…

Stand Up for Science : face à la menace Trump, des scientifiques américains sortent du silence

« J’essayais de faire au mieux, sans penser aux conséquences pour moi »

Cancer du sein : le tabou du travail