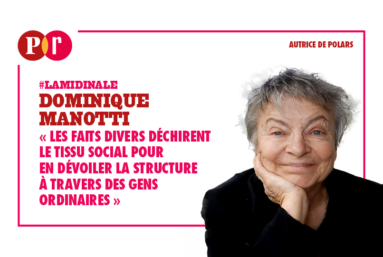Un tribunal pour l’écologie ?
L’idée d’une juridiction spécialisée a été formulée à Rio, mais renvoyée à un futur lointain. Autre piste : la Cour pénale internationale pourrait élargir ses compétences.
dans l’hebdo N° 1212 Acheter ce numéro
Pendant les mois précédant le sommet de la Terre, en juin à Rio, un groupe de juristes internationaux mené par Michel Prieur, directeur du Centre international de droit comparé de l’environnement, installé à Limoges, a travaillé sur la question de la mise en place d’un tribunal de l’écologie. Une juridiction qui, à l’image de la Cour pénale internationale, pourrait se saisir ou être saisie d’un « crime contre l’environnement ». Selon Michel Prieur, ce travail, pourtant commandé par les Nations unies, n’a pas été pris en compte, ne serait-ce que dans une phrase ou une allusion de la déclaration finale du sommet !
Les grands textes législatifs internationaux – Conventions de Genève et attributions de la Cour pénale internationale (CPI) –, qui portent essentiellement sur les guerres civiles ou les conflits entre États, ne contiennent pas d’article qui permette clairement de juger les personnes ou les États accusés d’avoir mis à mal des ressources naturelles. Un seul paragraphe d’un article mentionne des « dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel », mais la qualification de « crime » y est soumise à tant de conditions qu’elle n’est quasiment pas applicable. Rien d’autre sur l’environnement, et le terme « écocide », forgé pour caractériser l’épandage de l’agent Orange sur le Vietnam au début des années 1970, ne figure ni dans le vocabulaire de l’ONU ni dans les conclusions de la conférence de Rio.
Pour Michel Prieur et les participants aux journées de « La terre inquiète » organisées par Edgar Morin, il paraît urgent de créer un tribunal permanent qui organiserait d’authentiques procès des graves atteintes à l’environnement, avec obtention de « condamnations morales […] pour alerter l’opinion ». « Puisque les États ne font rien, à la société civile d’exiger des comptes ». Pour que ce projet voie le jour, il faut que des fonds importants soient mobilisés, mais ses défenseurs affirment que cette justice organisée par la société civile ou sous son contrôle peut être mise sur pied en quelques mois. Une autre solution existe, qui serait d’obtenir la modification de la liste des incriminations dont dispose la CPI. En 1997 et 1998, les Italiens, qui en accueillaient la conférence fondatrice, y étaient favorables. Mais l’idée d’inclure les dégâts écologiques ou environnementaux aux côtés des « crimes de guerre » et des « crimes contre l’humanité » a été repoussée par la majorité des États. « Il faudrait trop de temps pour aboutir, objecte Michel Prieur, c’est un énorme effort de négociations pour quelques lignes, et il faut qu’un pays le propose. Pour l’instant, personne ne s’est porté volontaire. »
Une amélioration du texte de la CPI paraît pourtant plus plausible que d’éventuelles condamnations morales, quel que soit leur retentissement médiatique. Elle permettrait d’élargir la compétence de la Cour : des dégâts provoqués par des entreprises ou des États en temps de paix jusqu’aux conséquences des conflits sur l’environnement et les ressources naturelles. Les dernières guerres entre États ou guerres civiles ont entraîné en effet des dégâts environnementaux immenses et « durables » : obus et bombes à l’uranium appauvri au Kosovo, en Irak ou en Afghanistan ; marée noire au Liban consécutive au bombardement de la centrale électrique de Tripoli ; déversement clandestin de déchets chimiques au large de la Somalie, pollutions de l’eau et de l’air de Gaza liées au blocus israélien, etc. La CPI pourrait se saisir de ces dégâts environnementaux car ils ont fait l’objet de rapports du département « post-conflict » du Programme des Nations unies pour l’environnement (Pnue). Mais les diplomates négligent toujours les conséquences des conflits.
Cette question a agité la société civile à Rio, mais elle a été repoussée dans un futur lointain. Comme la question des réfugiés climatiques, qui ne sont pas reconnus par le Haut Comité aux réfugiés, l’idée de condamner des entreprises ou des chefs militaires qui détruisent le milieu naturel continue de fâcher. Claude-Marie Vadrot
Pour aller plus loin…

Une famille en guerre contre Monsanto

« La science est la meilleure alliée des luttes pour la santé environnementale »

Algues vertes : un combat sans fin