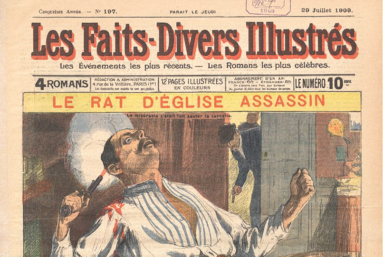La domination, selon Max Weber
Le sociologue Yves Sintomer a élaboré l’édition critique de la Domination , ouvrage inédit en France de Max Weber.
dans l’hebdo N° 1292 Acheter ce numéro
Partie centrale d’ Économie et société, l’un des plus importants ouvrages de Max Weber, la Domination était curieusement jusqu’ici inaccessible aux lecteurs francophones. Enfin traduite par la germaniste Isabelle Kalinowski à partir de la plus récente édition allemande des œuvres complètes, désormais exhaustive et critique, la Domination sera suivie prochainement de deux autres volumes, la Ville et les Communautés, également inédits en français et issus du même ouvrage majeur de celui qui est considéré comme l’un des « pères fondateurs » de la discipline sociologique.
Comment se fait-il que ce texte primordial soit resté inédit aux lecteurs francophones ?
Yves Sintomer : Il est en effet assez incroyable que l’œuvre majeure de la sociologie politique de Max Weber n’était toujours pas disponible en français presque un siècle après sa parution. C’est vrai qu’en France, on a tendance à traduire souvent tardivement les œuvres étrangères – et pas toujours très bien. Mais, plus précisément, en ce qui concerne Weber, son œuvre a été méconnue, sans doute du fait de réticences, d’un côté, de l’école française de sociologie – c’est-à-dire autour de Durkheim –, de l’autre, des marxistes – qui voyaient Weber comme un concurrent. Et ceux qui l’ont introduit en France, autour de Raymond Aron notamment, à partir des années 1960, n’étaient pas des fanatiques de sa sociologie de la domination parce qu’elle n’allait pas dans le sens libéral, qu’ils appelaient de leurs vœux… On peut ajouter que Pierre Bourdieu s’est beaucoup servi de Weber, mais n’a pas vraiment fait d’efforts pour le faire traduire. La situation a bien changé depuis deux ou trois décennies, et la plupart des œuvres importantes sont aujourd’hui disponibles en français, mais le texte majeur que constitue la Domination restait inédit. Il est maintenant disponible aux lecteurs francophones et nous avons pu, avec Isabelle Kalinowski, nous fonder sur une nouvelle édition allemande critique qui permettait de revenir au texte initial.
Vous parlez, dans votre introduction, d’une sociologie « empirique », mais aussi conceptuelle, qui ne repose en rien sur les outils des travaux actuels de sociologie, c’est-à-dire des enquêtes de terrain, des entretiens… Est-ce là une des marques de l’œuvre de Weber ?
Il faut penser qu’au moment où il écrit cela, on est encore aux aurores de la sociologie comme discipline. Il n’y a pas encore de chaire de sociologie en Allemagne, ni en France ; il y en a en revanche aux États-Unis ou en Angleterre. Si l’on voulait un peu caricaturer, on a eu, d’un côté, un travail à partir des méthodes quantitatives, inauguré notamment par Durkheim qui fait un usage, disons, conceptuel des statistiques, de l’autre, des grandes enquêtes de terrain, avec la sociologie américaine, notamment l’école de Chicago, à partir des années 1910, 1920 ou 1930. Enfin, ce que fait Max Weber, c’est apporter une série de concepts, une approche de sociologie historique qui croise étroitement un regard sur l’histoire et un comparatisme qui échappent aussi bien à ce qu’était l’histoire événementielle classique qu’à l’histoire « universelle », pensée comme un développement ordonné ayant un aboutissement unique et que les nations devaient emprunter en suivant les mêmes étapes.
Max Weber distingue des grandes typologies de domination. Comment cela fonctionne-t-il ?
Weber déploie une typologie des formes de la domination – ou plutôt « des » typologies différentes. Il différencie ainsi ce qui est devenu tout à fait classique aujourd’hui : les dominations traditionnelle, légale et charismatique. La question étant toujours de savoir : qu’est-ce qui poussent les gens à obéir à d’autres personnes qui sont au-dessus d’eux et qui leur donnent des ordres ? Weber donne trois réponses. D’abord, on obéit parce que c’est la tradition ; cela a toujours été comme cela. On a été habitué de tout temps à suivre des règles et on continue de la sorte. La deuxième réponse, celle de la domination légale-bureaucratique, est qu’on obéit parce que l’ordre donné suit les règles en vigueur. Même si, contrairement à la tradition, ces règles peuvent évoluer, être modifiées. Cette première dichotomie renvoie bien sûr à une opposition sociétés traditionnelles/sociétés modernes, même si la domination légale existait dans la Chine ancienne et que des dominations traditionnelles perdurent de nos jours. Mais Weber introduit alors un troisième mode de domination, qui donne de la dynamique à l’ensemble : la domination charismatique. C’est l’idée que l’on obéit à quelqu’un parce qu’on croit à cette personne-là, y compris lorsqu’elle rompt complètement la tradition d’un côté, ou les règles en vigueur de l’autre. C’est un coup de génie de Max Weber d’introduire ce troisième terme, qui se retrouve aussi bien dans les sociétés traditionnelles (une rupture apparaît avec un prophète, ou un chef de guerre) que dans la modernité politique, dans un monde de plus en plus enserré par les mécanismes bureaucratiques. Il suffit de penser à ce qui s’est produit au XXe siècle…
Pour autant, contrairement à l’image de la domination qu’on peut percevoir aujourd’hui, les facteurs économiques apparaissent fort peu présents…
Sur l’économie, Weber suit largement Marx, en pensant que l’économie a un rôle fondamental dans les sociétés, et en particulier dans les sociétés modernes. En revanche, il refuse l’idée que le reste de la société serait « déterminé » de façon univoque par l’économie. Pourquoi l’économie est-elle relativement au second plan dans la Domination, où elle apparaît néanmoins très souvent ? Parce que c’est d’abord un livre qui s’attache à la domination politique. La focale est mise essentiellement sur la personne ou le groupe qui conduisent l’État.
De même, dans cet ouvrage, Weber ne s’intéresse pas, ou très peu, aux dominés. La part belle est toujours laissée aux dominants. Est-ce parce que, né en 1864, il serait d’abord un homme du XIXe siècle ?
Je ne pense pas que l’on puisse l’expliquer par l’époque, car à la même période, il y a d’autres théoriciens qui vont braquer leur caméra sur les dominés. Le marxisme au début du XXe siècle est extrêmement productif, avec des auteurs comme Rosa Luxemburg ou Antonio Gramsci. Côté libéral, Stuart Mill, au XIXe siècle, insiste largement, sous l’influence de sa compagne, sur l’émancipation des femmes. Et la compagne de Max Weber fait partie d’un mouvement féministe. Il y a dès cette époque des mouvements et des théoriciens qui regardent « par en bas ». Ce n’est pas, il faut le reconnaître, le point fort de Weber. Il n’analyse pas, ou peu, les résistances, quotidiennes ou extra-quotidiennes, ni les révolutions. Il a un regard qui, tout en étant critique, adopte le même angle que celui des dominants. Il est clair que Weber ne se place pas du côté de ceux d’en bas et que c’est l’une de ses limites. C’est une vue élitiste, qui était alors largement partagée par la sociologie à l’époque – c’est d’ailleurs autant le cas en France, chez Durkheim, Tarde ou un psychologue social comme Le Bon. L’intérêt de Weber est de constituer un défi impressionnant pour toute pensée démocratique ou radicale. Il dit que la politique se fait avec des chefs. De même, il explique que les partis de masse, qui émergent à cette époque et qu’il est le premier à analyser dans toute leur complexité et leur variété, sont des machines dirigées par des chefs et qu’il y a bien peu de démocratie là-dedans… La politique peut-elle être pratiquée et pensée autrement ?
Pour aller plus loin…

« La science est la meilleure alliée des luttes pour la santé environnementale »

Cette encombrante démocratie

Palestine : quatre auteurs pour l’histoire