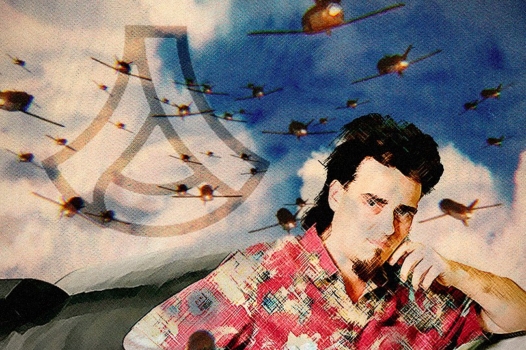APB : ce logiciel qui détermine l’orientation des lycéens
La plateforme « Admission Post Bac », loin de l’idéal méritocratique du système éducatif français, ne traite pas les élèves sur un pied d’égalité.

Ce jeudi 15 juin, 379 580 lycéens vont plancher sur l’épreuve de philosophie du baccalauréat général, ce diplôme clé qui ouvre les portes de l’enseignement supérieur. Avant même de réviser les épreuves, les futurs bacheliers ont dû passer par le portail Admission Post Bac (APB). Cette plateforme centralise et gère l’offre, c’est-à-dire les quelque 12 000 formations de l’enseignement supérieur, et les demandes des 853 262 candidats, qui en classent jusqu’à une vingtaine selon leurs préférences. Devenu, depuis son lancement en 2008, l’étape obligatoire pour l’orientation scolaire, APB reste un outil flou qui désavantage certaines candidatures au profit d’autres.
Un système opaque
En avril 2016, l’association Droits des lycéens soulignait l’opacité de la sélection opérée par APB : « Lorsque l’on s’est inscrit en terminale, nous nous sommes rendu compte que les critères de sélection de la plateforme étaient très vagues, explique Clément Baillon, ancien président de l’association. La preuve : ils étaient mentionnés en trois lignes dans le guide, sans plus de détails. » Et pourtant, l’algorithme effectue bien une sélection entre les candidats : non pas dans les formations dites sélectives (classes préparatoires aux grandes écoles, IUT…), qui trient elles-mêmes les candidats grâce à leurs dossiers, mais dans le secteur universitaire, théoriquement ouvert à tous.
« Sur APB, j’avais mis en vœu numéro 1 une licence de psychologie à la faculté de Paris V Descartes, où je rêvais d’étudier, et je n’ai pas été prise », témoigne Clara, 25 ans, qui s’est du coup reportée sur son vœu n° 2 : un BTS Carrières sanitaires et sociales. La jeune fille ne comprend pas : « Je pensais que l’université était ouverte à tous les élèves sans distinction. » C’est en effet l’une des premières caractéristiques du secteur universitaire, mais fautes de places et de moyens, une sélection est opérée malgré tout à l’entrée.
Université en tension
Les formations les plus demandées deviennent sélectives : on parle de filières « en tension » où le nombre de candidats dépassent le nombre de places disponibles. Cette année, 169 filières ont utilisé le tirage au sort pour sélectionner les candidats, contre 78 en 2016. Résultat : 3 500 lycéens qui avaient pourtant mis en premier vœu une formation universitaire se retrouvent, après la première phase des résultats d’admission, sur liste d’attente.
Lorsque l’on regarde les taux de satisfaction après les premiers résultats, le 8 juin, les filières en tension apparaissent de suite : 93 % des candidats à avoir mis en premier vœu la Première année commune aux études de santé (Paces) ont été pris dans cette formation, 76 % en droit, 70 % en psychologie et seulement 54 % en sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps).
Les Parisiens prioritaires pour les universités parisiennes
La plateforme obéit à l’article L 612-3 du code de l’éducation, qui précise les critères de sélection, appelés règles prioritaires, pour l’entrée à l’université : il s’agit du domicile et de la préférence de l’élève. Se trouvent donc prioritaires sur une filière en tension les élèves l’ayant placée comme vœu numéro 1 et dépendant de la même académie. Il est donc plus facile pour un lycéen parisien d’accéder aux facultés prestigieuses de Paris, que pour celui qui est scolarisé dans une autre académie.
Mais la publication du code source de l’algorithme qui gère la plateforme, que Droits des lycéens a finalement obtenu au bout de six mois, a révélé d’autres failles du système.
En effet, les élèves des lycées français à l’étranger sont traités comme « des VIP qui, quel que soit le rang du vœu de la formation, sont sûrs de l’avoir », analyse Guillaume Ouattara, ingénieur et blogueur sur Lemonde.fr. Ces lycéens ont un traitement spécial puisqu’ils sont réaffectés automatiquement dans l’académie de la formation choisie et donc prioritaires. À l’inverse, les « néoréorientés » – les étudiants déjà à la fac qui se réorientent en passant par APB – sont traités « ensemble différemment », comme l’indique le code. Le ministère de l’Éducation a expliqué que ces étudiants dépendent des traitements internes de l’université – notamment des passerelles mises en place entre les formations. Ils sont donc mis à l’écart par la plateforme, comme l’a révélé l’examen du code source. Dans les filières où les places sont limitées, cela joue beaucoup.
Pressions sociales
Plus encore que l’algorithme, c’est l’outil même d’Admission Post Bac qui pénalise les élèves issus de milieux défavorisés. L’organisation de l’orientation par cette plateforme demande en effet d’élaborer une stratégie. Les lycéens doivent hiérarchiser leurs vœux, mais, attention, s’ils sont acceptés pour leur premier souhait, les autres s’annulent. Dès lors, que mettre en premier ? La formation qui nous plaît le plus ou celle où l’on a le plus de chance d’être accepté ?
À cela il faut ajouter qu’avec la réforme de la plateforme en 2015 – après que 7 000 bacheliers se sont retrouvés sans affectations –, elle est devenue plus « angoissante » analyse la sociologue Sophie Orange. « Le système est anxiogène : il y a un code à appréhender, des nouvelles règles à comprendre… Et puis, le taux d’échec selon le bac obtenu apparaît lorsque l’on clique sur une formation. Tout cela tend à formater et à décourager certains élèves, notamment ceux des filières professionnelles dont le taux de réussite est plus bas que la moyenne dans les universités. » Une forme de sélection par omission qui s’ajoute à celle d’APB.
Pour aller plus loin…

Stand Up for Science : face à la menace Trump, des scientifiques américains sortent du silence
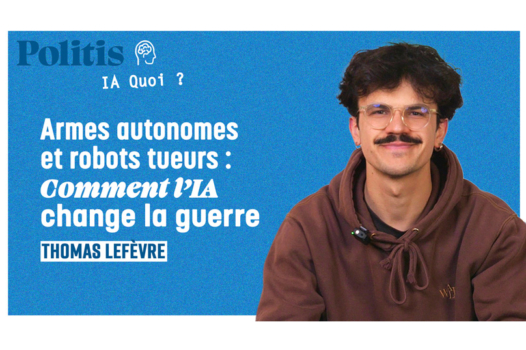
Armes autonomes et robots tueurs : comment l’intelligence artificielle change la guerre

Comment la guerre par drones redessine les champs de bataille