Smartphone : « Le désir jamais assouvi d’être ici et ailleurs »
Spécialiste des usages des technologies, Francis Jauréguiberry analyse les conséquences sociales de la connexion permanente.
dans l’hebdo N° 1479 Acheter ce numéro

Craint-on à ce point la solitude pour que notre esprit s’arrime si facilement à l’écran de notre smartphone ? Pour Francis Jauréguiberry, qui a notamment étudié l’influence des objets connectés sur nos manières de voyager [1], le smartphone a modifié notre rapport au monde, notre manière d’interagir avec les autres, nos choix et nos prises de décision.
Les technologies de masse ont toujours transformé notre rapport au temps et à l’espace. Qu’est-ce qui différencie l’essor du smartphone de celui de la télévision, de la radio, du télégraphe ou de l’imprimerie ?
Francis Jauréguiberry : La différence la plus visible réside dans la très grande rapidité d’expansion des smartphones, alors que les autres technologies ont mis parfois plusieurs dizaines d’années à faire partie de notre quotidien. Cela indique que le smartphone répond à des attentes : pouvoir communiquer avec n’importe qui où que l’on se trouve, inscrire une continuité dans les relations inter-subjectives en faisant fi de l’espace-temps. Je parle dans mon travail de « don de semi-ubiquité » : c’est ce qui fait sa spécificité. Dans un même appareil est condensée une part de plus en plus importante de notre rapport au monde. Que ce soit dans le domaine des idées, de l’actualité, de nos contacts affectifs ou professionnels.
Dans votre livre sur le voyageur du XXIe siècle, vous vous êtes intéressé aux différentes stratégies de déconnexion volontaire pour échapper au quotidien, tout en gardant contact avec lui. Est-ce que ces stratégies se retrouvent dans d’autres domaines ?
Oui, ce type de stratégies existe aussi au travail. Ce n’est pas par altruisme que certains DRH s’intéressent à la déconnexion. Ils se sont aperçus que certains services fonctionnaient mal parce que les employés passaient trop de temps à répondre à des sollicitations qui n’étaient pas essentielles. D’où la proposition, dans certaines entreprises, de « pauses zen » pendant lesquelles les employés sont invités à se déconnecter. Mais créer une pause pour accroître la productivité n’est pas une nouveauté : la « pause-café » a été inventée par General Electric dans les années 1930.
Pendant des années, j’ai observé dans les entreprises qu’il y avait d’un côté ceux qui ont le pouvoir de se déconnecter, et de l’autre ceux qui sont continuellement branchés, avec le devoir d’être performants en permanence.
Comment ces sollicitations transforment-elles l’individu et sa manière d’interagir avec les autres ?
Quand tout s’accélère et se bouscule, le branché, placé en état d’urgence quasi permanent, court deux risques. Non seulement il faut toujours être connecté, mais il faut aussi pouvoir répondre rapidement : cette accélération diminue le temps de réflexion, et l’accessoire peut ainsi recouvrir l’essentiel. L’information devient alors bruit, la vitesse précipitation, et les passages à l’acte font office de décisions. D’actif et réfléchi, le choix devient réactif et improvisé, et a donc toutes les chances d’être dépendant.
Le second risque est de se mettre à hésiter dans l’urgence. Les prises de décision deviennent alors autant de violences que l’individu s’impose dans une situation qu’il ne maîtrise plus. C’est ce que j’appelle le « syndrome du branché », qui renvoie à l’anxiété du temps perdu, le désir jamais assouvi d’être ici et ailleurs en même temps, la peur de rater quelque chose d’important, l’insatisfaction des choix hâtifs et la confusion due à une surinformation éphémère.
Ce syndrome révèle-t-il une crise existentielle plus profonde ?
Notre rapport aux autres transite de plus en plus en volume et en intensité par le smartphone. On constate un certain refus du silence, car celui-ci peut être vécu comme une peur de manquer une opportunité. C’est aussi un réflexe individualiste pour prouver que l’on existe. Le smartphone n’a de cesse de notifier que vous êtes une « bonne personne » dans une société qui n’a par ailleurs rien à nous dire sur le sens de la vie et de la mort. Avec l’affaissement des religions, la crise du scientisme et des idéologies, une partie de la population se retrouve dans une soif d’attestation de l’existence qui passe par la reconnaissance.
Le smartphone permet aussi la distraction pour empêcher ce qui est ressenti comme un vide. Nous l’observons dans la gestion de l’attente : à la terrasse d’un café, au lieu d’observer notre environnement et, éventuellement, d’interagir avec lui, il permet d’optimiser notre temps. À une strate supplémentaire, le smartphone est vu comme une évasion de nous-mêmes : il rend possible l’évitement du sens de notre existence. D’ailleurs, lorsque des personnes parviennent à se déconnecter, nous notons une forme d’appel d’air impliquant la nécessité de donner du sens à tout ce qui constitue le quotidien. Nous sommes des acteurs et des consommateurs de plus en plus performants, mais cette course qui consiste à ressembler à un algorithme n’est pas porteuse de sens.
Vous parliez des terrasses de café : le smartphone transforme-t-il l’espace dans lequel nous nous trouvons physiquement ?
Lorsqu’un individu utilise son smartphone dans les lieux publics, plus les réactions sont nombreuses et négatives, plus la réputation du lieu renvoie à une civilité sensible, à une atmosphère de sympathie sociale et à une ambiance positivement vécue : il y a un goût du lien social en public. À l’inverse, moins les réactions sont nombreuses et négatives, plus la réputation du lieu renvoie à sa simple disposition fonctionnelle, à une approche instrumentale de ses services.
Il existe aussi des lieux où, spontanément, les personnes mettent leur smartphone en mode silencieux. Cela signifie simplement que, dans la redécouverte de ce qui se vit là, au présent, il n’y a pas besoin d’autre chose. Ce moment crée d’ailleurs l’expérience d’une survaleur de présence. Nous le voyons par exemple lorsque, au cours d’une discussion entre deux personnes, l’une des deux montre de manière discrète – mais visible – qu’elle coupe la sonnerie de son téléphone.
Cela signifie-t-il que, même lorsque le smartphone n’est pas utilisé, il parvient à travailler notre quotidien ?
Oui, absolument. Puisque nous sommes dans une société de connexion généralisée, éteindre votre smartphone est significatif, car il fait que la réalité que vous vivez ne sera pas exactement la même. Nous ne pouvons plus faire comme si nous étions dans un monde où le fait de rester déconnecté est normal.
Cette « connexion généralisée » a aussi transformé notre rapport à l’inconnu…
L’inconnu, par définition, est quelque chose qui surgit. Ce qui nous pousse à rester connectés, c’est aussi l’attente de quelque chose que nous ne connaissons pas mais qui pourrait arriver. Si nous avons des difficultés à nous déconnecter, c’est aussi parce que, potentiellement, l’inconnu peut passer par le smartphone. J’appelle ce phénomène « l’advenance ». Nous sommes confusément en attente d’un inconnu qui pourrait surgir via notre écran. Pourtant, si nous restons constamment branchés, nous signifions aux personnes inconnues des lieux que nous traversons que nous ne sommes pas attentifs à elles. En retour, elles ne vous parleront pas. C’est très paradoxal : l’advenance vous pousse à être branché, mais le fait d’être branché vous coupe peut-être de choses qui auraient pu advenir si vous ne l’aviez pas été.
Notre liberté était souvent affectée par les inégalités sociales face à l’accès au numérique. Désormais, dépend-elle, à l’inverse, de notre capacité à nous en détacher ?
La première fracture numérique relevait de l’équipement informatique. La seconde concernait davantage l’usage du même équipement par les individus. Elle faisait intervenir des problématiques liées aux accès économiques, professionnels et relationnels. Aujourd’hui, la grande question est celle de l’aide à la décision au travers des algorithmes prédictifs, dont les recommandations arrivent à nous essentiellement par le biais des smartphones. Mais je pense que nous avons les capacités individuelles et collectives pour être critiques face à ce qui nous est constamment « offert ». Le grand enjeu est là.
[1] Le Voyageur hypermoderne. Partir dans un monde connecté, écrit avec Jocelyn Lachance (Érès, 2016).
Francis Jauréguiberry Sociologue, professeur à l’université de Pau, ancien directeur du laboratoire Société, Environnement, Territoire du CNRS.
À lire aussi dans ce dossier :
• Attention à votre attention !
Pour aller plus loin…
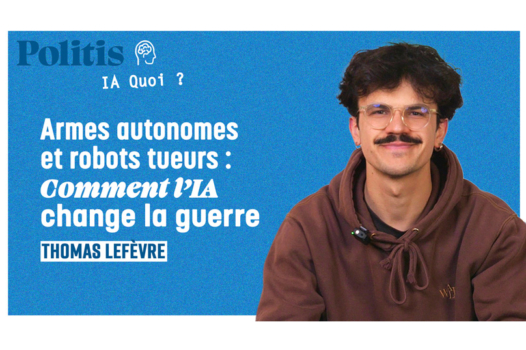
Armes autonomes et robots tueurs : comment l’intelligence artificielle change la guerre

Comment la guerre par drones redessine les champs de bataille
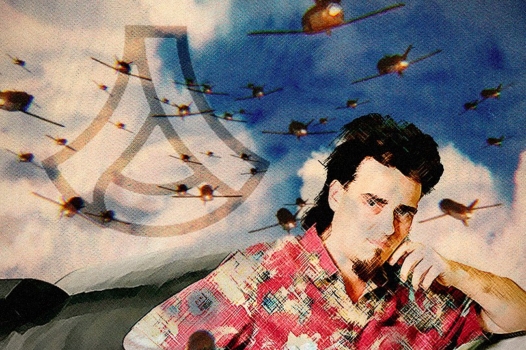
Anduril, la start-up de la guerre qui recrute sur internet







