Corbyn contre la fuite en avant néolibérale
Alors que le Brexit s’enlise, Thierry Labica analyse la stratégie du dirigeant du Labour pour en finir avec l’ère Blair.
dans l’hebdo N° 1538 Acheter ce numéro
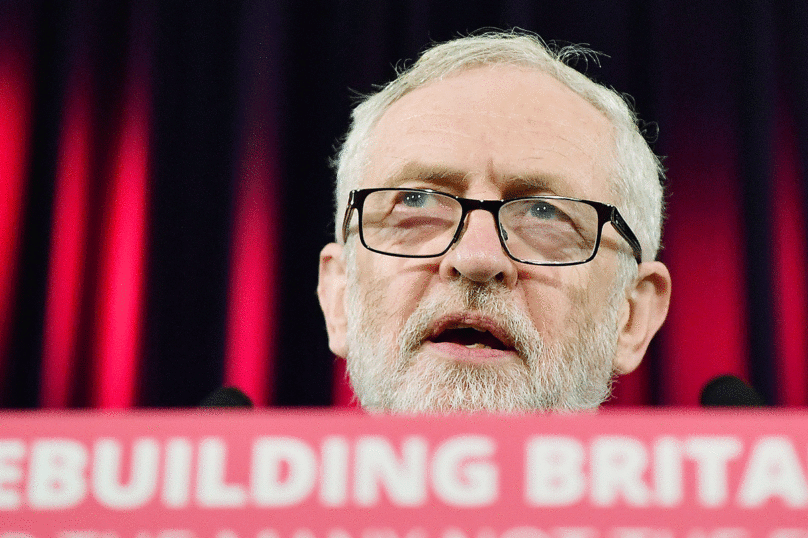
Membre du comité de rédaction de la revue Contretemps, fondée autour de Daniel Bensaïd, Thierry Labica est un spécialiste de la gauche britannique. Il a notamment codirigé l’ouvrage de référence Ici notre défaite a commencé. La grève des mineurs britanniques (1984-1985), paru chez Syllepse en 2016. Il détaille ici les enjeux du Brexit dans le jeu politique outre-Manche et, en particulier, ceux qui impliquent la gauche travailliste et son leader, Jeremy Corbyn.
La Première ministre Theresa May devra-t-elle composer avec les travaillistes afin qu’ils votent au Parlement pour l’accord qu’elle a conclu avec l’Union européenne, refusé par une importante minorité des conservateurs ?
Thierry Labica : Sa seule tactique semble être de jouer la montre afin de contraindre le Parlement à voter l’accord avec l’UE avant le 29 mars (date fixée du Brexit), en affirmant qu’il n’y en a pas d’autre possible. La perspective d’un Brexit dur, sans aucun accord (« no deal »), met une pression sur sa majorité et son opposition, massivement opposées au « no deal », mais aussi sur les négociateurs européens. C’est une sorte de bluff, comme au poker – ou, pour le dire autrement, de chantage politique.
Pourquoi le Labour craint-il tant un « no deal » ?
Ce que redoutent la direction travailliste et les syndicats, c’est qu’un Brexit sans accord avec l’UE permette une fuite en avant déréglementaire encore pire que ce qui existe. Ils craignent que les quelques normes européennes en vigueur en matière de limitation du temps de travail, de conditions de travail, mais aussi de protection de l’environnement, passent à la trappe.
Jeremy Corbyn défend un alignement britannique sur les normes européennes en termes de santé et de sécurité au travail, mais aussi en ce qui concerne la mobilité des personnes. Or il y a plus de quatre millions de citoyens européens qui travaillent en Grande-Bretagne, avec des secteurs économiques entiers qui dépendent d’eux, comme l’agriculture ou l’horticulture, qui emploient beaucoup de travailleurs peu qualifiés et peu payés, généralement d’Europe de l’Est.
Il y a aussi les universités anglaises qui, elles, emploient des personnels de l’UE hyper-qualifiés : certains départements scientifiques ne fonctionnent que grâce à ces enseignants et chercheurs venus d’Europe continentale. En outre, les ressources pour la recherche universitaire dépendent énormément des crédits issus du programme européen Horizon 2020. Les facs anglaises sont donc très angoissées aujourd’hui à l’idée d’un « no deal ». Sans oublier que le Royaume-Uni pense ouvertement ses universités comme des parts de marché de produits à l’export ou des flux de capitaux, avec des étudiants étrangers prêts à payer un maximum pour accéder à ses prestigieuses universités ; cela représente quelque 2,5 milliards de livres sterling (2,9 milliards d’euros).
En 2016, le référendum sur le Brexit a en partie été conçu par les conservateurs comme une manœuvre pour gêner les travaillistes. Va-t-il finalement produire le résultat inverse et porter Jeremy Corbyn au pouvoir ?
Il est trop tôt pour le dire. Mais, au regard des trois ans écoulés, la position de Corbyn au sein du Labour s’est considérablement renforcée. Il est arrivé en 2015 en étant très minoritaire et s’est retrouvé à la tête du parti sans charpente politique solide. Composer l’équipe gouvernementale d’opposition – le shadow cabinet – a d’emblée été très difficile. Puis, parmi ceux qu’il avait trouvés, une bonne partie a démissionné par la suite pour le mettre en difficulté et tenter de lui faire quitter la direction du parti. Sans compter ceux qui lui ont tiré dans le dos, notamment avec des accusations ridicules d’antisémitisme.
Depuis, Corbyn a réussi à constituer une équipe qui lui est beaucoup plus loyale et surtout, au sein du Comité exécutif national [l’organe dirigeant] du parti, il a maintenant une majorité forte derrière lui, provenant de la gauche du parti. La secrétaire générale du parti, Jennie Formby, est une ancienne dirigeante du syndicat Unite, très proche de Corbyn ; elle a succédé à Iain McNicol, qui était le pire des blairistes centristes inconséquents. En outre, l’organisation populaire qui a soutenu l’élection de Corbyn, Momentum, compte plus de 40 000 membres et se montre extrêmement active, en produisant des films et en déployant toute une activité de communication et de propagande.
Surtout, il faut rappeler que les effectifs du parti, tombés à moins de 150 000 membres en 2010, sont montés à 550 000. S’il y avait un énorme problème sur l’Europe au sein du Labour, on verrait beaucoup de gens le quitter ; or ce n’est pas le cas ! Enfin, il y a le résultat des élections de 2017 (1), où les travaillistes ont connu leur plus forte progression (+ 9,6 %) depuis 1945 et la victoire de Clement Attlee. Même les plus hostiles à Corbyn, notamment parmi les députés élus, ont de plus en plus de mal à critiquer sa ligne : certains avaient gagné en 2015 avec 300 voix d’avance mais, en 2017, ils ont remporté leur siège avec 8 000, 10 000, voire 12 000 voix d’avance selon les circonscriptions. Compliqué pour eux de critiquer la direction ! C’est le signe que la position de Corbyn et de l’actuelle direction est très bien implantée.
Qu’a vraiment changé Corbyn dans la ligne du parti ? Est-il en capacité de faire mentir le fameux « Tina » (« There is no alternative ») de Thatcher, qui avait fini par convaincre certains dirigeants travaillistes à l’époque Blair ?
Ce qui fait taire le « Tina », même sans Corbyn, c’est d’abord l’effondrement des présupposés qui dominaient depuis les années 1980 et qui ont conduit à la crise de 2008. Est totalement remise en cause l’action des gouvernements travaillistes au pouvoir, avec le développement insensé des partenariats public-privé et des contrats de délégation de service public (qu’il a fallu racheter par la suite), et surtout l’accroissement des inégalités, qui atteignent un niveau alarmant.
Au regard de ces éléments, Corbyn arrive à un moment où ce qu’il propose est devenu audible à une échelle de masse. La situation économique, sociale et morale est si critique que tout ce qui était considéré comme évident en termes de consensus entre les classes à l’époque de Blair et même sous Thatcher (privatisations, confiance dans la gouvernance des banques) ne fonctionne plus. La crise de 2008 a été le coup de grâce !
Toutefois, contrairement à ce prétendent les conservateurs et ce qu’il reste des blairistes, Corbyn n’a pas un programme des plus radicaux. Il le voudrait sans doute plus radical, mais il doit composer avec un environnement politique, même au sein du Labour, beaucoup moins à gauche que lui. On parle d’ailleurs beaucoup de « renationalisations » de services publics, ce qui ferait croire à un retour aux politiques d’après-guerre. Or Corbyn, qui était déjà critique du tout-État dans les années 1970 – comme la « deuxième gauche » française –, laisse le Labour produire un grand nombre de textes qui proposent une diversification des formes de la propriété sociale (avec des conseils des usagers) et du monde du travail, associant les organisations syndicales, des formes coopératives et des considérations environnementales. C’est un peu le modèle des biens communs qui a la faveur de la majorité du Labour aujourd’hui. Et c’est évidemment insupportable pour les conservateurs et tous les néolibéraux de droite et de « gauche »…
Chantal Mouffe, l’une des théoriciennes du « populisme de gauche », est proche du Labour, elle est intervenue au congrès de Liverpool en septembre 2018. Corbyn s’inscrit-il dans cette stratégie ?
Je ne crois pas qu’il emprunte cette voie, si c’en est une. Corbyn est profondément enraciné dans des mouvements sociaux qui défendent une orientation extraparlementaire de l’action directe (de façon pacifique), avec des grèves, des manifestations, etc., tout en jouant pleinement son rôle de parlementaire. Il ne cherche absolument pas à jeter le discrédit sur les élites et le système politique en général. Même s’il développe une critique très forte des élites, il ne joue donc pas « le peuple » contre « la caste ». Il ne se place pas dans un schéma où il y aurait un homme providentiel contre un système institutionnel uniformément corrompu. C’est d’ailleurs un homme très affable, d’un style tout à fait britannique, finalement, qui essaie d’éviter les conflits, ou en tout cas les ruptures, et fait tout pour souder le plus grand nombre de parlementaires, en dépit des divergences, autour de sa direction, afin de prendre le pouvoir avec toutes les composantes de son parti.
(1) Juste après avoir enclenché le compte à rebours du Brexit, Theresa May a provoqué des élections anticipées, en juin 2017, où les conservateurs ont perdu la majorité absolue à la Chambre des communes.
Thierry Labica est maître de conférences en études britanniques à Paris-Nanterre. Son nouvel ouvrage, L’Hypothèse Jeremy Corbyn. Une histoire politique et sociale de la Grande-Bretagne depuis Tony Blair, préface de Ken Loach (Demopolis, 428 pages, 23 euros), sera en librairie le 7 février.
Pour aller plus loin…

Portfolio : À Jinba, en Cisjordanie occupée, une vie rythmée par les attaques de colons

En Cisjordanie occupée, la vie clandestine des habitants de Jinba

« Les Démocrates ne reprendront pas le pouvoir à Trump sans livrer bataille »







