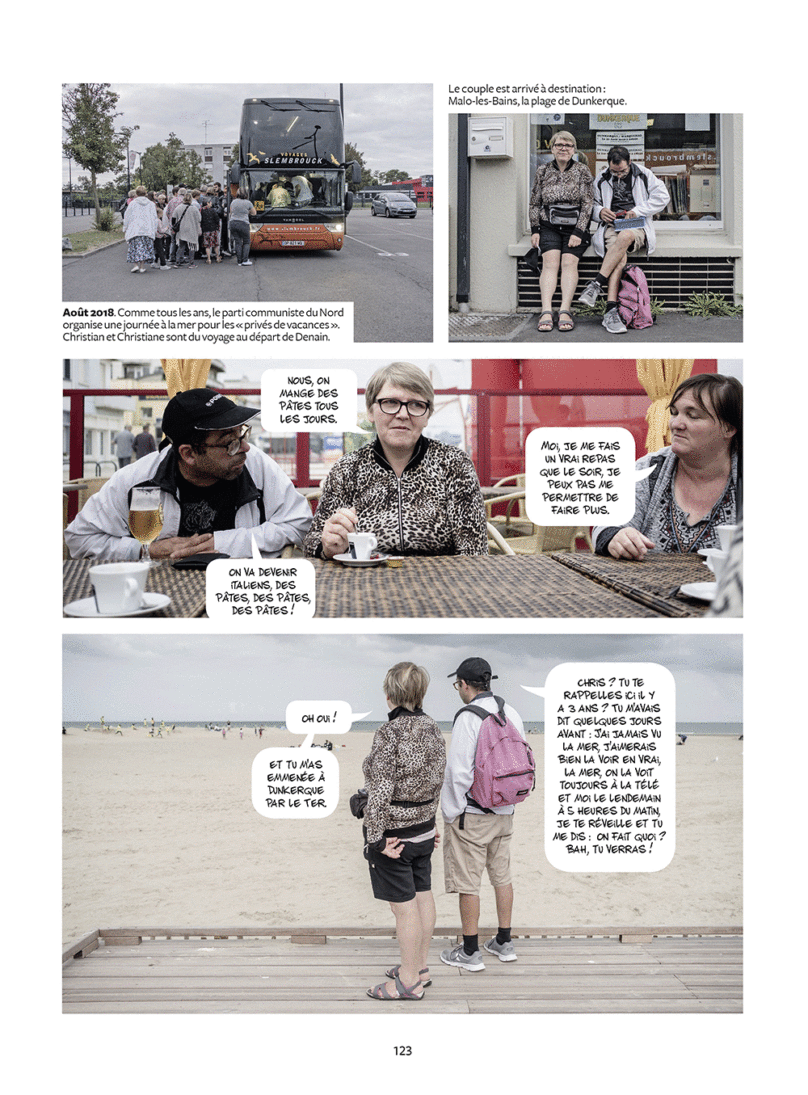Cette France d’en bas
Dans un roman-photo âpre, Les Racines de la colère, Vincent Jarousseau brosse un tableau des classes populaires dans un territoire meurtri, entre hier et aujourd’hui.
dans l’hebdo N° 1545 Acheter ce numéro
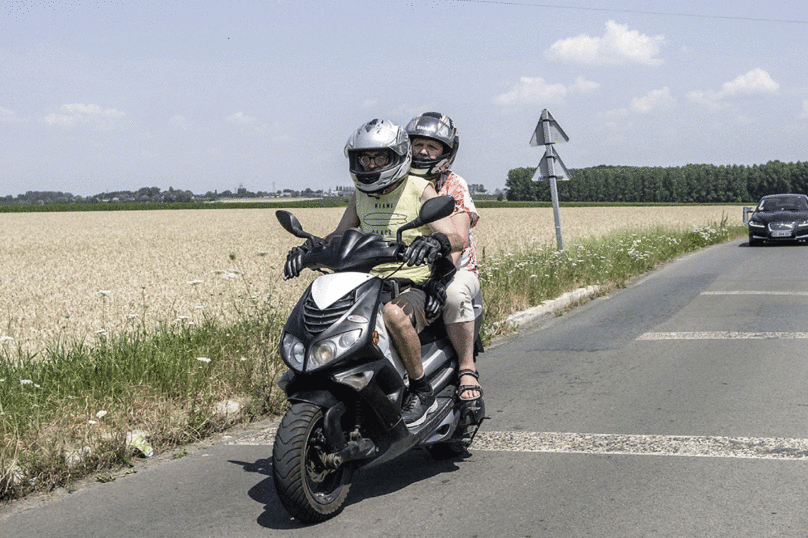
Au printemps 2016, Emmanuel Macron, alors ministre de François Hollande, lance son mouvement En marche ! Le choix de ce nom est lourd de sens. C’est une injonction : il faut bouger pour s’en sortir », écrit Vincent Jarousseau en préambule à ce roman-photo, Les Racines de la colère – clin d’œil évident au roman de Steinbeck. Quelques mois avant l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République, le photographe est arrivé à Denain, petite cité d’environ 20 000 habitants, dans le nord de la France, à trois encablures de Valenciennes. Objectif : raconter les gens, partir à la rencontre de ceux qui ne lui « ressemblent pas, non pour juger mais pour comprendre », raconter des trajectoires dans une ville particulière, qui a perdu un tiers de sa population et s’apprête à se donner au Front national, rapporter les distorsions entre un discours politique et médiatique prégnant et les réalités sur le terrain.
À lire aussi >> Vincent Jarousseau, profession sismographe
Denain est une petite ville qui n’a rien de fantôme mais qui vit avec les stigmates de son passé – comme le retrace dans un chapitre liminaire une courte bande dessinée d’Eddy Vaccaro. Au cœur d’un vaste bassin industriel, entre mines de charbon et sidérurgie, les lieux ont connu leur apogée dans les années 1970. Dans cette période de plein-emploi, Usinor s’affichait en fleuron de la production d’acier sur un site long de dix kilomètres. Denain comptait alors quatre cinémas, autant de dancings, une prospérité sans égale. Jusqu’à ce qu’en 1978 la direction décide la suppression de 5 000 emplois sur les 6 790 de l’usine. Un monde qui s’écroule pour des milliers de familles. Manifestations et affrontements suivront. En vain. François Mitterrand ayant abandonné l’idée d’une nationalisation, le site ferme ses portes en 1985. Il est entièrement démonté et réinstallé en Chine. Aujourd’hui, la ville crève de ses blessures. Avec un taux de chômage de 34,7 %, un taux de pauvreté de 44,5 % et un niveau d’études où les sans-diplôme représentent 47,2 % des habitants. Les promesses non tenues et la faiblesse des politiques publiques n’ont jamais redynamisé le bassin.
Au second tour de l’élection présidentielle, quand Vincent Jarousseau planche déjà sur son reportage, Marine Le Pen devance largement (57,46 %) Emmanuel Macron (avec un taux d’abstention de 34,47 %). « Denain est emblématique de cette France que certains ont qualifiée de “périphérique”, observe le photographe. Ni complètement urbaine ni rurale, éloignée des centres de décision et du pouvoir, Denain, c’est la France des plans sociaux, de l’abstention et du vote FN, des habitants qui s’organisent en une sorte de “contre-société”, attachés pour certains à l’enracinement social et familial, à des valeurs traditionnelles. On est très loin du projet présidentiel d’En marche ! et de ce qu’il valorise, à savoir la mobilité. »
La mobilité, justement, a présidé en partie à la réalisation de ce travail, dans le cadre d’un projet mené avec le Forum vies mobiles, un institut de recherche, cependant que le photographe s’attache à documenter les fractures abîmant l’Hexagone. Où cette fameuse mobilité se veut une condition essentielle pour obtenir un emploi, quand on n’a pas la chance de « traverser la rue » pour en trouver un, entravée par la société et ses règles économiques, juridiques, sociales.
Le travail de Vincent Jarousseau s’avance ainsi jusqu’en décembre 2018, encastrant une galerie de portraits, une poignée de familles, de petites gens brinquebalées par l’âpreté du réel, saisies dans leur rapport au boulot, au chômage, au temps, à la ville, au manque, au juste-pas-assez, à l’injustice pour qui ne va ni au restaurant ni en vacances. Soit un traitement rare sur des invisibles, présentés par des associations, croisés au hasard dans un tram, au café, au supermarché ou simplement au seuil d’une porte. Chez qui il va loger. Un traitement au long cours qui exige de parler, d’échanger, propre à la photographie documentaire. Mais sous une forme particulière.
Les Racines de la colère est un roman-photo. Parti pris esthétique qui explose à la gueule du lecteur. « Plus qu’un procédé, c’est une narration, explique l’auteur. Et extrêmement pertinente sur ce type de travail, parce que l’objectif est d’emmener le lecteur dans ces familles autrement que dans une narration écrite où l’on parle à la place des gens, où l’on est dans l’interprétation. » Dans Les Racines de la colère, chaque propos inséré dans les bulles est celui des protagonistes, enregistré par le photographe. « Il y a un langage visuel, un langage des corps dans ce procédé, entre le reportage filmé et l’image fixe. »
Pour Laurent Muller, éditeur aux Arènes, directeur de cet ouvrage, le roman-photo est « un mode narratif différent et vivant, qui donne la parole aux gens avec un souci de véracité, sans filtre, qui se prête aux sujets forts, politiques et sociaux. Le texte dissocié de la photo ne fonctionne pas aussi bien. Il y a là une instantanéité efficace. Ça nous amusait aussi de casser les codes classiques du roman-photo, ceux de la série B ou de Choron dans Hara-Kiri, de Nous deux, des publications tournées vers l’horreur, le roman à l’eau de rose, avec un contenu plus soutenu et social ». Un genre faussement désuet « qui n’a jamais disparu des kiosques, rappelle Laurent Muller, ou bien qui a périclité, suivant la crise de la presse, comme d’autres titres ».
En termes de planches et à l’image, voilà d’abord Loïc, qui a vécu les boulots dans les usines de production automobile à la chaîne avant de passer un CAP de cuisine, aujourd’hui en contrat d’insertion à temps partiel, à 810 euros net mensuels, galérant pour financer son permis de conduire. Puis Tanguy, comme beaucoup d’autres contraints d’aller chercher un emploi toujours plus loin, qui parcourt jusqu’à cinq cents kilomètres chaque nuit pour livrer des brioches dans les Hauts-de-France, payé 1 600 euros, tandis qu’Adrien se déplace d’un chantier à l’autre, selon les commandes d’Eiffage. D’autres encore s’adaptant au développement de la sous-traitance, à l’externalisation des activités de maintenance industrielle.
C’est aussi Emmanuelle, dite Manu, 48 ans, touchant 694 euros de RSA, qui vit seule avec sa fille de 12 ans, Auréline, et son fils de 19 ans, Valentin, qui perçoit une allocation de 484 euros par mois, suivi par la Mission locale dans le cadre de la garantie jeune. Pour lui : pas de permis, pas de boulot. Pour la cadette, les vacances se passent chez son grand frère, à Marcq-en-Barœul, dans la banlieue lilloise. C’est encore un couple de quinquagénaires au revenu net de 850 euros (entre l’allocation pour adulte handicapé et l’aide personnalisée au logement), à qui il reste 400 euros par mois « une fois qu’on a payé le loyer et les factures obligatoires ». Dans la mouise quotidienne, le ric-rac des jours, à 5 euros près. Des trognes cassées, taillées au scalpel, dérouillées, mais parfois coiffées ciselées au carré, avec la raie sur le côté, qui ne sont pas sans rappeler les trublions tragicomiques de Bruno Dumont et son P’tit Quinquin, entouré de kékés. Sauf que là on ne rigole pas dans les chaumières (faute de chaumières).
Des portraits de rebuts et recalés, qui disent la misère (culturelle, sociale, économique), cette misère digne qui tient encore debout, qui n’entend pas se coucher. Des portraits qui exhalent la peur du lendemain, la peur de l’autre, de l’étranger, transpirent aussi la méfiance envers les médias traditionnels et une colère à l’égard des pouvoirs politiques. « La carte d’électeur, je l’ai déchirée, s’exclame Christian. Ça sert à rien ! Macron, il a dit qu’il en avait marre de claquer plein de pognon, et pendant ce temps-là il supprime l’impôt sur la fortune, c’est pas normal ! Nous, on nous baisse l’APL, les allocations, ça me bouffe la gueule, il faudrait faire un nouveau Mai 68. »
Autant de foyers où la télévision est continuellement allumée, où s’additionnent les promos traquées dans les supermarchés, les dons du Secours populaire. À l’extérieur, les rues alignent leurs kilomètres de maisons en briques rouges, un stand de tir ambulant attire quelques bougres, des chalands refusant la défaite intime, visant des bribes de divertissement. Les terrils ne sont jamais très loin, comme les fameux pavés de Paris-Roubaix, passant par Denain, juste avant la trouée d’Arenberg.
Avec un travail étiré jusqu’en décembre dernier, c’est tout naturellement que la boîte noire du photographe s’est faite l’objet témoin des gilets jaunes, illustrant quelques planches de ce roman-photo, pas seulement sur les ronds-points. Vincent Jarousseau est resté à l’intérieur des foyers, cadrant les réflexions, les colères, les amertumes, les peines et les revendications des uns et des autres. Celle d’une France oubliée, des gens d’en bas de l’échelle sociale, qu’on ne voit pas, qui décrochent. Dans la fleur des nerfs de la réalité. Aux confins des justesses, terriblement actuelle.
Les Racines de la colère. Deux ans d’enquête dans une France qui n’est pas en marche, Les Arènes, 168 pages, 22 euros.
Vincent Jarousseau présentera son livre lors d’une conférence autour de la mobilité des classes populaires, aux Archives nationales, Paris IVe, le 28 mars, à 18 h 30. Inscription sur fr.forumviesmobiles.org
Pour aller plus loin…

« Il existe une banalisation des pratiques non conventionnelles de soin »

« Avant, 70 % des travailleurs géraient la Sécu. Aujourd’hui, c’est Bayrou. Voilà le problème »

L’atelier Missor dans le moule du combat civilisationnel