Des écrans de fumée ?
J’aborderai dans ce billet les éléments de préoccupations et les controverses qui concernent l’effet des interfaces numériques sur le développement des enfants. L’omniprésence des écrans constitue-t-elle en soi une modification de l’« écosystème éducatif », un perturbateur environnemental susceptible d’exercer un impact non négligeable sur la construction psychique de la génération digitale native ?
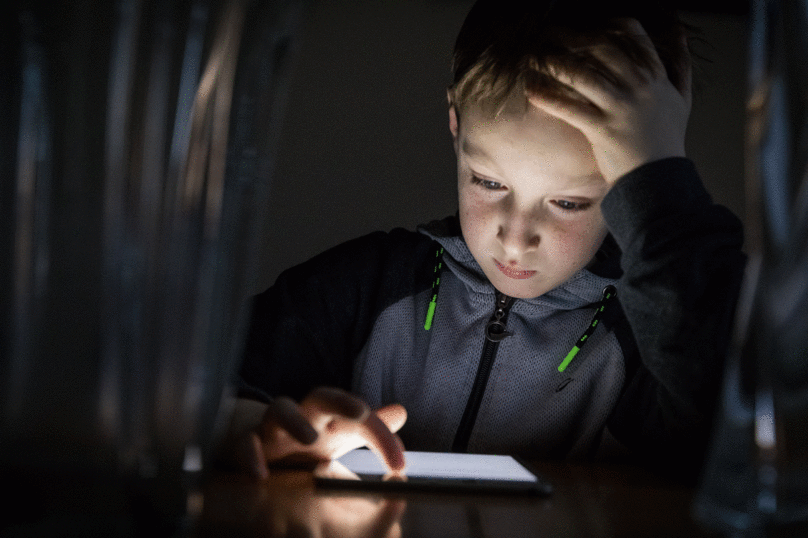
Pour commencer, voici quelques données épidémiologiques brutes :
Le nombre d’enfants scolarisés entre 2 et 11 ans souffrant de troubles intellectuels et cognitifs, de troubles psychiques ou de troubles du langage est en très forte augmentation alors que les chiffres des troubles visuels, auditifs ou moteurs restent stables. Depuis 2010, les troubles ont progressé respectivement de 24 % pour les troubles intellectuels et cognitifs, de 54 % pour les troubles psychiques et de 94 % pour les troubles de la parole et du langage. Une telle hausse ne peut raisonnablement être uniquement rapportée à la seule amélioration du dépistage ou de l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap.
Par ailleurs, une étude rapporte une baisse de 3,8 points du QI des français entre 1999 et 2009.
Entre 1980 et 2007, le diagnostic de trouble hyperactivité avec déficit de l’attention a augmenté de près de 800 %.
Aux États-Unis, la population infantile diagnostiquée pour un trouble bipolaire a augmenté d’un facteur 40 entre 1994 et 2003, la prévalence passant officiellement de 1,3 à 7,3 pour 10 000 habitants.
Les dernières estimations américaines en arrivent maintenant à une prévalence de troubles du spectre autistique de 1,7 %, soit un enfant de 8 ans sur 59 (en 2016, un enfant sur 68 était concerné).
En France, 17 % des jeunes entre 15 et 29 ans rentraient dans la catégorie des NEET en 2017 (Not in Education, Employment or Training, c’est-à-dire sans formation, diplôme ou travail). Parmi ceux-ci, 460 000 sur une classe d’âge de 10,6 millions étaient définis comme « invisibles » en 2012, ni inscrits à Pôle Emploi, ni connus des missions locales, ni étudiants, etc., d’après un récent rapport sur l’insertion professionnelle des jeunes. Au sein de cette population désocialisée, on estime que plusieurs dizaines de milliers pourraient être catégorisés en tant que « Hikikomori », c’est-à-dire vivant dans une situation de retrait social complet et de réclusion au domicile.
J’arrête là l’énumération, mais ces chiffres questionnent à plus d’un titre.
D’un part, on peut légitiment s’interpeller quant à la pertinence des critères diagnostics, amenant à une forme de médicalisation à outrance de toutes les expressions comportementales « anormales » de l’enfance, des troubles des apprentissages en passant par les problèmes de conduites. De plus en plus de profils « pathologisables » sont donc identifiés dans la population infantile, avec des enjeux éthiques et civilisationnels tout à fait préoccupants. De fait, cette inflation semble s’apparier à des intérêts politiques et financiers (notamment pharmaceutiques), ainsi qu’à un désir social de diagnostic ou de reconnaissance de handicap, comme s’il y avait une attente collective, voire une forme de fantasme, à pouvoir inscrire toute déviance de conduite dans une catégorie nosographique évacuant de facto la question complexe de la responsabilité et de la culpabilité, au niveau individuel et collectif.
D’autre part, il semble évident que de tels constats doivent légitimement amener à se poser la question des conditions d’environnement au sens large à même de favoriser de telles évolutions de prévalence. On ne peut pas d’un côté dire que ces « troubles » sont d’étiologie purement génétique, et de l’autre constater la dimension quasi épidémique de certains profils en termes de santé publique. Là, il y a une contradiction dans les faits. Même si l’on peut prendre en considération certains progrès dans le repérage précoce, cela ne peut en aucun cas expliquer l’intensité explosive de certaines configurations symptomatiques.
Les classifications en viennent d’ailleurs à proposer de nouveaux troubles, ou à évoquer des oscillations entre différents diagnostics : les enfants diagnostically homeless circuleraient ainsi entre différentes catégories de troubles comportementaux, du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), au trouble oppositionnel avec provocation, en passant par le trouble des conduites, ou le multiple complex developmental disorder….
Le DSM-V propose dorénavant le diagnostic de « dysrégulation émotionnelle et comportementale » (disruptive mood dysregulation disorder ou DMDD). Ce syndrome se caractériserait par une irritabilité chronique, avec des crises de colère excessives, une hyperréactivité aux frustrations, une forte excitabilité et un déficit de flexibilité cognitive. Selon les études, sa prévalence est estimée de 1 jusqu’à 10% des enfants ! Au niveau étiologique, ce trouble serait associé à une constellation relationnelle et familiale désorganisée, favorisant un attachement insécure, une mésestime de soi et une mauvaise régulation de l’excitation. Quant aux préconisations thérapeutiques…En première intention : prescription de Méthylphénidate (RITALINE), réduisant l’agressivité et l’intolérance à la frustration – pour information, il s’agit d’un psychostimulant proche d’une amphétamine déjà indiqué pour le trouble hyperactivité/déficit d’attention, dont la commercialisation a littéralement explosé depuis une dizaine d’années, en dépit d’effets secondaires neuropsychiatriques, vasculaires, ou à type de retard de croissance (En France, les prescriptions ont augmenté de 70% entre 2008 et 2012 ; en 1995, 10% des garçons américains prenaient de la RITALINE) ….Eventuellement, on peut y ajouter des « interventions psychosociales », orientées de façon très comportementaliste. Si cela ne fonctionne pas suffisamment, on pourrait aussi ajouter du valproate de sodium (DEPAKINE, anticonvulsivant ayant des effets thymorégulateurs) ou un antipsychotique atypique (c’est-à-dire un neuroleptique), avec des risques non négligeables en termes d’effets iatrogènes.
Qui pourrait bien se frotter les mains à l’idée d’introduire des traitements médicamenteux à vie – il n’y a aucune recommandation pour interrompre ces médications une fois celles-ci initiées – chez un enfant sur 10 ? D’autant plus que ces médications sont souvent prescrites à partir de critères d’évaluation peu approfondis sur le plan clinique et thérapeutique, mais davantage sur insistance de la famille ou de l’école, à des fins de « confort ».
Les profits sont les profits, même s’il faut en arriver à enfermer un nombre considérable d’enfants dans une catégorie diagnostique potentiellement stigmatisante, écrasant toute possibilité d’appropriation subjective du comportement, et constituant dès lors une forme de prophétie aliénante…
Dans ces conditions, on imagine bien que chercher à appréhender ce qui pourrait favoriser l’émergence de nouveaux « troubles » chez les enfants depuis quelques décennies est susceptible d’être mal perçu. D’autant plus que, dans le sillage du modèle américain, l’accès aux soins et le remboursement des prises en charge ou des traitements nécessitent de plus en plus un diagnostic médical établi en amont. On en arrive donc paradoxalement à une médicalisation à outrance, dans le sens d’une intervention thérapeutique se basant sur une prescription, au moment même où l’idée de consulter un pédopsychiatre ou un psychologue pour essayer de trouver un sens à un trouble comportemental aurait tendance à être absolument décrié. Un médicament pour mon enfant, d’accord, mais on ne va quand même pas parler de ce qui se passe, il n’est pas fou.
Qu’est-ce qui a pu changer dans les conditions de socialisation des enfants, et dans le regard que portent leurs parents sur eux pour en arriver là ? Il y a forcément des facteurs sociaux, éducatifs, voire anthropologiques qui ont contribué à modifier radicalement l’exercice de la parentalité et les conditions environnementales dans lesquelles les enfants sont immergées.
Parmi les éléments éventuellement incriminés, on peut légitimement pointer l’impact des nouvelles technologies de la communication sur les modalités interactives intrafamiliales.
De fait, il suffit par exemple de contempler une publicité vantant les outils numériques pour en arriver au constat d’une mutation des configurations relationnelles au sein de la sphère domestique : on nous présente effectivement une famille manifestement heureuse – les larges sourires sont là pour en témoigner -, réunie dans un espace commun ; sauf que les regards de chacun sont littéralement captés par des écrans individuels. Ils sont ensemble physiquement, mais investissent des réalités non partagées, hermétiques, chacun étant immergé dans son propre univers, dans une communauté virtuelle externe.
Pas besoin d’être un spécialiste de la petite enfance pour observer comment le smartphone tend également à s’insinuer de façon intrusive au sein des dynamiques interactives parent/bébé. De fait, le regard et l’attention des mères et/ou des pères sont très régulièrement absorbés par leur écran, avec des effets récurrents de rupture du contact et de désynchronisation dans le lien au nourrisson. Celui-ci peut donc se sentir régulièrement lâché, désinvesti, au profit de cet étrange attracteur qui accapare son parent. Dès lors, sa perception du tiers ou de l’altérité n’est plus introduite par une personne incarnée qui mobiliserait l’investissement affectif de son parent (le père pour la mère par exemple ou réciproquement…), mais par un objet perçu comme le polarisateur exclusif des désirs de celui-ci, comme un rival susceptible d’effacer la présence du bébé dans la psyché parentale. Au risque de m’attirer certaines foudres (soyons joueur), on pourrait presque suggérer que cet objet mystérieux tend à être investi comme un phallus, c’est-à-dire comme la source symbolique d’une forme de jouissance, de complétude et d’assujettissement, au détriment du bébé. En tout cas, ces dispositifs numériques peuvent manifestement venir entraver l’accès à un « espace transitionnel », c’est-à-dire à la création commune entre le bébé et son parent d’une aire d’illusion et de jeu entre le soi et le non-soi, capable de favoriser une séparation progressive à travers l’investissement de l’imagination et d’une pensée symbolique personnelle. Au lieu de cela, le smartphone introduit une forme de dépendance sensorielle, un besoin compulsif de reconnaissance et de confirmation, comme s’il y avait là une nécessité de s’assurer de sa propre continuité d’existence, sur un mode anaclitique, c’est-à-dire en recherchant un étayage extérieur, une sorte d’échafaudage du sentiment d’identité individuelle, sous peine d’effondrement (pardon pour le jargon).
Cette absorption du parent vient ainsi faire écran aux moments partagés, vient hacher la continuité des échanges et peut ainsi entraver les boucles interactives nécessaires au développement de l’enfant. On sait pourtant l’importance de l’attention maternelle, de son investissement psychique et perceptif, à travers la voix, les mimiques, l’engagement corporel, pour organiser les flux sensoriels de l’environnement du bébé et stabiliser une forme d’intégration co-modale de la perception de soi et de l’autre, c’est-à-dire de l’intersubjectivité (vraiment désolé pour le jargon). Ainsi, la surexposition aux écrans, tant du côté du parent que de l’enfant, peut venir amputer le besoin vital d’interactions en miroir, déstructurer les synchronisations relationnelles, à cette étape cruciale du développement dite de référence sociale, au cours de laquelle l’enfant expérimente et découvre le sens de son environnement à travers le lien. L’enfant peut alors se trouver livré à lui-même pour organiser sa sensorialité et son appréhension du monde, sans intégration possible, sans filtrage, du fait d’un manque de médiation par un parent trop captif de stimulations qui le détournent en permanence et l’empêche d’être vraiment présent dans la relation.
Ce d’autant plus que c’est l’enfant lui-même, et ce dès le plus jeune âge, qui peut se trouver confronté massivement à un medium numérique qui l’expose à un flux permanent de stimulations, détaché de tout sens, et sans réciprocité. Seul face à l’écran, l’enfant digital native peut alors développer un besoin permanent de stimulations sensorielles pour combler son manque d’intériorisation de séquences relationnelles et son vide intérieur. La puissante attractivité qu’exerce ces mediums entraine effectivement une véritable captation/fascination du tout petit, au détriment de l’exploration sensori-motrice, buccale, tactile, relationnelle, etc., pourtant déterminante dans l’appréhension du corps et du monde. Dans la réalité, il peut être constaté une réduction drastique des échanges verbaux intrafamiliaux, de la dénomination des objets extérieurs, des vécus partagés, du contexte et des enjeux relationnels. Les stimulations cognitives et linguistiques des écrans n’intègrent pas les dimensions émotionnelle, corporelle et interactive, pourtant essentielles. De surcroit, la difficulté pour le jeune enfant à se dégager d’un flux perceptif continuel peut interférer avec l’investissement de la pensée et exercer un impact important quant au développement de l’attention profonde.
Évidemment, un enfant laissé de façon massive devant un écran est d’emblée victime d’une forme de carence éducative, et il parait sans doute vain de pouvoir différencier les effets de ce désinvestissement relationnel et affectif des conséquences plus spécifiques liées intrinsèquement à la surexposition aux écrans. Ainsi, les recherches montrent pour le moment que l’effet des écrans est très corrélé à d’autres facteurs de risque, au premier rang desquels le niveau socio-économique de la famille, avec un manque de stimulations environnementales. En conséquence, il y a inévitablement des intrications très étroites, et des effets de renforcement mutuel. Cependant, on peut penser que ces outils numériques favorisent ce positionnement parental et autorisent plus facilement à un désengagement vis-à-vis du lien. En effet, l’ubiquité de leur présence et de leur accès, les aspects « pédagogiques » vantés par leurs apologistes, et surtout leurs « vertus » auto-calmantes ont de quoi favoriser un recours récurrent pour raisons de « confort ». Par ailleurs, la généralisation des écrans dans tous les espaces de socialisation de l’enfant, des crèches aux écoles, banalise de fait leur usage et constitue même un encouragement tacite à une consommation permanente, tant chez les parents, que chez les professionnels, et évidemment chez les enfants exposés précocement au désir mimétique d’interagir avec ces interfaces, de faire comme les grands – on offre désormais des jouets smartphone aux enfants, histoire d’être sûr qu’ils soient accoutumés dès le plus jeune âge.
L’observation des interactions enfants/parents en salle d’attente est parfois un élément clinique très pertinent. De fait, voici une configuration relationnelle que je constate de plus en plus : le ou les parents rivés sur leur smartphone et leur enfant happé par son propre écran, avec souvent le son à fond, sans aucun échange. En outre, il est parfois difficile de réussir à détacher tout le monde, à éteindre tous les appareils de façon apaisée, pour se rendre ensemble dans le bureau de consultation…
Au final, il faut vraiment se voiler la face pour ne pas admettre que l’omniprésence des interfaces numériques et l’usage qui peut en être fait socialement constituent un potentiel « perturbateur environnemental » susceptible d’avoir des effets individuels et collectifs non négligeables en termes de santé publique infantile.
Dans les faits, une exposition massive chez des enfants en bas âge peut amener à un tableau clinique caractérisé par un déficit de la réciprocité socio-relationnelle, une rareté du contact oculaire, une absence d’appétence pour les interactions sociales, une restriction des intérêts, une avidité stéréotypée pour des stimuli perceptifs excitants. De plus, les effets délétères à long terme de la surconsommation télévisuelle chez les tout-petits sont connus grâce à l’étude longitudinale menée depuis 1996 par Linda Pagani, professeure à l’Ecole de psychoéducation de l’université de Montréal. Ceux qui ont passé plus d’une heure par jour devant l’écran entre 2 et 3 ans ont des possibilités d’attention et de concentration, des capacités d’empathie et des compétences socio-relationnelles moindres à l’âge de 13 ans.
Il est dorénavant démontré qu’une forte exposition à la télévision en arrière-plan nuit à l’utilisation et à l’acquisition des capacités verbales, à l’attention, au développement cognitif, en particulier au niveau des fonctions exécutives, chez les enfants de moins de cinq ans. Certaines études soulignent ainsi l’impact négatif sur les capacités intellectuelles, particulièrement pour ce qui est de la mémoire à court terme, des aptitudes précoces en lecture et en mathématiques et du développement du langage. Un contenu violent ou un déroulement extrêmement rapide de l’action peut également induire un effet de surcharge cognitive en termes de traitement de l’information, et interférer avec le bon fonctionnement des fonctions exécutives (attention planification, anticipation, etc.). Tous ces effets peuvent par ailleurs être cumulatifs.
Des études récentes en imagerie cérébrale par IRM menées par les Instituts nationaux américains de la santé montrent que les enfants qui utilisent des interfaces numériques plus de 7 heures par jour présentent un amincissement prématuré du cortex cérébral ; ceux qui passent deux heures ou plus par jour devant un écran obtiennent en moyenne de moins bons résultats aux tests de mémoire et de langage, avec une altération de la capacité à enchaîner des tâches cognitives et à assimiler des connaissances.
Depuis la diffusion massive des smartphones (2007), le pourcentage d’adolescents qui ont déclaré avoir bu ou eu des relations sexuelles a diminué. À l’inverse celui des déprimés ou se disant seul fortement augmenté. De même, les automutilations ont triplé chez les filles de 10 à 14 ans. Evidemment, il ne s’agit là que de corrélations qui n’impliquent eu aucun cas un rapport de cause à effet.
Peut-on alors évoquer l’émergence de troubles spécifiques liés à l’usage massif des interfaces numériques chez les enfants et adolescents ?
Dès 2012, la psychiatre américaine Victoria Dunckley a décrit un syndrome spécifique (Electronic Screen Syndrome) lié à une exposition prolongée aux écrans et caractérisé par certains regroupements symptomatiques, en rapport notamment avec un manque d’auto-régulation et de gestion du stress. Cette dérégulation amènerait à une incapacité à moduler les mouvements émotionnels, à ajuster l’attention ou le niveau de vigilance en interaction avec l’environnement. Typiquement, il s’agit d’un enfant « surexcité », présentant une grande irritabilité de l’humeur, des crises de colère, une désorganisation comportementale, une immaturité sociale, un mauvais contact oculaire, des troubles du sommeil, des difficultés d’apprentissage et des troubles mnésiques.
On retrouve quasiment trait pour trait les critères diagnostic de notre fameux syndrome de « dysrégulation émotionnelle et comportementale » (disruptive mood dysregulation disorder ou DMDD) évoqué plus haut ! Etrange coïncidence….
Le Pr Marcelli, professeur de pédopsychiatrie à Poitiers, propose quant à lui la prise en compte d’un nouveau trouble neuro-développemental qu’il dénomme « Exposition précoce et excessive aux écrans » (EPEE). Ce syndrome présent chez des enfants en bas âge associerait un retard de communication qui devient évident à partir de 2/3 ans, un intérêt devenant exclusif, une agitation et des troubles du comportement, une instabilité d’attention, des maladresses gestuelles. Cette description clinique pourrait évoquer des éléments compatibles avec le spectre autistique. Cependant, le Pr Marcelli insiste sur certains caractères spécifiques et différenciateurs : notamment l’amélioration clinique suite aux retraits des écrans ou l’absence de fuite du contact oculaire.
Ces observations amènent à une question fondamentale : l’exposition massive aux écrans d’un enfant en bas âge peut-elle favoriser en soi l’émergence de troubles psychopathologiques caractérisés, tels que l’autisme ou l’addiction ?
En mars 2017, le Dr Ducanda, médecin de PMI en Ile-de-France, a effectivement diffusé une vidéo devenue virale pour alerter sur ses observations cliniques quotidiennes : elle recevait effectivement, de façon de plus en plus récurrente, des enfants de moins de trois ans exposés massivement aux interfaces numériques (6 à 12H par jour !) et présentant des symptômes de retard développemental majeurs, au niveau relationnel, cognitif, moteur, comportemental. Cliniquement, le Dr Ducanda décrivait des signes de retard (langage, motricité fine, manipulation d’objet, etc.), des difficultés de relation et de communication avec les adultes et les autres enfants, des manifestations bruyantes d’agitation, d’agressivité et parfois d’angoisse lorsque ces enfants se voient privés de ces écrans, plus rarement des troubles moteurs discrets d’allure stéréotypique. Le Dr Ducanda évoquait alors des « signes d’allure autistique » pouvant suggérer une forme « d’autisme virtuel », en rapport avec ces conditions particulières d’environnement, et potentiellement régressive suite au sevrage des écrans. Pour cette pédiatre, ce constat clinique constituait « une urgence sanitaire dont les pouvoirs publics doivent se saisir au plus vite car l’avenir de milliers d’enfants est en jeu et le coût financier colossal. ».
Cette alerte a par la suite été relayée politiquement par la création d’un collectif « Surexposition aux écrans » et diffusée médiatiquement lors d’une émission d’Envoyé Spécial en janvier 2018. Les réactions ont pu être assez virulentes, tant du côté des scientifiques dénigrant le caractère objectif et fondé des observations cliniques du Dr Ducanda, que des associations d’autistes qui ont exprimé de vives protestations par rapport à l’usage du terme d’« autisme virtuel ». « Je ne veux pas être le gendarme de l’audiovisuel, explique Olivia Cattan présidente de l’association SOS Autisme, mais ce discours a des conséquences. Je ne doute pas que l’addiction aux écrans puisse provoquer l’isolement et des troubles du comportement mais ça ne s’appelle pas de l’autisme. L’autisme est un trouble neurologique. Est-ce qu’on parle, par exemple, de « troubles trisomiques » ? Soit on est autiste soit on ne l’est pas ! ». Certains revendiquent également les effets bénéfiques des outils numériques pour les enfants autistes, qu’ils considèrent comme des médiateurs de communication, et craignent qu’un doute puisse s’insinuer quant à l’usage de ces interfaces. Manifestement, certaines évidences ne doivent surtout pas être questionnées…Cette situation a finalement abouti à une judiciarisation, suite à des plaintes de quatre familles d’enfants autistes auprès du conseil de l’ordre des médecins. Ces actions visent à interdire l’usage des termes « symptômes d’allure autistique, ou pseudo-autisme ou faux autisme, etc… », tout en accusant le Dr Ducanda de chercher « à faire le buzz au mépris de la vérité scientifique ».
Ces réactions peuvent interpeler à plusieurs titres :
D’une part, c’est la position de lanceur d’alerte qui se trouve ainsi mise en cause. Il parait cependant salutaire qu’un clinicien de terrain puisse faire remonter ses observations cliniques ou ses hypothèses quand il estime qu’il y a potentiellement des répercussions sanitaires collectives. C’est le principe même de la pharmacovigilance, par exemple. Il ne s’agit pas prioritairement d’évaluer de prime abord une pertinence scientifique, mais de ne pas négliger l’identification d’un éventuel facteur de risque. Des études scientifiques doivent alors être menées, dans un second temps, pour évaluer la réalité des phénomènes observés du point de vue épidémiologique ou physiopathologique.
D’autre part, ce débat pointe à nouveau les stratégies d’appropriation de certains diagnostics par des intérêts privatifs, qui tendent à interdire toute utilisation d’une terminologie médicale hors des frontières qu’ils ont eux-mêmes défini. Mme Ducanda aurait-elle commis une faute médicale en utilisant le qualificatif d’autistique hors du champ défini par les associations de parents d’autiste ?
On peut certes lui reprocher un manque de prudence dans la façon d’établir des inférences univoques, un usage un peu trop cavalier du terme « autistique », ou des préconisations sans doute trop simplistes en termes d’intervention thérapeutique ne prenant pas en compte le caractère plurifactoriel des processus psychopathologiques. De fait, aucune étude randomisée n’a pour le moment établi une corrélation significative et univoque entre l’usage massif des interfaces numériques et l’émergence d’un syndrome autistique typique. Cependant, il parait quelque peu hâtif de négliger d’éventuelles prédispositions ou éléments de comorbidité sur des arguments idéologiques.
De la même façon, l’addiction digitale n’est pas un trouble défini et prouvé scientifiquement, même si on sait que certaines « patterns comportementaux induits par les écrans » sont susceptibles d’interférer avec le système cérébral dopaminergique de récompense et qu’il existe par ailleurs des corrélations significatives entre le retrait social, la dépression et l’usage massif des interfaces numériques, en particulier les jeux en ligne massivement interconnectés.
Là aussi, ce sont des signaux d’alerte à ne pas négliger, et non des preuves scientifiques. Il convient donc de réintroduire de la complexité, avec l’idée de processus multiples et fortement intriqués, associant des éléments de vulnérabilité génétique, des facteurs d’environnement, mais aussi des pratiques éducatives, relationnelles, et des modalités d’usage de certains dispositifs et outils sociaux qui orientent de façon non négligeables les comportements individuels et collectifs.
L’enjeu ne porte donc pas sur la pertinence nosographique de tel ou tel trouble potentiellement induit par l’usage massif des écrans, mais sur les risques sanitaires éventuels et sur la nécessité de mobiliser le principe de précaution, surtout lorsqu’il s’agit du devenir des enfants.
Je comprends les professionnels qui incitent à la réserve et insistent sur la pluralité des causes à prendre en compte dans les troubles de l’enfance ; on ne peut qu’y souscrire. Néanmoins, j’ai du mal à appréhender les cris d’orfraie qui surgissent bruyamment au moindre doute exprimé quant aux risques des écrans pour dénoncer une diabolisation des outils numériques.
Alors, faut-il avoir le courage de la prudence en revendiquant de façon plus volontaire une nécessaire surveillance et une régulation des interfaces numériques dans le champ de l’enfance, ou convient-il de se réfugier derrière les apanages de la pure scientificité pour préserver certains intérêts d’ordre économique ou idéologique ?
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

« Les Saumons », bulletin de l’association, édition de février 2025

« Les Saumons », bulletin de l’association, édition de décembre 2024

« Les Saumons », bulletin de l’association, édition d’octobre 2024








