Désobéissance civile : « Des actions non-violentes mais spectaculaires »
Six décennies les séparent, mais Susan George et Léna Lazare se retrouvent sur un diagnostic, celui d’une société climaticide, et sur une réponse : la désobéissance pacifique.
dans l’hebdo N° 1549 Acheter ce numéro

Elles ne se connaissaient pas mais se sont rapidement tutoyées, tout en dégustant un café noir et des biscuits. Léna Lazare savait que Susan George est présidente d’honneur d’Attac. Susan George s’est étonnée des 20 ans de Léna Lazare. Plus de soixante années les séparent et, pourtant, tant de combats les rassemblent ! Notamment le recours à la désobéissance civile pour s’affirmer dans une société climaticide. Dans l’appartement feutré de Susan George, les échanges ont parfois digressé autour de la physique quantique, la gentrification de Paris ou la menace du capitalisme vert. Mais ces deux militantes aux centaines d’histoires ont livré leur pensée sur le mouvement écologiste qui gonfle et les stratégies à adopter pour grappiller quelques victoires déterminantes pour l’avenir de la lutte écologiste.
À lire aussi >> Désobéir, l’ultime recours
Léna Lazare, vous avez fondé Désobéissance écolo Paris. Quel est ce groupe, pourquoi ce nom ? Susan George, vous avez participé au lancement d’Extinction Rebellion (XR) France en disant que vous étiez prête à aller en prison avec ses membres : cela marque-t-il une volonté accrue de désobéir ?
Léna Lazare : J’ai cofondé Désobéissance écolo Paris il y a plus d’un an car j’avais envie, avec d’autres, de passer à une forme d’action directe : organiser des réunions autour de la désobéissance civile et de l’écologie radicale, puis monter des actions. J’étais présidente de l’association Lupa (Les universitaires planteurs d’alternatives) à la Sorbonne, qui se démenait surtout pour sensibiliser à la consommation durable : créer une Amap, intégrer des plats végétariens à la cantine, utiliser des produits naturels… Nous étions passés au stade supérieur en organisant des conférences sur l’écologie politique et en devenant un groupe de lobbying à la fac. Lequel a quand même obtenu une option végétarienne quotidienne au Crous ! À l’été 2018, on a décidé avec des amis de passer deux semaines de vacances sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. J’y ai rencontré des personnes assez radicales, les éditions Libre, mais aussi des membres d’Alternatiba. Assister aux confrontations entre radicaux et moins radicaux a renforcé mon envie de sortir du symbolique. Ce même été, j’ai suivi une formation à la désobéissance civile proposée par ANV-COP 21. Des personnes étaient en train de créer Extinction Rebellion France, dont certaines se sont jointes à Désobéissance écolo Paris. Désormais, XR France existe et il se pourrait que nous menions des actions ensemble.
Susan George : Il faut absolument que vous vous unissiez ! Défendre l’importance des coalitions a été l’une de mes actions à Attac : c’est cette stratégie qui nous a permis de remporter des victoires au niveau européen sur le Tafta, par exemple. Je ne connaissais pas XR Royaume-Uni, mais en découvrant sa tactique, j’ai été séduite. Je n’ai pas concrètement rejoint XR France, mais j’ai tenu à participer à son lancement. J’ai dit à ses membres que, s’ils menaient une action qui ne réclamait pas trop d’engagement physique, ils pouvaient compter sur moi et que j’étais prête à aller en prison avec eux. Mettre en prison une dame de mon âge mobilisée pour empêcher le mal à autrui, même une entité abstraite, les médias en parleraient !
Quand avez-vous commencé à militer et à désobéir ?
S. G. : J’ai commencé par les manifestations contre la guerre du Vietnam en 1967. C’est ce qui m’a politisée : avant, j’étais une bonne fille bourgeoise venue faire ses études en France, qui avait épousé un Français et avait eu trois enfants. À l’époque, quand on disait « US hors du Vietnam », tout le monde comprenait. Aujourd’hui, quand on lutte contre les traités internationaux, il faut un quart d’heure minimum pour expliquer l’enjeu du combat : c’est plus compliqué.
Quand j’étais jeune, on ne faisait pas vraiment de distinction entre se mobiliser et désobéir. Hormis les Américains, notamment en 1999, avec les mobilisations contre le sommet de l’OMC à Seattle. Je n’ai pas participé physiquement au blocage parce que les participants étaient tous états-uniens et s’entraînaient pour cette action depuis des mois. Les organisateurs du sommet avaient fait l’erreur de choisir un hôtel pour les délégués en face du palais des congrès où ils devaient se réunir. Ils sont restés confinés dans leur hôtel car la manifestation les empêchait de traverser ! Des désobéisseurs occupaient les lieux assis et menottés et étaient rejoints par des marches syndicales et citoyennes.
L. L. : Mon engagement écologique a démarré avec la lutte antinucléaire post-Fukushima. Proche du Japon en raison de liens familiaux, j’apprenais le japonais depuis le collège. J’ai été si choquée par la catastrophe de 2011 que j’ai commencé à me documenter et à essayer de sensibiliser autour de moi. Un réalisateur de Fukushima est venu dans mon lycée et nous avons correspondu avec des lycéens japonais. Puis j’ai fait mon année de terminale au Japon. Aujourd’hui, je suis en licence de physique.
Je voulais être physicienne, mais le militantisme prend tellement de place dans mon quotidien que je cherche comment combiner mon action militante et mes études. En outre, la vie en ville dans cette société écocide me coûte. Je voudrais vivre plus proche de la nature mais les grands laboratoires sont surtout dans les grandes villes…
À lire aussi >> « Avant j’étais une écolo tranquille, aujourd’hui je flippe »
Quel sens prend pour vous cette notion de désobéissance ?
S. G. : Il faut organiser des actions non-violentes mais spectaculaires. J’ai passé des années à essayer de provoquer un laugh-in : imaginez un rassemblement devant l’Élysée avec des centaines de personnes en train de rire ! Dans une province en Inde, la population a organisé un tel rassemblement devant le palais d’un gouverneur… qui a démissionné le lendemain.
L. L. : En septembre 2018, j’ai participé à une action d’Attac pendant laquelle on aspergeait les banques au savon noir pour dénoncer le financement des industries toxiques et la pratique de l’évasion fiscale. Les banques n’apprécient pas, car cela salit leur image, mais j’ai réalisé que nous nous faisions surtout plaisir à nous-mêmes. Les faucheurs de chaises dans les banques ou les décrocheurs de portraits de Macron dans les mairies, c’est rigolo et médiatisé, mais en quoi est-ce efficace ?
Il faut donc renouveler les modes d’action ?
S. G. : Les marches restent nécessaires car elles servent encore à attirer beaucoup de monde.
L. L. : Les marches pour le climat sont un succès. Elles ont commencé en France, je le rappelle, avec celle qui a suivi la démission de Nicolas Hulot. Mais les marches hebdomadaires des jeunes sont en train de s’éteindre : on se sent inutile. Même en Belgique, où les marches sont très médiatisées, la onzième semaine de grève scolaire pour le climat n’a attiré que 500 personnes. Il faut se réinventer, mener les gens vers la désobéissance civile, monter des actions plus radicales, comme bloquer des aéroports en nous inspirant du collectif britannique Plane Stupid, qui avait bloqué Heathrow. Ou des opérations créatives, comme la fête organisée devant l’Assemblée nationale par des lycéens et des étudiants, le 12 avril, pour dire : « Vous ne nous écoutez pas, alors nous faisons du bruit devant chez vous. »
S. G. : Le bruit perturbe les réunions et interpelle les passants. Quand nous avons manifesté contre l’accord multilatéral sur l’investissement (AMI) en 1998, nous avons organisé une intervention à côté du jardin du Ranelagh, à Paris, près de l’immeuble de l’OCDE où les délégués devaient se rencontrer. Un orchestre de cuivres et de percussions nous accompagnait. Le ministre britannique est venu à la porte demander qui avait laissé des hooligans occuper ce jardin ! Ce fut la première action visible de la lutte contre les traités bilatéraux d’investissement.
Quelles sont vos références en matière de désobéissance ?
S. G. : La première action de désobéissance non-violente notoire aux États-Unis est probablement la Boston Tea Party. En 1773, des manifestants costumés en Indiens sont montés sur trois navires qui arrivaient des colonies britanniques avec 75 000 livres sterling de thé et ils ont tout jeté dans le port pour dénoncer la taxation des colonies par le Parlement de Londres. Ajoutons le « chemin de fer souterrain », ces réseaux de Blancs qui aidaient les esclaves à gagner le Nord avant et pendant la guerre civile, ainsi que le mouvement des droits civiques avec Rosa Parks, Jesse Jackson, Martin Luther King…
L. L. : En Europe, les militants d’Ende Gelände apparaissent comme les plus radicaux avec leurs actions de blocage en Rhénanie pour dénoncer l’extraction de charbon. Parmi les militants écologistes que je connais, beaucoup lisent Henry David Thoreau, auteur de La Désobéissance civile, ainsi que des livres d’écologie radicale, comme ceux de Derrick Jensen et du collectif Deep Green Resistance [partisans du sabotage environnemental, NDLR].
En Amérique latine, certains militants écologistes semblent plus radicaux, ils suivent des entraînements au maniement des armes, et il y a eu des affrontements très violents, notamment contre la déforestation en Amazonie. Je ne sais pas si l’on ferait ça en France.
Quelles limites fixez-vous ?
S. G. : Pour moi, les armes sont une frontière à ne pas franchir. Je suis absolument anti-violence contre les personnes mais aussi contre les biens. Je ne brûlerai pas une voiture, par exemple, car je ne saurais pas à qui elle appartient. Si une machine s’apprête à arracher un arbre, j’essaierai d’abord de savoir qui est le patron de l’entreprise, qui sont les membres du conseil d’administration, qui donne les ordres au conducteur…
L. L. : Je suis d’accord sur le non-recours aux armes. Je ne comprends pas que l’on puisse s’attaquer au vivant quand on est écolo. Même si je redoute que, d’ici quelques années, nous soyons contraints de devoir nous défendre. Le sabotage peut me sembler pertinent pour empêcher des abattages d’arbres, par exemple. À Romainville, des militants étaient dans la forêt chaque matin pour bloquer les machines, avant d’être expulsés par la police. Entre saboter une machine et voir trois hectares de forêt détruits, mon choix est fait.
S. G. : « L’État est détenteur du monopole de la violence physique légitime », écrivait Max Weber. C’est-à-dire la police et l’armée. Si on attaque ces gens là où ils sont le plus forts, on se met en difficulté. On a beau être jeune et robuste, il ne faut pas risquer d’être éborgné…
L. L. : Mais quoi qu’on fasse on prend des risques ! Certains de mes amis ont passé 30 heures en garde à vue pour avoir protesté avec des pancartes devant un lycée de Vanves visité par Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation, et François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire. Mon petit frère de 16 ans a pris un tir de flash-ball dans le dos par un CRS alors qu’il manifestait pacifiquement avec des gilets jaunes. Il a passé deux jours couché avec une côte cassée.
Sur quoi concentrez-vous votre propre désobéissance ?
S. G. : Depuis plusieurs années, je me suis spécialisée sur les traités de commerce à cause de l’arbitrage investisseur-État (ISDS). Pour être les plus puissants possible, les lobbys choisissent les secteurs qui touchent les citoyens directement, comme la nourriture ou la pharmacie. Voulant rester invisibles, ils ne s’affichent pas aux premières loges, mais s’introduisent partout où les décisions se prennent. C’est surtout à travers mes écrits et mes conférences sur la faim dans le monde, la dette des pays du Sud, le FMI, l’OMC, l’Europe, les traités de commerce et d’investissement que j’ai eu de l’influence. Je me considère comme une scholar activist, une militante à travers la connaissance.
L. L. : Aujourd’hui, je travaille surtout à structurer les différents mouvements. Il faudra réfléchir à des actions importantes contre des plateformes pétrolières, par exemple…
Comprenez-vous le parallèle établi par des militants entre l’envie de changer de société lors du mouvement des droits civiques aux États-Unis et la volonté actuelle de passer d’une société écocide à une société plus respectueuse de l’environnement ?
S. G. : Le racisme et l’esclavage ont laissé des traces dans les esprits, mais c’est très différent : c’était soit tolérable, soit intolérable, mais tout le monde en était conscient. Ce qui n’est pas le cas pour le climat. Reste que les luttes humaines ne vaudront rien si nous laissons perdurer la destruction de l’environnement ! Les pauvres en sont toujours les premières victimes.
L. L. : La difficulté, avec la lutte écologiste, c’est d’arriver à identifier l’ennemi. Les mouvements des jeunes font de plus en plus le lien avec la lutte anticapitaliste. Mais quand on s’attaque au capitalisme, à qui s’attaque-t-on ? Un PDG, des actionnaires, c’est remplaçable. Est-ce qu’on demande des comptes au gouvernement ? Les lobbys sont introduits auprès du gouvernement. C’est compliqué d’élaborer une stratégie contre le système…
Comment la désobéissance civile peut-elle dépasser la dénonciation d’une société climaticide ?
S. G. : Il faut aller vers ceux qui détiennent le pouvoir de la loi, qui peuvent dire non aux lobbys qui cherchent tous les privilèges et à faire profit de tout. Je me demande d’ailleurs pourquoi ils n’ont pas l’intelligence de miser sur les énergies renouvelables s’ils veulent rester en vie. Exxon sait depuis les années 1970 que le climat change…
L. L. : Nous discutons justement de savoir s’il faut lancer une campagne avec un but précis car, pour le moment, nous essayons surtout d’amener les jeunes vers la désobéissance civile. Chaque semaine, nous montons une action sur un point précis. Cela peut être une loi. Si on organise une opération dans un aéroport, nos revendications porteront sur : « Il faut taxer le kérosène », « il faut limiter drastiquement le trafic aérien ».
S. G. : Pour fédérer, il faut parler de non-assistance à société en danger en mettant les lois en cause. Les pesticides autorisés sur le marché et mélangés à toutes sortes de produits tuent… Je recommande aussi des actions sur des choses gagnables parce que tout le monde n’a pas ton enthousiasme chevillé au corps, Léna. L’action politique est longue et la victoire est rare. Gagner de temps en temps, même si la victoire paraît petite, ça donne du courage et ça en vaut la peine.
L. L. : On se demande quand même toujours si remporter une petite victoire ne va pas servir d’argument aux dirigeants pour ne pas avancer davantage…
S. G. : Cela peut faire partie de la réflexion en amont : sur les pesticides, par exemple, qu’est-ce qui fera le plus de mal à Monsanto ? La fusion avec Bayer a bien eu lieu, mais l’action en Bourse a chuté avec les différents procès, notamment celui qui s’est tenu en Californie ! Il faut faire des choses que le capitalisme comprend.
Pour aller plus loin…
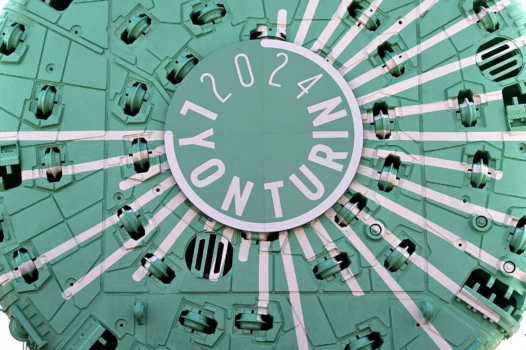
« La LGV Lyon-Turin est la quintessence du déni de démocratie »

Justice climatique : quatorze citoyens en colère

« Que l’État joue enfin son rôle avec un vrai plan d’adaptation climatique »







