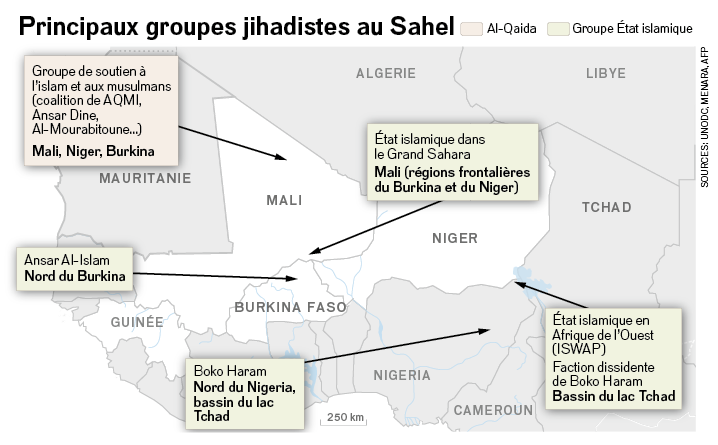« La lutte antiterroriste est une rente »
Les États du Sahel s’alignent sur le refus français de tout dialogue avec les jihadistes. Yvan Guichaoua analyse leurs motivations et éclaire les réalités régionales.
dans l’hebdo N° 1561 Acheter ce numéro

Yvan Guichaoua est maître de conférences à la Brussels School of International Studies (Université du Kent). Spécialiste du Sahel, il est l’auteur de nombreux articles et rapports sur la gouvernance sécuritaire au Mali et au Niger. Il prépare un ouvrage sur la violence politique au Sahel.
Face aux groupes armés jihadistes qui gagnent du terrain dans la région sahélienne, le Mali, le Niger et le Burkina Faso semblent avoir opté pour la même stratégie, celle de la force. Pour quelles raisons ?
Yvan Guichaoua : Le Niger et le Mali ont une tradition de gestion de la contestation politique violente faite d’usage de la force, suivi souvent de méthodes plus pacifiques sous forme de cooptation individuelle ou collective. Les jihadistes étant catégorisés comme « terroristes », le dialogue est a priori banni. Mais ce dialogue existe néanmoins officieusement à des échelons locaux. Les populations et les édiles aux prises avec les jihadistes sur leur territoire établissent des compromis de gouvernance avec eux. Les humanitaires discutent avec eux pour convoyer l’aide. C’est plus rare au sommet des États, quoique…
Au Niger, les discussions entre autorités et jihadistes sont assez courantes. Elles tournent souvent autour de la libération de prisonniers et d’otages. Au Mali, on a assisté récemment à la libération de jihadistes présumés en échange d’otages détenus par une katiba [groupe de combattants jihadistes, NDLR]. Cela montre que le lien n’est pas rompu. Mais il n’y a pas encore de dialogue politique à proprement parler. Par ailleurs, ce choix du dialogue n’est pas entre les seules mains des États concernés. Un immense dispositif international de lutte antiterroriste, articulé autour de l’opération française Barkhane, est en place, qui privilégie la force.
Officiellement, il est hors de question de négocier…
Oui, il s’agit presque d’un dogme : « On ne discute pas avec les terroristes. » Les plus rigides en la matière sont les Français. Cela peut s’expliquer par le fait que d’énormes ressources militaires sont engagées dans la zone. Entamer des discussions pourrait être perçu comme une capitulation pour les militaires. La France préfère promouvoir le « développement » et « la bonne gouvernance » des zones concernées pour ne pas donner l’impression de privilégier le tout-sécuritaire. Mais, si on voit bien en quoi consiste le versant sécurité du couple « développement/sécurité », le versant développement est nébuleux : au pire il s’agit d’action civilo-militaire améliorée, au mieux d’intervention étatique verticale, à la mode « développementaliste » des années 1960. Or le grand non-dit de la crise que traversent les États sahéliens aujourd’hui est le problème de la légitimité de ces États. Qui exerce le pouvoir ? Comment ? Quelle justice veut-on ? Voilà les questions qu’il faut se poser face à l’offensive des groupes jihadistes qui se nourrissent des défaillances des États.
D’où vient ce dogme qui empêche d’entamer des négociations avec les groupes armés ?
Pour l’armée française, les mouvements jihadistes sont des GAT (groupes armés terroristes). Vu de France, les jihadistes, qui prônent la charia et rejettent tout ce qui vient de l’Occident, sont une menace qui dépasse les frontières sahéliennes. Mais les officiels français commettent l’erreur de mettre les jihadistes sahéliens dans le même sac de la menace civilisationnelle que ceux du Yémen, de Syrie, de Libye ou même de ceux qui ont commis des attentats à Paris, en négligeant les ferments locaux de la crise, à commencer par les responsabilités étatiques. On doit déconstruire ce prisme, qui fait au passage le jeu des jihadistes locaux, toujours prompts eux-mêmes à jouer la carte du clash des civilisations.
L’articulation du local au global dans l’analyse du jihad, c’est un peu le cauchemar des observateurs, car les deux pôles s’entretiennent l’un l’autre. Mais lorsqu’on décortique attentivement les facteurs d’expansion du jihad armé dans la région, on voit bien que la diffusion guerrière suit des lignes de clivages locaux préexistants. Le jihad de Tombouctou a d’autres ressorts que celui de Tillabéri, qui a d’autres ressorts que celui de Kidal.
Cela, les dirigeants des États sahéliens le savent très bien. Pourquoi se soumettre alors à la vision française ?
C’est vrai qu’ils donnent l’impression de s’y soumettre, notamment en relayant le discours de la défense de la civilisation face à l’obscurantisme jihadiste. Mais, par-derrière, ils ne s’interdisent pas d’activer des canaux de discussion. Reste à savoir par quel bout entamer ce dialogue : par le bas ? Par le haut ? Avec qui ? Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que la lutte antiterroriste est une rente pour certains de ces États. De la même manière qu’ils accordent des concessions à des sociétés étrangères pour exploiter leurs mines, ils accordent des concessions aux armées étrangères pour assurer leur sécurité. Le Niger est un cas d’école en la matière. On y trouve aujourd’hui des bases française, américaine, italienne, allemande…
Ces postures sont-elles critiquées par les opinions publiques ?
Il est difficile de dire ce que pensent les opinions publiques. Ce qui est sûr, c’est que l’on perçoit une évolution au fil du temps. Il y a dans l’espace public une montée très nette du discours anti-français. Lors de récentes manifestations à Bamako, on a entendu des slogans très hostiles à la France. Ceci est notamment lié au fait qu’en dépit des énormes moyens mobilisés pour combattre les groupes jihadistes, la situation sécuritaire se dégrade.
Yvan Guichaoua Maître de conférences, spécialiste du Sahel.
Pour aller plus loin…

L’héritage du Pape François : réforme plutôt que révolution

Portfolio : À Jinba, en Cisjordanie occupée, une vie rythmée par les attaques de colons

En Cisjordanie occupée, la vie clandestine des habitants de Jinba