Dans les prisons, la double peine du Coronavirus
Entre absence de garanties sanitaires et violation de leurs droits, les personnes détenues ont payé les carences de la gestion pénitentiaire de la crise COVID-19.

Dans une lettre adressée à la Garde des sceaux publiée sur un blog de Mediapart fin avril, 150 proches de personnes détenues tirent la sonnette d’alarme. _« Vous feignez de ne pas entendre les nombreux professionnels du droit, associations, organisations de défense des droits des personnes détenues en France, qui sont terrifiés par la crise sanitaire et le foyer épidémiologique en puissance que représente chacune des prisons. », écrivent-ils.
Et pour Léa Proust, compagne d’une personne détenue à Rennes, et co-signataire de la lettre, « la situation commence à peine à s’améliorer ». « Les masques commencent à arriver, mais cela dépend aussi des bâtiments, explique-t-elle. Dans l’établissement de mon compagnon, il y en a moins car les personnes détenues sont plus nombreuses. »
Les équipements de protection restent en effet marginaux, confirme Amélie Morineau, présidente de l’association des avocats pour la défense des droits des détenus. « Il n’y a pas de gel, puisque l’alcool est interdit en prison et les quelques masques qui arrivaient au début étaient réservés aux surveillants. »
Des geste barrières impossible
« Faute de gel, ils ont simplement eu un peu plus de savon que d’habitude », explique Adeline Hazan, contrôleur général des lieux de privation de liberté. « Mais dans la plupart des prisons, ce sont des douches collectives, sans paroi de séparation », explique-t-elle. Dès le 17 mars, puis à nouveau en avril, la contrôleur a alerté Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, sur l’impossibilité de respecter les gestes barrières à cause notamment de la surpopulation.
Fin avril, avec les libérations anticipées et le confinement, le taux d’occupation avait chuté à 61.100 personnes incarcérées pour 61.109 places. Mais cette moyenne cache de grandes disparités. Certaines maisons d’arrêt comptent toujours trois personnes détenues pour deux places.
Résultat, les personnes incarcérées se retrouvent entassées dans des cellules de 9 mètres carrés sans possibilité de respecter la distanciation physique. « La chancellerie a fait le choix de ne jamais être claire dans les mesures à adopter. Ce n’est pas normal de devoir faire des recours devant le Conseil d’État pour avoir la moindre information sur les droits de nos clients et sur les moyens de leur protection », analyse l’avocate Amélie Morineau.
Les prisons à l’arrêt
Le 17 mars, l’annonce du confinement a signé l’arrêt des activités habituelles pour la majorité des personnes détenues, y compris le travail. « Beaucoup de gens dans les prisons dépendent de leur travail, l’arrêt des activités s’est soldé par une baisse de revenu pour la plupart des prisonniers. Or, il n’y a pas de droit du travail en prison, donc pas de chômage », déplore Mathilde Sallerin, représentante de Genepi, association pour le décloisonnement des prisons, qui estime à 200 Euros par mois, le coût de la vie d’une personne détenue en prison.
Pour faire face à cette fragilité économique, la garde des Sceaux Nicole Belloubet, a toutefois indiqué le 19 mars que « les personnes détenues les plus démunies pourraient bénéficier d’une aide majorée de 40 Euros par mois leur permettant notamment de cantiner », c’est-à-dire d’acheter de la nourriture à la cantine d’une prison.
L’arrêt des activités a également eu pour conséquence un encellulement continu des personnes incarcérées. « En maison d’arrêt, la fin des activités signifie que les personnes détenues vont passer 23 heures sur 24 à trois dans une cellule de 9 mètres carrés », explique Amélie Morineau.
Les conditions sont vraiment horribles, et ils sont dans une situation punitive sans raison. Leur isolement est inhumain.
Avec le confinement, les parloirs ont aussi été fermés et les personnes détenues n’ont pas pu voir leur famille. « Cette fermeture était indispensable pour éviter que le virus ne se propage trop vite dans les prisons », concède Adeline Hazan. Pour autant, la Contrôleur générale des lieux de privation de liberté, estime que des mesures compensatoires comme l’organisation de visioconférences ou la gratuité des communications, auraient pu être mises en place. Au lieu de ça, l’administration pénitentiaire a choisi d’octroyer des crédits téléphoniques aux personnes incarcérées.
Au centre pénitentiaire pour hommes de Rennes, les détenus ont reçu 40 € pour les communications. « Cela permet à peine d’entendre sa voix, d’avoir quelques nouvelles, ou d’être rassuré », s’attriste Léa Proust. Pour l’association Genepi, « 40 euros, c’est trop peu. Et puis, il y a rarement des téléphones dans les cellules et les téléphones sont difficilement accessibles en prison », affirme Mathilde Sallerin.
La porte d’un parloir du centre pénitentiaire de Riom, près de Clermont-Ferrand (©THIERRY ZOCCOLAN / AFP)Depuis la fin du confinement, les parloirs ouvrent à nouveau peu à peu dans les prisons. Mais désormais, une seule personne sera autorisée à visiter un·e proche en prison, ce qui exclut les mineur·es de moins de 16 ans, qui doivent être accompagné·es d’un adulte. « J’ai des clients qui n’ont pas pu voir leurs enfants depuis deux mois et qui ne peuvent toujours pas. C’est une catastrophe », indique l’avocate Amélie Morineau. « Les personnes sont souvent incarcérées à plus de 100 kilomètres de leurs proches, et 40 % de la population carcérale est de nationalité étrangère. »
Des violations des droits
Si les tensions sont peu à peu retombées au fil des semaines, elles ne doivent pas éclipser le fait que la période troublée de l’épidémie a donné lieu à des violations de droits des prisonniers et prisonnières. Une ordonnance du ministère de la justice, datée du 25 mars, a notamment été décriée les professionnel·les du droit et associations. Les personnes en détention provisoire ont vu leur mandat de dépôt prolongé de 2 à 3 mois pour les délits, et de 6 mois pour les crimes. Au centre pénitentiaire de Borgo, en Haute-Corse, les personnes détenues ont indiqué au directeur dans une lettre qu’en signe de protestation contre la mesure, elles refuseraient la distribution des plateaux repas.
« Prendre cette décision sans aucun passage devant un juge, c’est contraire à tous les principes du droit », s’insurge la contrôleur général des lieux de privation de liberté, Adeline Hazan. « Ce prolongement d’office c’est une atteinte disproportionnée au droit », confirme Amélie Morineau. Si le gouvernement est finalement revenu sur cette décision, l’avocate regrette qu’une mobilisation massive des professionnel·les du droit et du monde pénitentiaire ait été nécessaire.
Depuis le début de l’épidémie, selon la contrôleur général des lieux de privation de liberté, environ 120 cas de Covid ont été recensés parmi les prisonniers et prisonnières, et un homme est décédé à Fresnes, dans le Val-de-Marne.
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…
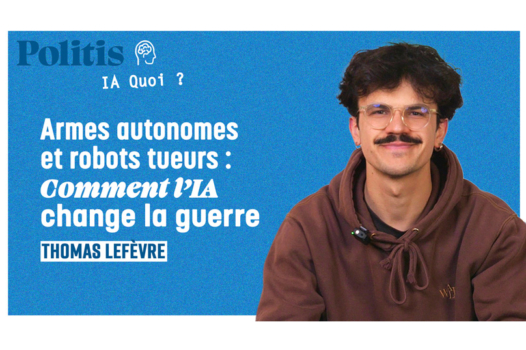
Armes autonomes et robots tueurs : comment l’intelligence artificielle change la guerre

Comment la guerre par drones redessine les champs de bataille
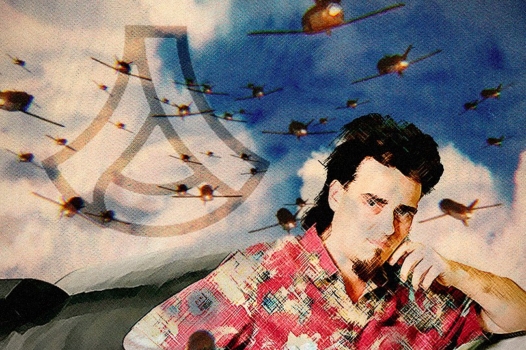
Anduril, la start-up de la guerre qui recrute sur internet









