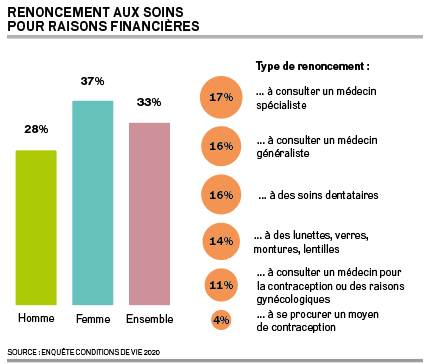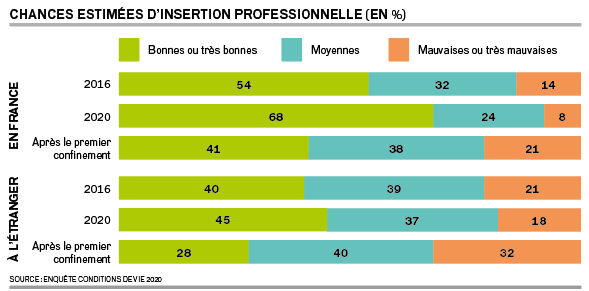Ma cité U va craquer
Dans la résidence universitaire Paul-Appell, à Strasbourg, des étudiant·es témoignent d’un cumul de difficultés : isolement, précarité, éloignement des proches, difficultés à suivre les cours… Tous et toutes attendent fébrilement les signes d’un déconfinement. reportage
dans l’hebdo N° 1639 Acheter ce numéro

© Roni Gocer
Tous les matins, c’est le même paysage. Cinq blocs épais coulés dans un même ciment. Et puis la cour, avec son gazon grisonnant et ses quelques arbres isolés. Sur le papier, toutes les cités universitaires se ressemblent ; la cité U Paul-Appell ne déroge pas à la règle. Avec 1 369 chambres de 10 mètres carrés, elle s’impose depuis 1957 comme l’une des principales résidences étudiantes de Strasbourg. Son style sommaire et ses façades délavées ne laissent pas de doute sur le public visé. Depuis novembre, des centaines d’étudiant·es précaires y vivent retranché·es. C’est à ces jeunes aussi qu’Emmanuel Macron s’adressait, le 21 janvier, depuis le campus flambant neuf de Paris-Saclay. Le Président s’est dédouané de la gestion erratique du confinement dans les campus à coups d’aphorismes lunaires tels que « chacun fait des erreurs, chaque jour » ou « celui qui ne fait pas d’erreur, c’est celui qui ne cherche pas ».
« Moi je n’ai pas le sentiment que le gouvernement ait tenté grand-chose, -voudrait lui répondre Steven, alors qu’il passe sa première année de géographie depuis sa chambre. Je ne comprends pas pourquoi notre ministre [de l’enseignement supérieur et de la recherche, Frédérique Vidal] est aussi peu présente. J’aurais aimé la voir aux côtés de Jean Castex et du ministre de la Santé dans les conférences de presse. On a l’impression que notre situation est la dernière préoccupation du -gouvernement. »
Quelques mois plus tôt, l’étudiant n’aurait jamais pensé être ouvertement critique à l’égard de la majorité, dont il se sentait proche. « En mars dernier, j’ai même milité pour LREM au premier tour des municipales, avant de déchanter. Imposer le distanciel comme ça, c’était absurde », martèle-t-il, en prenant pour exemple les « sorties terrain » de sa formation, -remplacées par des « excursions » sur Google Street View. « Le 26 janvier, j’ai fini par aller à la manifestation étudiante. C’était une première, pour moi. »
En trois ans à Paul-Appell, Steven a connu plusieurs chambres au sein des cinq bâtiments d’habitation, « avec leurs avantages et leurs inconvénients ». Niché depuis septembre au huitième étage du bâtiment C, il a gagné une jolie vue sur le bassin d’Austerlitz et ses docks. « Pas mal, le panorama, mais j’aurais quand même préféré un radiateur qui fonctionne », glisse-t-il avec un sourire, en refermant la fenêtre. Dans sa petite pièce allongée, les photos de famille se mêlent aux feuilles entassées, les romans fantastiques aux livres scolaires, et les cartes de France à celle de Westeros [continent fictif du Trône de fer]. « J’ai l’impression que certains découvrent que nos conditions de vie ne sont pas géniales. C’est peut-être parce que la plupart des élus n’ont jamais vécu dans une cité U. »
Vers midi, la plupart des cours du matin s’arrêtent. Dans les couloirs, des claquements de porte désaccordés annoncent l’heure du repas. Les allées et venues s’enchaînent entre les chambres et la cuisine de l’étage. Interdiction d’y être à plus de trois. Alors certains restent chez eux, se débrouillent avec des plaques de cuisson dissimulées et une chaussette sur le détecteur de fumée ; beaucoup se rendent au resto U, à l’entrée de la cité universitaire. À deux pas de là, au centre Bernanos, les files s’allongent chaque samedi pour les distributions alimentaires à destination des étudiants.
Les mêmes scènes se répètent en d’autres points similaires de Strasbourg et dans d’autres villes. « Sans les jobs étudiants pour se financer, c’est dur. Heureusement que les assos sont là », commence Abakar. Après avoir passé sa licence au Maroc et une première année de master à Besançon, l’étudiant tchadien vient poursuivre son cursus à Strasbourg. « J’ai déposé mon dossier dans toutes les agences d’intérim de la ville, mais je n’ai eu aucune réponse. »
En quittant Besançon, Abakar gardait de bons souvenirs de sa première année d’études en France. Mais, depuis qu’une chape de plomb est tombée sur le campus strasbourgeois, l’enthousiasme est vite retombé. « Tout le monde est dans sa chambre, c’est trop calme. La salle de sport est fermée. La médiathèque est fermée. Il n’y a presque plus d’occasions de se rencontrer, à part quelques discussions en ligne. »
Même sentiment pour Róisín et ses compatriotes irlandaises Yvonne, Molly et Ciara. Assises en tailleur sous un arbre de la cour, les quatre étudiantes improvisent une pause-café. « Nous venons toutes de la ville de Cork, nous nous connaissions déjà avant de partir, explique Róisín en anglais. Je n’ai pas vraiment l’impression qu’on ait découvert Strasbourg ou qu’on ait pu parler français très souvent. En fait, j’ai peur que ce soit une année d’Erasmus pour rien. Les seules personnes avec qui nous avons sympathisé sont écossaises, ce n’est pas ce qu’il y a de plus dépaysant pour nous. »
Autour de l’arbre où les jeunes filles se retrouvent, les clôtures s’étendent sur l’herbe. Depuis le lancement d’un programme de rénovation en quatre ans, les échafaudages ont essaimé graduellement. Sur les cinq bâtiments, un seul a achevé sa mue, présentant une façade immaculée. Face à lui, le bâtiment B peine à cacher son grand âge, mais garde peut-être pour lui la meilleure ambiance de Paul-Appell. Car, dans les couloirs, les voisins se dérangent plus facilement, et quelques sourires laissent croire que tout ne va pas si mal. « Dans mon cas je refoule très bien, c’est tout », jure Lyna avant d’éclater de rire. Même au milieu de son cours d’histoire des religions, l’étudiante, originaire de Besançon, n’hésite pas à sortir le thé et les petits gâteaux lorsqu’une voisine passe. « J’ai eu mon bac l’année dernière, sans être allée en cours ou presque depuis mars. Et puis je ne suis pas de cette ville, alors je ne connaissais pas grand monde. J’ai fini par me forcer à cuisiner avec les autres, ça m’a permis de me faire quelques ami·es dans l’étage. »
Sur l’écran de l’ordinateur posé sur le bureau, l’enseignante poursuit son cours sans sourciller. L’immeuble pouvait bien s’effondrer ou partir en cendres : rien n’aurait pu interrompre le décorticage en public des vingt-quatre chants de l’Odyssée d’Homère. Parfois, quelques images surgissent comme de divines surprises pour casser la monotonie du cours. « Franchement, c’est loin d’être le pire de nos cours, assure Lyna, conciliante. Plusieurs profs se contentent de lire en direct le texte du cours. Certains ne le font même pas en direct, mais nous laissent des fichiers audio de plusieurs heures. »
Après l’euphorie des premières semaines de cours en présentiel, la motivation s’enraye vite. « À un moment, j’ai flanché, avoue Lyna. Les cours devenaient trop abstraits sans les retours humains. On passe les examens dans des conditions qui n’ont rien à voir avec la norme, sans que le niveau baisse. Résultat, je pense m’être un peu plantée pour les derniers tests du semestre. »
Le manque de retours, l’absence de contrainte, la porosité totale entre l’espace de travail et l’espace de vie finissent par peser sur l’étudiante, comme sur beaucoup d’autres autour d’elles. « Je pensais aller bien psychologiquement mais, à un certain moment, je me suis simplement effondrée pour une broutille, de manière presque aléatoire. »
Amira, une étudiante tunisienne qui vit à deux portes de chez Lyna, évoque aussi son quotidien : « Je me lève tous les jours à 4 heures pour aller bosser jusqu’à 13 heures dans une entreprise d’agroalimentaire. L’après-midi, je travaille sur mon doctorat en chimie organique. Et quand j’ai fini et que je veux sortir prendre l’air, il est trop tard à cause du couvre-feu. »
Lorsque les restrictions sanitaires s’assouplissent, la détresse ne se dissipe pas toujours. L’été dernier, un étudiant marocain s’est tué dans sa chambre. Il n’y a pas eu de communication sur l’événement mais, dans le bâtiment B, tout le monde a entendu parler de sa mort. « Il était en master en maths-info, il ne voyait pas beaucoup de monde et il sortait de moins en moins de sa chambre », raconte Ghyta (1), une voisine de palier avec qui il discutait parfois. Fréquemment, des membres du personnel passaient le voir pour prendre des nouvelles.
« Je me souviens de l’intervention de la police, qui est passée par les fenêtres au milieu de la nuit. De mon étage j’ai tout vu, et je n’ai pas dormi de la nuit », complète Amira. En l’écoutant, Ghyta pousse un soupir. « C’est quand même dommage qu’il n’y ait pas eu de psychologues, ensuite, qui viennent pour nous parler. Enfin, moi ça va, mais quand même… » L’administration de la cité universitaire confirme qu’une première tentative de suicide avait conduit l’étudiant aux urgences, puis à sa prise en charge dans une unité psychiatrique. Elle assure ne pas avoir été informée de sa sortie de l’hôpital avant le drame.
(1) Le prénom a été modifié.
Pour aller plus loin…

« Il existe une banalisation des pratiques non conventionnelles de soin »

« Avant, 70 % des travailleurs géraient la Sécu. Aujourd’hui, c’est Bayrou. Voilà le problème »

« Les citoyens permettent aux scientifiques d’avoir le bruit du territoire »