1er Mai : quelle évolution du matien de l’ordre depuis cinq ans ?
À Paris, la gestion policière des mobilisations pour la Fête du travail a changé du tout au tout avec l’arrivée du préfet Didier Lallement. Le maintien de l’ordre s’est transformé en modèle à tendance liberticide.

Analyser et comparer les mobilisations du 1er Mai parisien s’avère complexe, tant le contexte politique, social puis sanitaire a marqué les cortèges depuis 2017. Avant d’examiner celles gérées par le préfet Didier Lallement, qui a pris son poste en 2019, il faut se pencher sur la stratégie de l’ancien préfet de police de Paris, Michel Delpuech.
Les cortèges de 2017 et 2018 ont été accompagnés de violences marquantes. Le premier, dans la continuité de la mobilisation contre la loi travail, rassemble des militants déterminés au sein d’un large bloc venu en découdre. Le défilé est marqué par des échanges violents entre CRS et manifestants, jusqu’à un événement marquant photographié par Zakaria Abdelkafi, de l’AFP. Un CRS est pris dans les flammes après avoir reçu un engin incendiaire. Même si, à cette époque, l’utilisation des LBD et des grenades explosives est très rare, voire inexistante, la répression sera vive.
Les CRS qui ont assisté à la scène parviennent à isoler le cortège radical et matraquent à tour de bras. Le maintien de l’ordre, cette année-là, s’opère toujours au corps à corps (et non pas à distance, comme ce sera le cas après le mouvement des gilets jaunes), dans des charges lourdes et des échanges de coups. Si violents soient ces échanges, la stratégie de Michel Delpuech se résume ainsi : « Mieux vaut une vitrine cassée qu’une jambe cassée. » Les consignes limitent donc l’utilisation des armes dites non létales à leur minimum et préfèrent des charges précises uniquement quand le contexte le nécessite.
L’année 2018 sera plus difficile encore pour le préfet. Pour les 50 ans de Mai 68, tous les militants d’Europe se donnent rendez-vous à Paris pour le 1er Mai. Sur le pont d’Austerlitz, un black bloc de plus de mille K-ways noirs et cagoules se forme face au dispositif policier présent à plusieurs centaines de mètres. L’image est impressionnante et laisse prévoir le pire. Un restaurant est vandalisé, des engins de chantier et une concession automobile sont incendiés. Dès le début, le ton est donné. Les forces de l’ordre n’interviennent pas et laissent le cortège évoluer sur le boulevard.
Le but est simple : laisser le black bloc avancer en retenant les manifestants qui ont rejoint les syndicats. Puis isoler les auteurs de violences et les prendre en tenaille. Rapidement, les camions à eau se mettent en marche et le mur de CRS avance sans entrer en contact avec les manifestants. Trop dangereux pour tout le monde. Gaz lacrymogènes contre cocktails molotov, le cortège radical est repoussé et dispersé après une série de heurts et quelques dégradations. Au vu de la mobilisation, le succès est total pour Michel Delpuech, qui aura tenu tête au plus grand black bloc que Paris ait connu, malgré quelques blessés et le début de l’affaire Benalla.
L’année suivante, changement d’ambiance. Didier Lallement prend les rênes de la préfecture de police de Paris en mars 2019, après le traumatisme des premiers actes des gilets jaunes sur les Champs-Élysées, qui ont métamorphosé le contexte social, les stratégies militantes, mais surtout la répression policière. Entre les 1er Mai 2018 et 2019, la ville de Paris a connu les LBD, les GLI-F4 (grenades désencerclantes), les mutilés, les Brav-M (unités de policiers à moto) et le chaos. Didier Lallement a choisi cette stratégie plutôt que de prôner la distance et la désescalade.
La manifestation de 2019 est totalement désorganisée. Entre le cortège syndical, la présence d’un black bloc et les gilets jaunes, c’est un défi logistique pour la préfecture, qui mobilise de gros moyens. Les quelques violences sont tout de suite maîtrisées par la Brav-M. Pour la préfecture, il y a nécessité à intervenir avant les violences et dès la formation d’un groupe jugé violent. Il n’y a quasiment pas de temporisation et les charges affluent dans tous les sens.
Pour Didier Lallement, il fallait marquer le coup et prouver ses capacités à gérer le cortège parisien. Il y aura en tout, ce jour-là, 40 000 manifestants dans la capitale, d’après un décompte indépendant. De son côté, la préfecture annonce 15 000 contrôles préventifs. Plus d’une personne sur trois aura donc été contrôlée et fouillée ! Une stratégie qui a pour but de dissuader les militants radicaux de venir. Il y aura aussi 330 interpellations dans la journée, ce qui représente un manifestant sur 120. La plupart seront libérés sans suite. Ce principe d’interpellations préventives visant à contrôler au maximum la présence d’individus violents est pointé du doigt par l’opposition et par des associations pour son côté liberticide.
La Fête des Travailleurs 2020, en pleine crise sanitaire, n’aura pas lieu même si quelques manifestants, une dizaine, se retrouveront place de la République avant de se faire verbaliser pour non-respect du confinement.
L’année 2021 aurait pu marquer le retour d’un 1er Mai « normal ». Ce ne fut pas le cas. Comme le résumait Politis il y a un an, _« nombreux·ses sont les militant·es et travailleur‧euses venu·es accompagné·es d’une fatigue presque léthargique. Tous et toutes sont touché·es par les longs mois de la crise sanitaire, une précarisation généralisée, des conditions de travail instables et les passages de lois liberticides comme la loi sécurité globale ou celle sur le séparatisme ». Pourtant, les habitudes reviennent vite et un cortège de tête se forme devant les syndicats. Cette tête de pont est immédiatement encerclée par les forces de l’ordre, boucliers contre banderoles.
Cette stratégie visant à contrôler entièrement le cortège et à étouffer la contestation produit souvent l’effet inverse de celui recherché et énerve davantage celles et ceux qui veulent en découdre. Rapidement, les projectiles partent, les grenades et les charges aussi. Tout le long de la manifestation, des échanges ont lieu, mais sans l’intensité des manifestations contre la loi travail ou celles des gilets jaunes. La réponse du maintien de l’ordre est aussi plus « légère » que dans certaines manifestations, comme celles des pompiers en janvier 2020, où de nombreuses grenades explosives avaient été utilisées, tout comme les LBD.
Malgré la stratégie oppressante et liberticide de Didier Lallement, qui a généralisé les nasses mobiles, les interdictions de manifestation, la présence des Brav-M et l’utilisation des armes les plus dangereuses de l’arsenal policier, les rassemblements du 1er Mai échappent à cette pression.
Les manifestations de la Fête du travail ne sont pas de simples cortèges. Elles possèdent une aura particulière, syndicale et parfois radicale. Pour la préfecture de Paris, il est très difficile d’imposer ses règles de maintien de l’ordre. Alors que le niveau de violence des manifestations est orienté à la baisse depuis quatre ans, la pression du maintien de l’ordre n’a fait qu’augmenter pour étouffer les violences, parfois même avant qu’elles se produisent. Pour le préfet de Paris, mieux vaut une manifestation sage qu’une manifestation libre.
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

Inéligibilité pour Marine Le Pen : séisme extrême

La condamnation de Marine Le Pen est celle d’un système
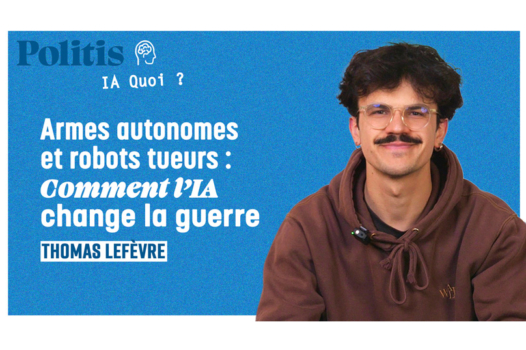
Armes autonomes et robots tueurs : comment l’intelligence artificielle change la guerre










