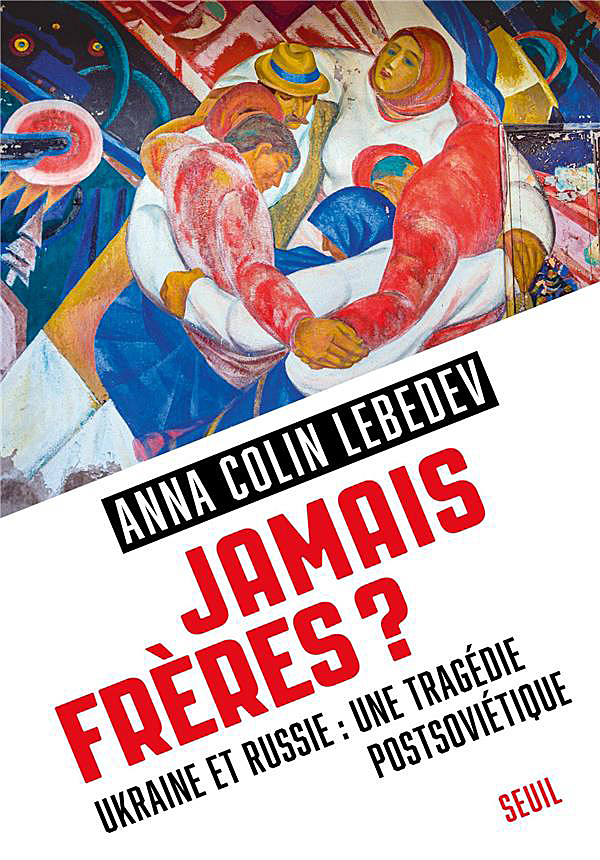« Pour les Ukrainiens, le peuple russe entier est responsable »
Dans son nouveau livre, la chercheuse Anna Colin Lebedev montre comment la Russie a instrumentalisé la « fraternité » avec l’Ukraine pour justifier sa guerre d’agression.
dans l’hebdo N° 1721 Acheter ce numéro

La symbolique boursoufle cette journée qui ne ressemble à nulle autre en Ukraine. Ce 24 août, la population célèbre l’indépendance de son pays, tout en déplorant les six mois qui se sont écoulés depuis l’invasion de l’armée russe. En 2014, déjà, Moscou annexait la Crimée et soutenait la création des républiques autoproclamées de Donetsk et de Louhansk. Cette année, c’est l’Ukraine tout entière que Vladimir Poutine comptait envahir.
Jamais frères. Ukraine et Russie : une tragédie postsoviétique, Anna Colin Lebedev, Seuil, 224 p. 19 euros.
Six mois plus tard, force est de constater que l’objectif n’a pas été rempli, en dépit de nombreux crimes de guerre commis par l’armée russe sur lesquels travaillent actuellement les agences internationales. Un échec cuisant pour le chef du Kremlin, surpris par le courage d’une population habituée, depuis huit ans, à s’organiser face aux agressions voisines. Dans le discours qu’il a tenu en ce jour particulier, le président Zelensky a tenu à féliciter, à nouveau, ses citoyens. Et a ajouté que l’Ukraine avait, depuis le 24 février de cette année, cessé d’être un simple point sur la carte à côté de son voisin russe. Était-ce un message adressé à la communauté internationale pour affirmer que l’époque du « petit frère » de la Russie était bel et bien révolue ?
C’est justement ce prétendu lien familial qu’Anna Colin Lebedev, maîtresse de conférences en science politique à l’université Paris-Nanterre, a souhaité déconstruire, dans son ouvrage Jamais frères ? Russie-Ukraine : une tragédie postsoviétique (Seuil). Ce travail donne à comprendre les trajectoires de ces deux pays, pétris par le poids de leurs avancées comme de leurs impensés.
Pour les Ukrainiens, cette idée de « fraternité » des deux peuples est-elle devenue un argument en faveur de la domination russe ?
Anna Colin Lebedev : Clairement. Pour les Ukrainiens, c’est désormais un paravent à l’écrasement. Prétendre un lien de sang, une proximité qui serait intrinsèque, inscrite dans l’ADN des deux peuples, facilite l’idée selon laquelle l’Ukraine n’a pas de raison d’exister en tant que telle. Il faudrait l’effacer de la surface de la Terre et transformer les Ukrainiens en ce que la Russie voudrait qu’ils soient : de bons Russes.
Cette position de la Russie « en surplomb » a-t-elle toujours été présente ?
Le vocable de « frère » pour qualifier le rapport entre les populations qui vivent sur ces territoires est utilisé depuis des siècles. Mais ses usages sont instrumentaux. Le « grand frère » était évoqué pour solliciter sa protection. La « fraternité », pour garantir une alliance ou justifier une allégeance.
On constate aujourd’hui l’utilisation très politique qu’en fait Vladimir Poutine… La mobilisation de cette expression suppose toujours un intérêt du pouvoir. Dans les années après l’indépendance de l’Ukraine et de la Russie, le pouvoir et la population russes ne se préoccupaient pas beaucoup de l’Ukraine. Certes, il y a des migrations de travail, des relations économiques et des liens privilégiés. Mais nul besoin d’utiliser cette notion de fraternité : chacun suit son chemin. Avant l’arrivée de Vladimir Poutine et ses ambitions géopolitiques, l’état d’esprit qui prédomine revient à dire : « L’Ukraine est l’affaire des Ukrainiens. »
L’intensité du ressentiment des Ukrainiens vis-à-vis des Russes est à la mesure de la brutalité dont ils sont victimes.
En 2014, au moment du Maïdan (1), un sondage montrait que 81 % de la population ukrainienne ressentait de la « sympathie » pour les Russes. Ce lien s’est-il étiolé pour aboutir à une forme de haine face à l’envahisseur ?
L’intensité du ressentiment des Ukrainiens vis-à-vis des Russes est à la mesure de la brutalité dont ils sont victimes. Plus qu’un étiolement progressif, j’identifie des moments de rupture. Le premier moment : l’annexion de la Crimée. Ce qui va choquer les Ukrainiens, c’est la manière dont les Russes accueillent avec une grande fierté l’annexion d’un territoire qui appartient à l’Ukraine. La seconde rupture, bien plus brutale, intervient peu après l’invasion en février.
Le grand espoir de la population ukrainienne reposait sur un soulèvement des Russes. Comment pouvaient-ils accepter cette guerre où l’on tue son plus proche voisin ? L’absence de protestation a été un choc terrible. L’ultime rupture, enfin, intervient au moment des exactions commises par les soldats russes sur le territoire ukrainien. Cet épisode marque un tournant : pour les Ukrainiens, le peuple russe tout entier est responsable. À leurs yeux, l’intention génocidaire est partagée par tous. La guerre change de nature et devient un conflit qui se résume à cette formule existentielle : « C’est eux ou nous. »
Lire aussi > En Russie, on essaie d’éviter de penser à la signification de la guerre.
Qu’en est-il de cette génération qui avait 20 ans en 1989, à laquelle l’Union soviétique proposait le même avenir, que l’on vienne de Moscou ou de Kiev ? A-t-elle la même lecture du conflit que les jeunes nés sous Vladimir Poutine ?
En réalité, le discours officiel veut faire croire à cette génération qu’elle vivait dans un seul et même pays. Et ce dans le but de servir l’idée d’une grande Union soviétique. Mais ce n’était pas tout à fait le cas : être citoyen soviétique ukrainien ou citoyen soviétique russe ne renvoie pas toujours à la même histoire, aux mêmes pressions du pouvoir politique, aux mêmes opportunités, ni à la même langue ou la même culture. Néanmoins, cette génération a gardé un attachement à l’idée qu’il y a quelque chose en commun. Parfois, ce sont des liens objectifs qui reposent sur les migrations de travail, ou l’expérience de l’armée.
Aujourd’hui, cette idée est en passe d’être détruite, et pas seulement entre ces deux nations. D’autres pays issus de l’Union soviétique commencent à se demander si la notion de « grand frère » ne dissimule pas des formes de domination ou d’oppression. C’est le cas pour la Moldavie, qui a parcouru ce chemin depuis quelques années déjà. Avant elle, les pays baltes. Mais aussi le Kazakhstan, considéré par la Russie comme un « allié privilégié ». On sent une gêne importante du côté de ce pays par rapport à la guerre en Ukraine, à laquelle il ne peut apporter ni soutien clair ni franche opposition. Parmi la population circule cette idée : « Après les Ukrainiens, c’est nous. » On la trouve aussi en Biélorussie, même si la révolte est réprimée par le pouvoir. Les Biélorusses sont aujourd’hui victimes d’une double oppression : par Loukachenko et par Poutine.
Il y a cette idée que la Russie se trouve au centre : ce serait le lieu de la civilisation, la nation qui a porté les pays périphériques vers la lumière.
Vous réutilisez l’expression d’Henry Rousso, historien français spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, de « passé qui ne passe pas » pour qualifier les angles morts de l’époque soviétique dans les mémoires russe et ukrainienne. Pourtant, un regard critique semble exister à Kyiv, contrairement à Moscou. Qu’est-ce qui empêche les Russes de regarder les angles morts du passé ?
C’est compliqué pour les Russes à plusieurs égards. Il y a un déni de retour critique sur l’histoire. Les Russes ignorent toute une série de choses sur leur propre pays. Des questions douloureuses n’ont jamais eu la possibilité d’être posées. Ils ne connaissent pas la Grande Famine de 1932 en Ukraine, ni ses résonances dans le pays – pourtant centrales dans l’imaginaire ukrainien. Ils ne savent pas grand-chose non plus de l’Holocauste ou de la répression des langues et des acteurs culturels ukrainiens.
Au-delà de cette méconnaissance, il y a cette idée que la Russie se trouve au centre : ce serait le lieu de la civilisation, la nation qui a porté les pays périphériques vers la lumière. En réalité, cette dimension est commune aux autres métropoles colonisatrices. Ce travail de déconstruction, douloureux, n’a jamais été entamé. Il commence à peine à être initié par les Russes en exil, qui tentent de répondre à cette question terrible : pourquoi la société civile a-t-elle accepté cette guerre ?
Vous expliquez que l’Ukraine s’est « homogénéisée politiquement » autour d’un fil rouge qui traverse la grande famine, l’annexion de ses territoires, la répression de certaines figures nationalistes, les intimidations… Soit des événements où le pays a été dans une position de cible privilégiée de la Russie. Cela a-t-il une incidence dans la société aujourd’hui ?
Je ne pense pas que l’Ukraine soit dans une position victimaire. La capacité des Ukrainiens à repousser la Russie dans la première phase de l’invasion a joué un rôle très important. Il y a vraiment cette préoccupation, pour les Ukrainiens, d’être acteurs de leur propre destin et de ne pas tenir la ligne imposée par la Russie. L’idée que Moscou a la volonté de raser le pays depuis des décennies est très présente. La population a besoin de cette explication pour trouver du sens à la situation. C’est aussi ce qui explique cet état de qui-vive dans lequel les Ukrainiens sont restés depuis 2014. Ils n’ont cessé d’envisager leur participation directe à la guerre.
Pourtant, l’armée a beaucoup évolué entre 2014 et 2022…
Oui, il y a eu des réformes extrêmement importantes, le départ d’officiers jugés trop proches de la Russie et l’arrivée de nouveaux combattants. Mais les Ukrainiens sont toujours restés très critiques vis-à-vis de leur institution militaire. Ils cherchent à maintenir un contrôle social important.
Contrairement aux Ukrainiens, les Russes civils n’envisagent pas de prendre les armes pour aller combattre.
Est-ce aussi là que réside l’une des plus grandes différences avec la Russie ?
Effectivement. En Russie, tout ce qui relève des initiatives populaires a été intégré dans des circuits de décision étatiques, ou a tout simplement été effacé. Contrairement aux Ukrainiens, les Russes civils n’envisagent pas de prendre les armes pour aller combattre. Comme beaucoup d’autres armées du monde, l’armée russe recrute des gens plutôt modestes.
Comment ces nouvelles recrues ont-elles été capables de commettre des crimes de guerre durant ces six derniers mois, comme à Boutcha ?
Les différentes enquêtes en cours le diront. Mais plusieurs facteurs peuvent être mobilisés. Ces factions peu éduquées et pauvres souffraient d’un manque de préparation incroyable. Les soldats pensaient être accueillis paisiblement par les civils. Quand ceux-ci ont commencé à leur tirer dessus, ils sont devenus des ennemis à abattre. Il y a aussi un défaut de préparation du commandement, puisque certains officiers ont aussi souligné qu’ils ignoraient le détail de leur mission. J’ajouterai un dernier élément : ces jeunes adultes défavorisés arrivent en Ukraine par des zones prospères. Ils découvrent des milieux plutôt aisés. Une forme de hargne peut aussi venir de là.
Au-delà de l’armée, la méconnaissance du terrain semble venir directement du Kremlin. Comment l’expliquez-vous ?
Cela pose cette question : les régimes autoritaires sont-ils efficaces ? Il y a un élément que je peux avancer : un article, publié dans les années 2010, expliquait à quel point les études ukrainiennes manquaient en Russie. Ce présupposé de fraternité a fait que les Russes ordinaires, le pouvoir politique et les intellectuels n’avaient rien à comprendre des Ukrainiens. « Circulez, il n’y a rien à étudier ! » Le maintien de cette idée de proximité entre les peuples a entretenu l’ignorance.
Les « crimes contre l’histoire », que décrit la Fédération internationale pour les droits humains pour qualifier la propagande de Vladimir Poutine, se retournent-ils finalement contre le criminel ?
C’est vrai. On a tendance à ne pas prendre en compte les tendances historiques pour expliquer des faits de société. On leur préfère les grands événements géopolitiques. Avec l’Ukraine, on constate comment un refus de travail historique peut aboutir à des conséquences majeures sur la prise de décision par le pouvoir politique et l’acceptation par la population.
Ces trente dernières années, l’Ukraine a beaucoup investi dans la mise en valeur de sa langue, de son histoire et de sa culture.
Les conséquences de la guerre sur le quotidien des Russes peuvent-elles transformer leur rapport au pouvoir ?
Si, dans les premiers mois de la guerre, la population russe pouvait ne pas connaître la situation en Ukraine, aujourd’hui, elle sait. L’information circule, même si elle est déployée en miroir : certes, des crimes ont eu lieu à Boutcha, mais ils sont mis en scène par les Ukrainiens. Le pouvoir a réussi à transformer la guerre en une forme de routine et à minimiser son impact économique.
La réaction que cela suscite parmi la population russe est une transformation très particulière du rapport à l’État. Certes, ce « laisser-faire mutuel », où les Russes pouvaient vivre tranquillement sans être inquiétés par la sphère politique, se poursuit. Mais il est peu à peu remplacé par l’idée que les années fastes sont terminées. La Russie est redevenue un État qui exerce la violence, au sein duquel les familles peuvent être en danger. La priorité, c’est donc de se protéger. Les Russes mobilisent ici un automatisme que leurs grands-parents ont eu à l’époque soviétique : l’État porte en lui-même un potentiel meurtrier.
Face à ces bouleversements au sein de la population russe, les Ukrainiens, eux, sont-ils en train de se réapproprier leur histoire et leur culture, gardées à l’ombre de la culture russe ?
Non, elle n’a été dans l’ombre que pour nous Occidentaux. Sur ces trente dernières années, l’Ukraine a beaucoup investi dans la mise en valeur de sa langue, de son histoire et de sa culture. Elle nous était invisible parce qu’on regardait souvent l’Ukraine par le prisme russe. Le président Zelensky, dans son discours du 24 août, a dit que l’Ukraine avait cessé d’être un point sur la carte à côté de la Russie. Notre regard sur cette zone du monde est façonné par la Russie, dont le discours sur les périphéries a pétri notre grille de lecture. C’est à nous de découvrir la société ukrainienne, même si l’invasion en 2022 nous l’a déjà imposé.
La France a eu beaucoup de mal à voir la Russie comme un pays impérialiste, notamment parce que l’Union soviétique a été du côté de tous les mouvements décoloniaux. Nos milieux intellectuels, et notamment à gauche, ont eu du mal à considérer que l’Union soviétique pouvait accompagner les émancipations sur la scène internationale, et en même temps être une force d’oppression et de domination à l’intérieur de ses propres frontières. Il faut refaire de ces périphéries de l’Union soviétique des centres. Regarder ce qu’ils portent en eux-mêmes et non en fonction de la Russie. Pour l’Ukraine, bien sûr, mais aussi pour les États du Caucase comme pour ceux d’Asie centrale.
(1) Lors de la révolution de Maïdan en février 2014, les Ukrainiens ont chassé du pouvoir des dirigeants corrompus, dont Viktor Ianoukovytch, président en exercice, et réclamé un rapprochement avec l’Union européenne.
Pour aller plus loin…

L’héritage du Pape François : réforme plutôt que révolution

Portfolio : À Jinba, en Cisjordanie occupée, une vie rythmée par les attaques de colons

En Cisjordanie occupée, la vie clandestine des habitants de Jinba