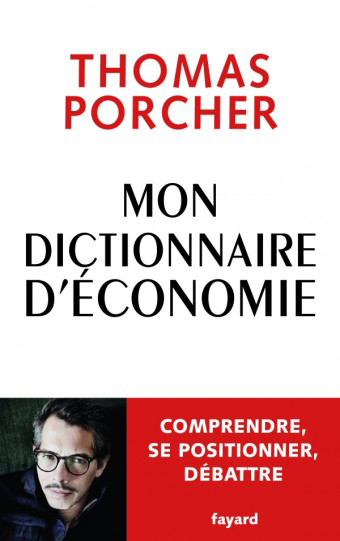Économie : un kit de survie citoyen signé Thomas Porcher
Dans un dictionnaire engagé, le membre des Économistes atterrés offre un manuel de résistance aux théories dominantes. Un essai efficace et corrosif. Extraits.
dans l’hebdo N° 1726 Acheter ce numéro

Introduction
Aujourd’hui, les questions économiques échappent à la majorité du grand public car leurs aspects techniques impressionnent. Beaucoup d’experts, qui ont bien compris les vertus du matraquage des idées, ont réussi à faire croire qu’en économie il n’y avait qu’un seul avenir envisageable : celui de la mondialisation, de la casse du service public et du capitalisme vert.
Mon dictionnaire d’économie. Comprendre, se positionner, débattre, Fayard, 342 pages, 19 euros.
La méconnaissance économique et le manque d’intérêt que suscite cette matière ont permis à certains de nos dirigeants de passer tranquillement les pires réformes en se drapant dans de beaux discours sur l’intérêt général. C’est ce manque de connaissance qui empêche tout débat sérieux sur des questions aussi essentielles que le service public, l’évasion fiscale, la réindustrialisation ou la lutte contre le réchauffement climatique. Et c’est cette absence de débats économiques qui a transformé les élections en concours de beauté entre candidats, où chacun y va de sa petite phrase, surjouant sa posture, et évite la confrontation d’idées. Pourtant, les choix de politiques économiques ont un impact majeur sur le cours de nos vies, ainsi que sur le monde que nous allons laisser à nos enfants. […]
Le manque de connaissance du grand public empêche tout débat sérieux sur le service public, l’évasion fiscale…
L’indignation, la dénonciation collective, les marches, les grèves sont nécessaires pour gagner des batailles, mais pas suffisantes pour gagner la guerre. Il faut ensuite pouvoir proposer un projet économique crédible.
Pour cela, il faut que chacun puisse maîtriser un certain nombre de termes clés et leurs enjeux sous-jacents. « Dépense publique », « marché », « finance », « Europe sociale », « attractivité d’un pays » sont des termes omniprésents dans les discours politiques, les débats télévisés et les articles de presse. Pourtant, peu de gens pourraient les définir clairement et dire ce qu’ils recouvrent en France ou à l’étranger.
Attractivité d’un pays
Pour beaucoup (trop) d’experts, l’attractivité d’un pays se résume à une fiscalité accommodante pour les entreprises et des règles plus souples en matière sociale ou d’accès aux marchés publics. Baisse de la fiscalité* et réglementations simplifiées seraient, nous dit-on, nécessaires pour attirer les investisseurs étrangers. Les faits contredisent ces arguments. Par exemple, dans les années 1980, en Corée du Sud, il fallait obtenir 299 permis auprès de 199 administrations pour ouvrir une usine, et cela n’a pas empêché le pays d’être attractif. Pourquoi ? Parce que son économie était dynamique et que, pour les investisseurs, le jeu en valait la chandelle. Les critères d’attractivité ne se résument donc pas à une question de fiscalité ou de réglementations. Ils prennent en compte la performance économique du pays, l’efficacité des entreprises présentes sur le marché, l’offre de services publics et, enfin, les infrastructures (routes, transports, écoles, etc.).
Par exemple, la France est une destination choisie par les investisseurs pour la qualité de ses infrastructures (transports, communications), de sa main-d’œuvre (parmi les plus productives au monde) et de sa recherche et développement. Trois éléments qui dépendent plus ou moins directement de l’action publique. Les infrastructures sont financées par l’État, tout comme la qualité de la main-d’œuvre via le système éducatif et la recherche. À l’inverse, la réduction des impôts sur les entreprises (dans le but de les faire venir) créerait un manque à gagner pour les finances publiques, qui finirait à terme par dégrader les critères qui font l’attractivité de la France.
Flexibilité du marché du travail
Croyance expliquant que la protection des travailleurs, et notamment le code du travail, serait la cause du chômage en France. La solution serait donc de donner plus de souplesse au marché du travail en allégeant ce code qui, comme le clamait Benjamin Griveaux, alors secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances, n’a pas changé depuis trente ans (ce qui est factuellement faux).
La lecture libérale se fonde sur le postulat suivant : depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’économie française subit de plus en plus de rigidités sur les différents marchés des biens, des services, des capitaux et du travail. De ce fait, la croissance s’est tassée, et la France aurait perdu en compétitivité. L’objectif serait donc de s’attaquer à ces rigidités, et prioritairement à celles liées au marché du travail car elles expliqueraient le chômage. L’idée serait de faciliter les licenciements pour pouvoir embaucher.
Retirer des protections aux salariés n’a jamais créé d’emplois.
Ce raisonnement répété en boucle par des éditorialistes ou des représentants de think tanks du patronat a fini par s’imposer comme une vérité, alors qu’il contredit les faits. En réalité, la France s’est engagée dans un processus continu de réformes depuis plus de trente ans. Dès 1972, le recours à l’intérim a été rendu légal pour satisfaire le patronat, qui réclamait déjà un volant de flexibilité. En 1979, les contrats à durée déterminée (CDD) sont introduits dans le code du travail. D’autres contrats précaires, comme les contrats de chantier pour les salariés du bâtiment, seront créés pour s’adapter aux desiderata des chefs d’entreprise. Tous ont d’ailleurs connu un franc succès : depuis 1980, l’intérim a été multiplié par 5, les CDD par 4 et les stages et les contrats aidés par 3.
Sur la période 2000-2021, plus de 270 réformes ont été faites sur l’ensemble des champs relatifs au marché du travail (assurance-chômage, minima sociaux, accompagnement des demandeurs d’emploi, etc.). Aujourd’hui, 87 % des nouvelles embauches se font en CDD, les salariés en CDD et intérimaires restent dans la précarité, ces types d’emplois sont rarement des tremplins vers une activité durable, de sorte que chaque génération occupe moins d’emplois stables que la précédente. Il n’y a d’ailleurs pas de consensus scientifique sur le lien entre flexibilité du marché du travail et création d’emplois, comme le rappelle une note du Conseil d’analyse économique (CAE) qui, dans une synthèse des travaux théoriques et empiriques sur le sujet, écrivait en 2015 : « Il n’y a pas de corrélation démontrée entre le niveau de protection de l’emploi et le taux de chômage (1). »
Cette approche fait écho à une autre qui a fait grand bruit dans les milieux avisés en son temps. En 1994, l’OCDE avait livré une étude indiquant qu’un certain degré de protection de l’emploi se traduisait par des conséquences néfastes sur le chômage pour mieux se déjuger en 2004, indiquant qu’il n’y avait pas de corrélation entre le niveau de protection de l’emploi et la croissance du chômage.
Retirer des protections aux salariés n’a jamais créé d’emplois, cela permet juste de faire du travail une variable d’ajustement en donnant au patronat la possibilité de compresser plus facilement les coûts via les licenciements en cas de perte d’activité. L’important dans l’affaire, c’est le récit qui en est fait. Avec un mélange de mauvaise foi et d’amnésie, beaucoup d’éditorialistes et d’économistes nous racontent l’histoire d’une France irréformable, ce qui est faux au regard des faits.
Irréformable
Adjectif souvent associé au mot France. La « France irréformable » est probablement le plus grand mensonge de ces trente dernières années. En réalité, notre pays a effectué de nombreuses réformes sans qu’elles rencontrent les succès espérés. Les experts pro-réformes font chaque fois comme si la réforme d’avant n’avait pas eu lieu, afin d’en réclamer d’autres. Une réforme en balaie une autre, toujours accompagnée du même discours stigmatisant à l’égard des Français, lesquels refuseraient de faire des efforts. « Les Français détestent les réformes », a dit Emmanuel Macron lors d’un déplacement à Bucarest. L’histoire montre qu’ils en ont pourtant accepté un certain nombre.
À partir de 1983, la France entame un virage économique qui la conduit à épouser les orientations du capitalisme dominant. C’est le fameux « tournant de la rigueur ».
Ainsi, le gouvernement de l’époque met en place une austérité budgétaire qu’il justifie par la nécessité d’une monnaie forte, l’intégration européenne, la compétitivité, la mondialisation et la volonté de moderniser son appareil étatique. Il conduit une politique de « désinflation compétitive » reposant sur trois piliers : le franc fort, la réduction de la dépense publique et la modération salariale. L’objectif étant de gagner en compétitivité pour soulager notre économie du poids de la contrainte extérieure.
La France irréformable est un mythe. L’impact des réformes sur une grande partie de la population est une réalité.
L’Allemagne est alors désignée comme le modèle à suivre, et le franc doit tenir tête au mark, devise de référence. Ainsi, la France renonce aux dévaluations de sa monnaie (la dernière sera réalisée en 1987) et s’applique à lutter contre l’inflation*. Les salaires connaissent alors une modération sans précédent, puisque leur part dans la valeur ajoutée nationale subit un recul de dix points de pourcentage entre 1976 et 2008. D’autres facteurs concourent au contrôle des salaires, comme le recours à l’emploi précaire – notamment l’intérim, déjà légalisé depuis 1972.
L’État modifie également la fiscalité pour la rendre plus favorable aux entreprises. L’impôt sur le bénéfice des sociétés passe de 50 % à 33 %, selon l’idée du chancelier allemand Helmut Schmidt que « les profits d’aujourd’hui font les investissements de demain et les emplois d’après-demain ». Or la modération salariale réduit encore plus les débouchés des entreprises (par ailleurs déjà confrontées à la saturation des besoins) et, in fine, les incitations à investir. Le chômage augmente, entraînant une hausse de la dépense publique (alors même que le gouvernement cherchait à la réduire) et du déficit public.
La France apporte également une contribution décisive à la financiarisation de l’économie. Comme le rappelle Rawi Abdelal, ce sont trois Français (Jacques Delors à l’Union européenne, Henri Chavranski à l’OCDE et Michel Camdessus au FMI) qui ont proposé ou appuyé l’adoption de règles libérales pour leurs organisations respectives et ainsi permis l’accélération et l’augmentation de la libre circulation des capitaux. Enfin, en 1987, l’arrivée au pouvoir de Jacques Chirac encourage un programme de privatisations dans des domaines stratégiques (énergie, banques, etc.), l’arrêt de tout contrôle des prix et la suppression de l’autorisation administrative de licenciement pour accroître la flexibilité du marché du travail*.
En réalité, contrairement à l’idée reçue, la France a transformé son économie en profondeur. L’emploi s’est réduit de moitié dans le secteur public entre 1985 et 2000 ; les grandes entreprises publiques ont été privatisées totalement ou en partie à partir des années 1990 ; l’État stratège* s’est progressivement effacé ; les syndicats ont connu une baisse de leurs effectifs ; le taux de chômage et les inégalités n’ont cessé d’augmenter. La « France irréformable » est un mythe, par contre, l’impact négatif des réformes sur une grande partie de la population est une réalité.
Traités de libre-échange de nouvelle génération
Traités visant à favoriser les échanges entre l’Union européenne et d’autres pays. Le terme « nouvelle génération » signifie que ces accords traitent des obstacles au commerce derrière les frontières, c’est-à-dire sur les normes établies à l’intérieur d’un pays, contrairement aux anciens traités, qui se focalisaient sur les barrières douanières. Les normes pouvant être différentes d’un pays à l’autre et représenter des obstacles, le but est d’harmoniser ces normes afin qu’il n’y ait plus aucune (ou quasiment aucune) entrave à la libre circulation des biens et services.
À partir de 2006, l’Union européenne met en place une stratégie nommée « Global Europe : Competing in the World » visant à signer des accords de libre-échange de nouvelle génération avec ses principaux partenaires commerciaux. C’est dans le cadre de cette stratégie que s’inscrivent les fameux traités transatlantiques Tafta (abandonné depuis) et Ceta négociés avec les États-Unis et le Canada, mais d’autres ont déjà été signés avec le Pérou, la Colombie, le Honduras, le Nicaragua ou la Corée du Sud.
Il faut croire que la construction d’un marché où vingt-sept États mettent déjà en concurrence leur modèle social et leur fiscalité ne suffisait pas à la Commission européenne. Il a fallu qu’elle aille plus loin en facilitant l’accès à des concurrents extérieurs au marché européen. Tout ce que nous vivons aujourd’hui en Europe, la concurrence fiscale du Luxembourg et de l’Irlande pour attirer les sièges sociaux des plus grosses entreprises, la compétition portant sur le coût du travail qui entraîne des délocalisations dans les pays de l’Est, celle portant sur les réglementations qui entraîne la casse du droit du travail et la baisse des normes environnementales, tout cela va être amplifié avec ce type de traités.
Ces traités représentent des chocs de concurrence de forte ampleur puisqu’un nombre croissant de secteurs se trouvent brutalement exposés à de nouveaux concurrents. La Commission européenne ne s’est pas trompée lorsqu’elle a vu dans ces traités l’occasion d’engager des réformes dites structurelles* pour répondre à ce nouvel état de fait. Ces traités de nouvelle génération obligent alors à engager des politiques de compétitivité qui poussent à une concurrence déloyale entre États européens, ces derniers voulant se disputer les investissements directs qui pourraient arriver dans l’Union européenne.
Travailler plus
Vieille marotte de droite qui laisserait entendre que les pays qui travaillent davantage que la France ont une économie plus prospère. Or cette affirmation est fausse tant dans les faits que d’un point de vue théorique. Les pays qui travaillent le plus sont loin d’être les plus riches, c’est même l’inverse.
Prenons l’exemple du Bangladesh, le troisième producteur de textile au monde, les horaires y dépassent soixante-dix heures par semaine pour des salaires qui atteignent péniblement les 70 dollars mensuels. D’autres pays comme l’Égypte ou le Pérou travaillent environ cinquante-cinq heures par semaine. Dans les pays riches, on travaille moins et le temps de travail a tendance à diminuer. Par exemple, entre 1997 et 2014, le pays de l’OCDE ayant le plus diminué son temps de travail par salarié est l’Autriche, suivie de l’Irlande et de l’Allemagne. La France est en 5e position, et tous les pays de l’OCDE ont réduit leur temps de travail sur cette période – à l’exception de la Grèce, qui l’a augmenté.
En France, la durée du travail a été divisée par deux en un siècle, en même temps que le revenu moyen augmentait de façon considérable. Cela s’explique par le fait que la production effectuée aujourd’hui par une personne vaut 25 fois celle d’un travailleur de 1830 (pour une durée égale de travail, un homme a multiplié par 25 la quantité de biens produits).
Comment a-t-on pu travailler moins et produire plus ? Tout simplement parce que nous avons amélioré notre productivité*. Or la productivité dépend des infrastructures, des technologies, de l’organisation du travail et de la qualification des individus. La création de richesse est donc un processus complexe qui ne se résume pas uniquement à l’allongement du temps de travail. D’autres aspects, notamment le type de travail ou les filières (comme le choix de secteurs d’avenir, moins soumis à la concurrence et bénéficiant donc de prix plus élevés), ont une influence beaucoup plus forte sur la création de valeur. Et n’oublions pas : c’est parce que nous travaillons moins que nous vivons plus longtemps.
Récit
[…] L’histoire humaine, quelles que soient les cultures, s’enrichit de récits fondateurs : des contes, des mythes, des fables. Les récits donnent du sens, imposent des croyances, font naître du sacré. Les économistes* en sont de grands fabricants.
Ainsi, le libre-échange* est au cœur d’un joli récit qui a tenu le haut du pavé depuis presque deux siècles. Selon ce récit, le commerce international favoriserait la paix entre les nations tandis que la politique conduirait à la guerre. Le libre-échange serait également bénéfique à tous, que vous soyez riche ou pauvre. Le commerce international serait donc un jeu « gagnant-gagnant ».
C’est loin d’être le cas. Le libre-échange a en majorité profité aux pays les plus riches, il n’a pas empêché des conflits et, enfin, beaucoup de pays qui se sont développés l’ont fait en protégeant leurs industries, dans un premier temps, de la concurrence internationale. La force du récit est d’avoir su mobiliser les mots « paix » ou « gain mutuel ». Le récit, pour être efficace, doit être simple et binaire.
Les effets négatifs du libre-échange sont évacués : domination, exploitation des ressources, inégalités, hausse de la pauvreté (notamment en Afrique).
Un autre grand récit de notre temps est celui de la construction européenne. Il est assez proche de celui du libre-échange et se résume principalement en un mot : la paix. Critiquer la montée des inégalités en Europe, la concurrence fiscale, le fonctionnement de l’euro, la casse du service public, c’est être contre l’Europe et donc pour le retour de la guerre. Le récit portant sur la construction européenne comme celui portant sur le libre-échange ont tellement imprégné les esprits que beaucoup d’économistes ou de journalistes se sont autocensurés sur cette question. Et il existe bien d’autres récits puissants en économie, comme le mythe de la réussite individuelle_, les marchés_ qui s’autorégulent, etc. Si l’on veut changer l’économie, envisager un autre avenir, il faut inventer un récit. Un expert est essentiel car il maîtrise son domaine, mais il faut aussi un récit et des voix qui le portent.
(1) « Protection de l’emploi, emploi et chômage », CAE, Focus, n° 3, 2015.
Pour aller plus loin…

Palestine : quatre auteurs pour l’histoire

George Monbiot : « Après l’hégémonie culturelle néolibérale, nous risquons celle du fascisme »

La sociologie est un sport collectif