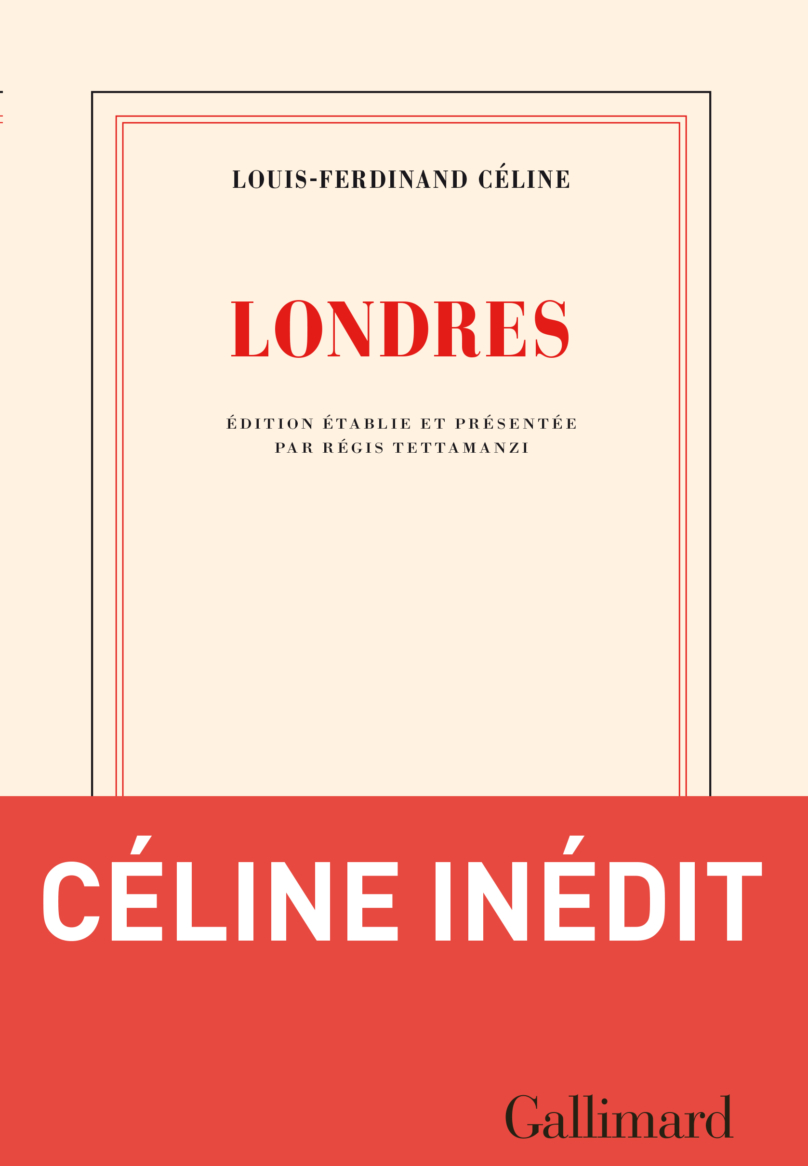« Londres » de Céline : chef-d’œuvre en cours
Deuxième inédit de Céline à paraître cette année, Londres est une incursion dans le milieu interlope de la capitale anglaise pendant la Grande Guerre. Jubilatoire et dense.

La maison Gallimard a l’art de feuilletonner. Au printemps paraissait avec succès Guerre (161 000 exemplaires à ce jour !). Ce mois-ci, c’est au tour de Londres, avant la publication de la légende médiévale La Volonté du roi Krogold. Poids différent, lecture différente.
Londres, Louis-Ferdinand Céline, préface de Régis Tettamanzi, éd. Gallimard, 555 pages, 24 euros.
Dans cette série d’inédits qui resurgissent de façon rocambolesque cette année (voir Politis n° 1707), exhumés en 2021 après la mort de Lucette Almanzor, la femme de Louis-Ferdinand Céline, Londres est le récit le plus volumineux et, surtout, le seul complet. Guerre ne pesait guère que 184 pages. Londres en compte 555. C’est énorme. Dans la fabrique célinienne, il en dit davantage. Sachant que ce manuscrit, rédigé entre 1934 et 1935, comme Guerre, a disparu en 1944, quand l’auteur a fui Paris pour le Danemark, avant d’être reclus à Sigmaringen.
Guerre s’achevait sur le départ du narrateur Ferdinand, réformé pour cause de graves blessures – un départ pour l’Angleterre, après le traumatisme de la guerre éprouvé dans les Flandres. Londres s’ouvre avec ce même narrateur et Angèle, en bonne pute dans le roman précédent, « une môme que la passion plaçait dans le cœur des choses et des gens ». Cornaquée par Cascade, qu’elle fait fusiller en le dénonçant comme mutilé volontaire, la voilà maintenant soutenue par un protecteur anglais fortuné, le major Purcell, déjà présent dans Guerre.
Londres : une épopée animée de rencontres, de fricotements, d’amitiés et d’inimitiés, de rivalités et de règlements de comptes, de situations cocasses.
C’est un narrateur installé un peu à l’écart de Picadilly Circus, non loin d’un petit marle de Montpellier, Cantaloup, charismatique, pourvoyeur dans la traite des femmes blanches ; un narrateur plongé dans les milieux de la prostitution londonienne (ce qui vaut des scènes salaces). Tel est le point de départ de Londres, une épopée animée de rencontres, de fricotements, d’amitiés et d’inimitiés, de rivalités et de règlements de comptes, de situations cocasses.
L’universelle vacherie
Londres est un roman fou. On se perd facilement dans ce dédale, ce tourbillon romanesque dynamique. Un labyrinthe d’histoires qui s’enchevêtrent. Avec Guerre, on savait où aller. Avec Londres, c’est autre chose, « tant la multiplicité des personnages, la déconstruction du récit, l’étoilement des intrigues dessinent une trajectoire qui n’est rien moins que linéaire », note Régis Tettamanzi dans sa remarquable préface.
C’est d’abord le parcours d’un narrateur aux abois, qui cherche refuge, une planque, un endroit sûr pour échapper à la police anglaise, avec le risque d’être renvoyé au front du côté de la Somme. La guerre n’est jamais très éloignée. « On la sentait dans Londres la guerre et partout mais de loin encore. Sur le pavé le soir venu c’était encore plus bourré d’attractions que d’habitude et les magasins congestionnés d’amateurs. »
Régis Tettamanzi y voit un roman de la prostitution. Ça l’est, « dans le bordel et ses rites, la prostituée qui tombe enceinte, celle qui double son homme, la brutalité des proxénètes, l’échange marchand avec les michés ».
Comme dans Guerre ou Voyage au bout de la nuit, comme dans Mort à crédit ou la trilogie allemande (D’un château l’autre, Nord et Rigodon), on est confronté à l’universelle vacherie. On est bien chez Céline : au-delà de tout jugement moral, et dans l’outrance que permet la création littéraire.
Ce sont surtout l’art du portrait et les relations humaines qui frappent dans ce roman épique.
Dans ce concert romanesque, tout le monde se vaut. Tous cruels, alliés, inconséquents. La part moche étant donnée aux hommes, cette galerie de portraits masculins, comme le souligne Régis Tettamanzi, regorgeant « d’imbéciles, voire de fous furieux, voyous patentés, brutaux, sans vergogne ni compassion ». En face, si elles ne valent pas mieux, on assiste à un affranchissement des femmes. Au forceps, certes.
Comme Guerre, Londres ne manque pas de fulgurances littéraires. Elles sont même nombreuses. À côté d’un art de la description du paysage urbain alentour, ce sont surtout l’art du portrait et les relations humaines qui frappent dans ce roman épique.
Ainsi Bijou, proxénète et indicateur de police, « bourrin qu’il était. Fallait que je la clôture sa gueule. Je me sentais devenir héros quand il me parlait. Chacun sa guerre. Il se prenait déjà pour trop caïd tel quel. Ça m’aurait plu quand même de lui calibrer la tronche dans l’encoignure d’un égout ». Ou Borokrom, ancien militant anarchiste ou communiste, désabusé, amateur d’explosifs et doué pour la musique, qui se traîne « dans la vocifération comme un vieil ébéniste dans son absinthe ».
Roman double
Londres fourmille de personnages hauts en couleur. Céline forçant le trait. Orbitane, ancien terroriste albanais ; Aumone, proxénète occasionnel, peintre, ancien taulard, torturé en prison ; Rodriguez, un affabulateur mystique, déserteur, joueur et saltimbanque, à la nationalité mal définie, probablement argentine, accompagnant une troupe de souteneurs ; la famille Peacock, « jongleurs aux sabres, revolvers et couteaux », encadrant « à tour de rôle de lames vibrantes à pleins tranchants vingt-huit poignards », semant « le meurtre à pleine main dans l’air comme l’avoine. Après, c’est au revolver qu’ils s’amusent, et des petits œufs qu’ils se font éclater au bout du nez, au jugé, yeux bandés, à dix mètres » ; un Yorick, vieil Écossais en kilt, ami de Ferdinand, jouant de la flûte, n’ayant pas son pareil pour se repérer dans le brouillard de Londres ; un colonel, Moramar Dora, « grisonnant et fort nuancé, loin des tentations de la chair et du jeu », compagnon d’une grande finesse, d’une exquise courtoisie, « prenant à ne froisser quiconque les plus grands ménagements ». Mais frugal, sensible, tricheur, « plus décoré qu’un trône, corrompu » ; un baronnet anglais, Lawrence Gift, propriétaire d’un château aux environs de Londres, capitaine dans l’armée, alcoolique, fantaisiste et farfelu, serré par la maréchaussée pour avoir aidé des souteneurs à vendre un bijou de contrebande.
Liste non exhaustive de portraits auxquels s’ajoutent quelques sentences propres à Céline. Qu’on en juge : « Les controverses du sport, ça porte au périnée » ; « C’est fumier les femmes, c’est pas fidèle du tout. Ça demande qu’à changer d’âme » ; « Quand on n’a pas d’instruction, peu d’intuition, c’est les préjugés et la peur qui dominent. » Céline pur jus, première bourre.
Londres n’est pas le canevas de Guignol’s band, malgré des similitudes nombreuses.
Le spécialiste ou lecteur averti de Céline aura tôt fait, à la lecture de Londres, de songer à Guignol’s band, paru en 1944, peu lu mais considéré comme le meilleur roman de l’auteur, où plane l’ombre de Shakespeare, théâtre des tribulations d’un Ferdinand narrateur, dans les milieux interlopes de Londres pendant la Grande Guerre.
Mais Londres n’est pas le canevas de Guignol’s band, malgré des similitudes nombreuses. C’est un roman double. Un à-côté, une barre parallèle, avec des divergences, des correspondances qui n’intéresseront que les spécialistes. Par rapport à Guignol’s band, Londres propose son volet de déambulations à travers la ville, comme le fera plus tard Michel Butor avec Bleston dans L’Emploi du temps. Le quartier de Soho pour commencer, d’autres autour de Hyde Park, Greenwich, Willesden – plus éloigné du centre – et le Dorset.
Pas encore le « style Céline »
Surtout, comme pour Guerre, il n’y a pas encore la patte stylistique de Céline, ni sa ponctuation particulière. Londres est un chef-d’œuvre certes en cours, mais achevé. Avec une fin en suspension. Mais n’est-ce pas le cas pour Mort à crédit, publié deux ans après cette rédaction, en 1936 ?
Détail remarquable, ici : celui de l’interpellation du lecteur par un narrateur qui sait devoir le maintenir dans le fil de ses déambulations, lui donner des repères. De fait, Ferdinand n’a de cesse de causer, de réclamer qu’on le suive dans ses élucubrations (« Je jacasse, je m’embrouille »). On est loin de Voyage, on se rapproche des Entretiens avec le professeur Y et de la trilogie allemande.
Avec Londres, comme pour Guerre, on n’est pas encore tout à fait entré dans le style propre à Céline, celui amorcé dans Mort à crédit – parce que Voyage au bout de la nuit, quand même en rupture avec sa production contemporaine (1932), reste somme toute classique, quasi proustien, avec des personnages stéréotypés.
Londres a néanmoins plus à voir avec Mort à crédit, dans le dessin de ses personnages à foison, hauts en couleur, dont Céline s’amuse (c’est évident qu’il s’amuse), s’autorisant toutes les exagérations – mais chez Céline, on n’exagère jamais assez.
En 1934, au moment de la rédaction de ce texte, Céline n’a pas encore basculé dans son antisémitisme immonde. Dans Londres, les juifs sont présents. Mais comme d’autres personnages. Des laissés-pour-compte parmi les quartiers misérables.
Dans ce roman truculent, reste en suspens la question juive chez Céline. Dans Londres, comme dans Guerre, il n’y a pas d’antisémitisme, sinon subtilement, à décrypter. On le répète, en 1934, au moment de la rédaction de ce texte, Céline n’a pas encore basculé dans son antisémitisme immonde. Dans Londres, les juifs sont présents. Mais comme d’autres personnages. Des laissés-pour-compte parmi les quartiers misérables.
Un premier jet abouti
Dans sa préface, Régis Tettamanzi prévient le lecteur : « Il n’y a en réalité qu’un seul personnage juif dans Londres ; il a certes des défauts mais, en comparaison avec la galerie de détraqués, d’inconséquents, d’irresponsables qui forment le personnel romanesque, il apparaît comme assez positif. »
Ce médecin juif, Yugenbitz, est celui qui initie Ferdinand à l’art de guérir, qui lui prête des livres pour son instruction, qui en fait même son assistant. S’il y a une vocation pour la médecine, elle naît bien à Londres, auprès de ce médecin juif dont Ferdinand aurait « léché les mains, je serais mort pour lui, sur place ».
Au-delà de la vocation médicale, on voit avec Londres une vocation littéraire. C’est tout l’intérêt de ce texte. Avec un narrateur qui se plaît à raconter des histoires. La Légende (ou La Volonté) du roi Krogold, livrée par bribes, selon le public et les circonstances, en est un exemple. S’il a déjà en boutique Voyage, Céline se mesure, se confronte à la littérature, fouille tous les possibles qu’offre le roman, insérant du récit dans le récit. Pour un premier jet, c’est déjà très abouti.
Pour aller plus loin…

« Villa Bergamote » : l’argent, médaille et revers

« Je viens d’un pays qui n’existe plus »

« Lundi, ils nous aimeront » : la liberté avant tout