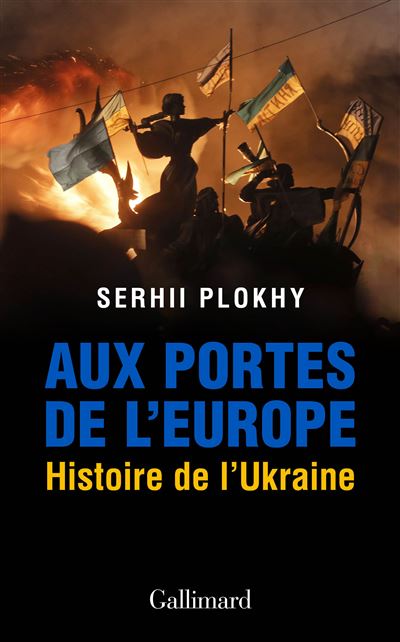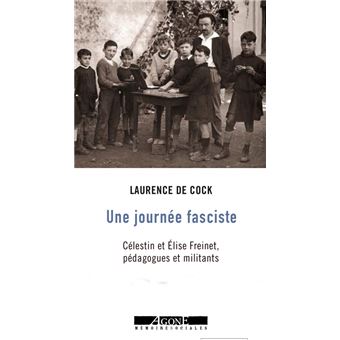Ukraine : le long combat pour une place dans l’histoire et sur les cartes
Un ouvrage historique décrit les évolutions mouvementées de ce territoire longtemps ballotté entre Autriche-Hongrie, Pologne, Prusse et Russie, devenu nation à part entière seulement au XXe siècle.
dans l’hebdo N° 1735 Acheter ce numéro

© STRINGER / AFP
Lviv, Lvov ou Lemberg ? Kharkov ou Karkhiv ? Kiev ou Kyiv ? La manière d’épeler les noms des villes d’Ukraine rappelle les conflits du passé, entre les différents empires et autres formes de domination sur ce territoire « portes de l’Europe ». Car toutes ces dénominations résument autant la géographie que l’histoire de cette contrée.
Titulaire de la chaire d’histoire de l’Ukraine à l’université de Harvard, Serhii Plokhy retrace – depuis l’Antiquité et les premiers récits d’Hérodote – le destin mal connu de cette terre située au nord du Pont-Euxin, nom antique de la mer Noire (qui signifie la « mer hospitalière » en grec ancien), où des colonies grecques furent implantées dès le VIIe siècle avant notre ère. À partir de l’Empire romain, ses grandes steppes fournissent déjà en grains une bonne partie du bassin méditerranéen, attisant les convoitises…
Pour comprendre les prétentions russes sur l’Ukraine dans l’actuel conflit, c’est au Moyen Âge qu’il faut remonter.
Mais pour comprendre les prétentions russes sur l’Ukraine dans l’actuel conflit, c’est au Moyen Âge qu’il faut remonter : l’URSS et aujourd’hui la Russie de Poutine s’appuient sur une « fiction historique » qui voudrait que l’unité des territoires actuels ukrainien, biélorusse et russe – constituée sous le nom de « la Rus’ de Kiev » entre le IXe et le XIIIe siècle, réactivée par le traité dit de Pereïaslav en 1654 – ait été une réalité russe.
Au lendemain de la mort de Staline, le pouvoir soviétique avait déjà voulu célébrer la « réunification » entre Russie et Ukraine, lors du tricentenaire dudit traité. Une « commémoration » que le régime soviétique appelait la « fraternité » russo-ukrainienne, advenue après l’annexion par l’URSS de l’Ukraine au lendemain de la révolution d’Octobre, tandis que la terrible famine de 1932 ordonnée par Staline visait à « mater » les résistances de Kiev, et alors que certains Ukrainiens rejoignirent les armées du Reich après l’invasion de l’Allemagne nazie en 1941, par haine de Moscou.
Sur ce point, on lira le passionnant roman de Giuliano da Empoli, qui décrit le fonctionnement de l’entourage de Poutine : Le Mage du Kremlin, Gallimard, 288 pages, 20 euros.
La propagande poutinienne est donc structurée par toutes ces fictions historiques d’une Ukraine partie intégrante de la Russie, ou plutôt de cette URSS « spectrale » que l’autocrate du Kremlin tente de réhabiliter (1). Et par l’histoire de l’Ukraine contemporaine qui, dès les années 1990, se tourne vers l’Ouest en tentant d’instituer une démocratie. Dans ce livre majeur qui décrypte les « éléments de langage » poutiniens, l’auteur explique pourquoi l’« opération militaire spéciale » du 24 février dernier est censée « dénazifier » l’Ukraine.
Si l’ouvrage de Plokhy, paru d’abord en 2015, est une édition augmentée retraçant l’histoire de ce pays jusqu’en 2021, il ne traite toutefois pas du conflit en cours. D’où l’intérêt de deux courtes interventions, l’une du linguiste engagé Noam Chomsky, l’autre du romancier Jonathan Littell, grand connaisseur de l’histoire de l’Europe orientale et auteur des Bienveillantes (prix Goncourt 2006).
Faiblesses occidentales
Celui-ci publie en effet dans la collection « Tracts », chez Gallimard, une petite série d’« écrits polémiques » : De l’agression russe. Soulignant la nécessité de ne pas baisser la tête alors que l’Occident l’a trop longtemps détournée devant des agressions répétées, il s’insurge d’abord contre nos dirigeants occidentaux qui, « depuis vingt-deux ans, ont appris [à Poutine] que nous sommes faibles ».
Et de prévenir : après avoir rasé Grozny et Alep, « ne croyez pas que, parce que c’est une ville “européenne”, Poutine hésitera à raser Kyiv ». La « seule issue », selon Littell, est de « rendre l’échec de Poutine en Ukraine tellement désastreux pour la Russie et ses intérêts véritables, que sa propre élite n’aura d’autre choix que de se débarrasser de lui ».
Le linguiste Noam Chomsky, grand intellectuel, critique depuis des décennies à l’égard de la pensée dominante occidentale – jusqu’à défendre le négationniste Faurisson au nom de la liberté d’expression –, nous met en garde, dans un ouvrage d’entretiens, contre une vision trop unilatérale du conflit en Ukraine, prudent face aux trop nombreuses « évidences » énoncées par le passé, qui exigeaient d’embrasser le camp du bien.
Son analyse d’outre-Atlantique est ainsi précieuse, soulignant que l’extension de l’Otan en Europe orientale s’est faite en dépit des dénégations des États-Unis lors de l’effondrement de l’URSS. Sans jamais remettre en cause les crimes de guerre russes, Chomsky nous prévient toutefois contre une politique extérieure états-unienne qui « nuit à une désescalade en Ukraine ». Toute guerre n’oppose pas, sans conteste, que des bons et des méchants…
À lire sur le sujet
Aux portes de l’Europe. Histoire de l’Ukraine. Serhii Plokhy. Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jacques Dalarun, éd. Gallimard, « Bibliothèque des histoires », 560 pages, 32 euros.
De l’agression russe. Écrits polémiques. Jonathan Littell, éd. Gallimard, « Tracts », n° 43, 64 pages, 3,90 euros.
Le précipice. Noam Chomsky. Entretiens avec C.J. Polychroniou, traduit de l’anglais (États-Unis) par Nicolas Calvé, éd. Lux, 328 pages, 22 euros.
Les autres livres de la semaine :
Du savon et des larmes. Le soap opera, une subculture féminine. Delphine Chedaleux, éd. Amsterdam, 250 pages, 18 euros.
Plus belle la vie, le « soap opera » de la télévision publique française par excellence, a définitivement pris fin le mois dernier. Quel meilleur contexte pour se lancer dans la lecture de cet ouvrage ? Souvent dénigrée, la série à l’eau de rose féminine est une culture de niche à part entière, qui influence fortement des médias considérés comme plus nobles. Dans cet ouvrage, l’historienne des médias Delphine Chedaleux se plonge dans un genre ultra-codifié, répondant à des impératifs ultra-capitalistiques tout en s’adressant à une frange de la population souvent déconsidérée – les ménagères et les adolescentes –, donnant naissance à des formes de sociabilité dédaignées par ceux qui méprisent les cultures féminines… et avec un potentiel révolutionnaire surprenant.
Une journée fasciste. Élise et Célestin Freinet, pédagogues et militants. Laurence De Cock, éd. Agone, « Mémoires sociales », 232 pages, 19 euros
Le 24 avril 1933, à Saint-Paul, dans l’arrière-pays niçois, l’instituteur Célestin Freinet – appelé à devenir l’un des plus grands pédagogues français – sort un revolver dans la cour de son établissement pour protéger les élèves dont il a la charge face à une manifestation d’extrême droite qui menace son école et conteste surtout sa méthode éducative favorisant la liberté d’expression des enfants. Narré par l’historienne Laurence De Cock, cet événement, déjà relaté alors dans L’Éducateur prolétarien, journal syndical enseignant, témoigne de la passion de l’enseignant et de sa femme, Élise, pour la pédagogie populaire, et plus largement de leur résistance au fascisme qui croît dans le pays. Un beau livre d’histoire. Dont le combat est toujours actuel.
Pour aller plus loin…

« La science est la meilleure alliée des luttes pour la santé environnementale »

Cette encombrante démocratie

Palestine : quatre auteurs pour l’histoire