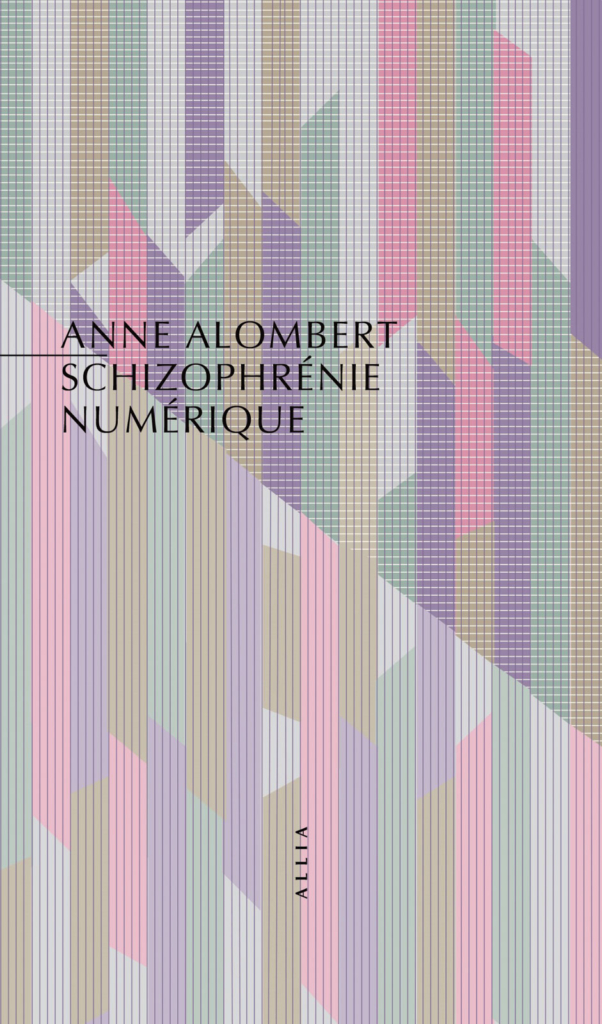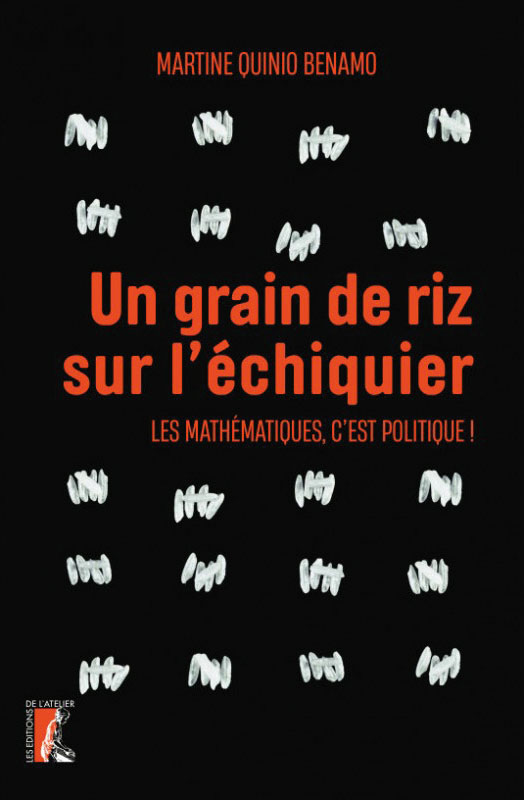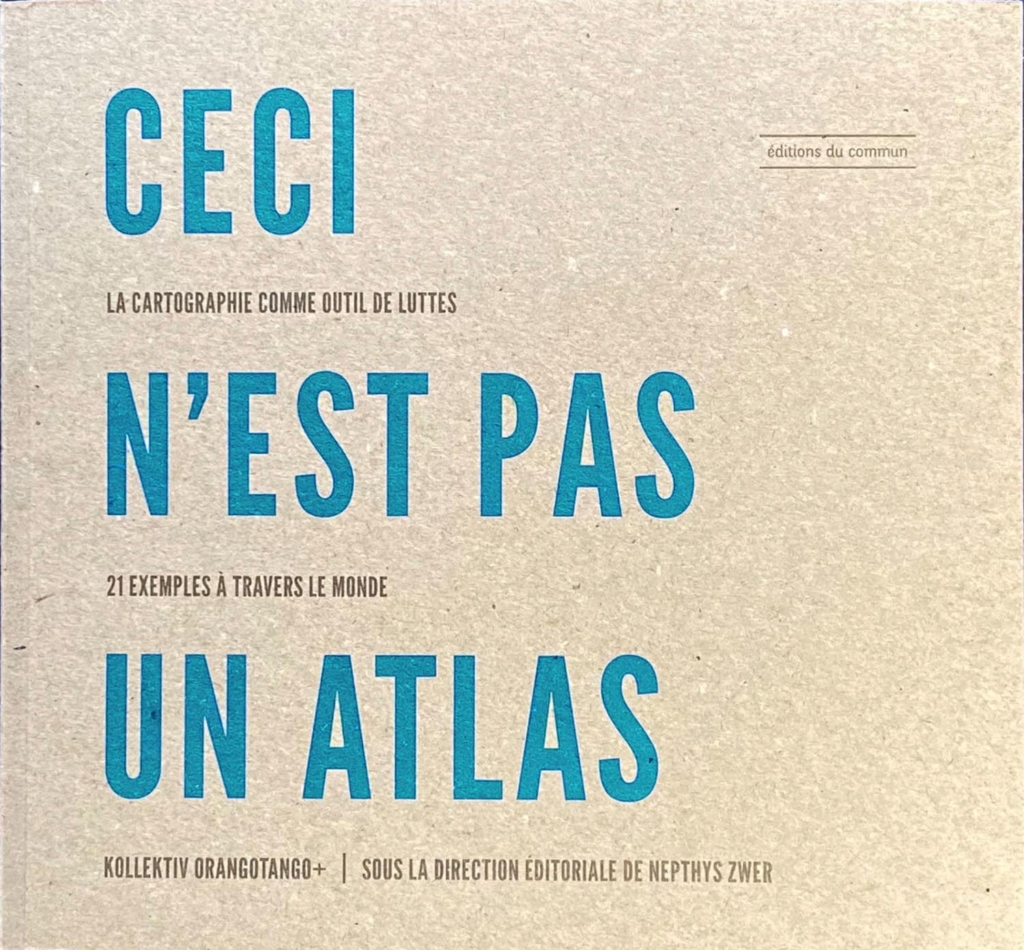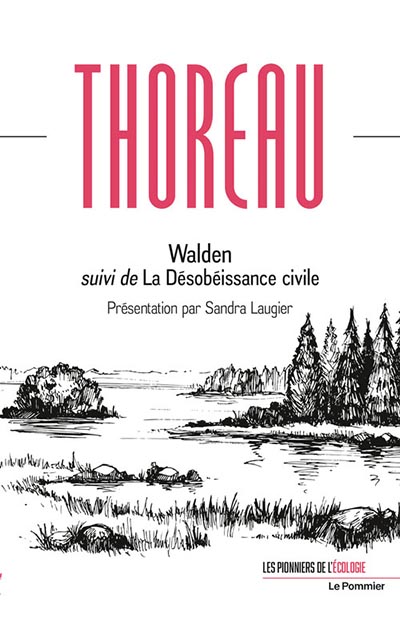Un autre numérique est-il possible ?
La philosophe Anne Alombert analyse les effets des « nouvelles technologies » sur les sociétés contemporaines. Qui, doubles, tendent à développer une véritable « schizophrénie numérique » : sans pouvoir s’en passer, elles contribuent à une gouvernance par les nombres, en phase avec le néolibéralisme.
dans l’hebdo N° 1754 Acheter ce numéro

Schizophrénie numérique, Anne Alombert, éditions Allia, 96 pages, 7,50 euros.
Il est sans aucun doute du devoir de la philosophie (et des philosophes) d’aborder les effets des récentes évolutions technologiques sur les capacités cognitives de l’homme, et en particulier son adaptation aux conséquences de l’extraordinaire « stimulation informationnelle » à laquelle ces « progrès » techniques le soumettent.
Après les révolutions industrielles des siècles passés, où la production d’objets s’est accrue de manière exponentielle, la révolution numérique, qui a permis une « augmentation technique du savoir » couplée à celle de la « mémoire artificielle », constitue un défi inédit pour l’intelligence humaine. Les supports numériques augmentent de manière incommensurable la capacité du stock d’informations conservées. Doit-on s’en réjouir, ou bien s’en effrayer ?
C’est la question posée dans ce petit essai, aussi dense que pointu, par la philosophe Anne Alombert. Son titre en résume bien le dilemme : « schizophrénie numérique ». Ces « nouvelles » technologies nous sont-elles bénéfiques ? Ou bien nuisibles ? Voire les deux en même temps ? Celles-ci, personne ne peut le nier, ont permis l’accès à « une diversification sans précédent » des sources d’information, de leur production, mais aussi des possibilités et des pratiques de leur partage. Au-delà de l’enjeu environnemental, puisqu’on sait depuis des années combien, d’un point de vue écologique, leur fonctionnement n’est pas durable, l’auteure dénonce aussi leur appropriation par des acteurs privés, au nombre très limité.
En bonne spécialiste de la philosophie des techniques, et notamment de l’œuvre de Gilbert Simondon, elle affirme que « rien ne sert de rejeter ou de diaboliser » les technologies numériques – posture inutile, que personne ne serait réellement aujourd’hui en mesure de suivre – en dehors peut-être de rares ermites.
Et elle souligne la nécessité de connaître et d’enseigner l’histoire et l’anthropologie des technologies numériques – web, réseaux sociaux, intelligence artificielle, etc. –, mais aussi des luttes politiques, trop peu connues, qui ont entouré leur création et leur développement.
Tous les savoirs sont affectés par la numérisation des technologies.
Alors que la très grande majorité de la population ignore comment ont été produits puis diffusés ces premiers contenus en ligne, un tel enseignement, dès l’école primaire, permettrait « d’inscrire les institutions scolaires au cœur des évolutions contemporaines des sociétés ».
Algorithmes et désirs mimétiques
Plus largement, une telle éducation pourrait transformer les citoyens de récepteurs passifs de toutes sortes d’informations (ou de désinformations) en producteurs « critiques » de savoirs collectifs. Car, tout comme lors de l’avènement de l’imprimerie, ou de la généralisation de la machine à écrire, aujourd’hui « tous les savoirs sont affectés par la numérisation des technologies ».
Mais Anne Alombert nous met surtout en garde contre la « gouvernance par les nombres ». Qui s’avère particulièrement « caractéristique de l’ultralibéralisme ». Au lieu de développer les désirs multiples de chaque individu, ces technologies, reposant sur des algorithmes supposés « détecter » les besoins ou les envies des utilisateurs sur la base de leurs « traces laissées en ligne », finissent par susciter en eux des désirs mimétiques. Ils deviennent in fine une sorte de « foule mimétique ». Contre cette uniformisation, contre cette « économie de l’attention et des données », si chère au néolibéralisme, l’auteure appelle à œuvrer pour « des technologies contributives au service d’une économie des savoirs partagés ».
Si une économie des communs a déjà été largement théorisée, son application dans le domaine du numérique « tarde à se concrétiser », regrette la philosophe. Et Anne Alombert d’appeler à juste titre « non [à] rejeter le numérique pour retourner à une nature fantasmée », mais bien à mettre au service des communs et de l’intelligence collective ces technologies numériques dont on ne peut aujourd’hui se passer, plutôt qu’à l’exploitation des attentions individuelles ou de la marchandisation des données personnelles.
Les livres de la semaine
Un grain de riz sur l’échiquier. Les mathématiques, c’est politique !, Martine Quinio Benamo, Éditions de l’Atelier, 160 pages, 17 euros.
Dans un débat, citer un chiffre est souvent l’argument massue. Courbes, pourcentages, moyennes, probabilités : nombre de décisions politiques sont prises à partir d’indicateurs chiffrés, écartant ainsi presque toute contestation. Mathématicienne, Martine Quinio Benamo dénonce ici le « manque d’accès à la culture scientifique », en particulier mathématique, alors que celle-ci constitue un enjeu démocratique. Écologie, crise du covid, changement climatique, santé : ces questions ne sauraient être laissées aux seuls « spécialistes ». Et l’auteure d’appeler à des maths « populaires » pour mieux qualifier, au lieu de (seulement) quantifier.
Ceci n’est pas un atlas.
La cartographie comme outil de luttes. 21 exemples à travers le monde, kollektiv orangotango+, Nepthys Zwer, Éditions du Commun, 350 pages, 25 euros.
Tout comme les chiffres, les cartes sont supposées fixer dans une représentation spatiale des données économiques et sociales. Sauf que cette cartographie traditionnelle « conforte » en réalité la représentation spatiale des pouvoirs en place. C’est tout l’objet de la « cartographie critique » que de révéler une réalité souvent occultée : celle des inégalités des conditions de vie et de droits, de l’accaparement des terres par l’agro-industrie, de la pollution de la planète par l’industrie extractive : à partir de 21 exemples autour du globe, cette « contre-cartographie » déjoue les représentations dominantes et met à plat les structures de pouvoir. Pour œuvrer à une prise de conscience collective.
Walden suivi de La Désobéissance civile, Henry David Thoreau, présenté par Sandra Laugier, traduit de l’anglais (États-Unis) par Louis Fabulet et Léon Bazalgette, Le Pommier, 466 pages, 16 euros.
En cette période de criminalisation et de répression massives des mobilisations sociales et écologiques, relire (ou découvrir) ces deux classiques d’Henry David Thoreau, pionnier visionnaire du concept de « désobéissance civile », est particulièrement utile aujourd’hui. Sans oublier Walden, récit de ses années passées au plus près de la nature et en harmonie avec elle, on lira en particulier l’introduction de Sandra Laugier, philosophe spécialiste de la démocratie, qui explique que, si « on ne peut désobéir qu’en démocratie », cette forme d’action, légitime, exprime « le sentiment d’une trahison des idéaux de la démocratie ». Un rappel dont devrait se souvenir Gérald Darmanin.
Pour aller plus loin…

Médecine alternative : l’ombre sectaire

Didier Lestrade : « On assiste à des retours en arrière effroyables »

Julie Couturier : « Attaquer l’État de droit, c’est attaquer la démocratie »