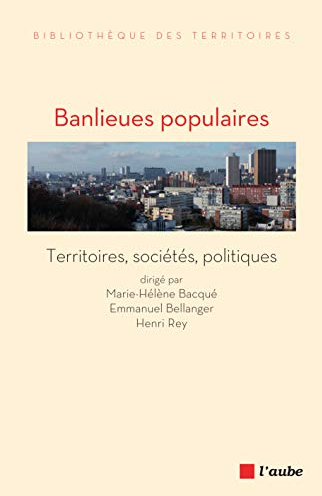« Le chaos » et « l’émeute » : les tenants d’un récit médiatique dangereux
La mort de Nahel, adolescent de 17 ans tué par la police mardi 27 juin à Nanterre, a embrasé deux nuits de suite le pays. Des événements dont le traitement médiatique repose la question de la relation entre certains médias et les quartiers populaires.

Dans le même dossier…
« Emmanuel Macron ne comprend rien aux banlieues » En Macronie, surdité et répression « Ils veulent des boucs émissaires » : à Nanterre, une justice expéditive La police face aux révoltes des banlieues : continuités et échecs du maintien de l’ordreLes choses étaient déjà mal parties. Quelques heures seulement après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier à Nanterre, les premiers médias d’information en continu livrent, sans se donner la peine de vérifier, la version de la préfecture. BFMTV, 10 h 48 : « Ce matin 8 h 16, refus d’obtempérer d’une Mercedes de couleur dorée. Un policier se met à l’avant pour le stopper. Le conducteur lui fonce dessus, le policier tire une fois. » Ils sont plusieurs aussi, à relayer la fausse information selon laquelle la victime traînait un casier judiciaire « déjà long et [était] très connu[e] des services de police », avant de se rétracter. Mais le mal est fait.
Au matin d’une seconde nuit de violences dans plusieurs villes de France, matinales radio, chaînes de télévision comme quotidiens nationaux se partagent les mêmes éléments de langage. C’est le « chaos en Île-de-France » relate BFMTV, « une nuit de cauchemar » écrit Le Monde. « La mort de Nahel va-t-elle précipiter la France dans un climat de “guerre civile” ? » s’interroge Le Figaro.
Une légitimité politique confisquée
Et toujours ce même terme, celui d’émeutes, dont l’étymologie renvoie sans équivoque au soulèvement violent d’une meute. « Il y a une longue histoire des termes utilisés pour désigner ces jeunes. Parler d’eux comme des “émeutiers” leur enlève le droit d’être des manifestants et donc d’avoir des revendications politiques », explique Julie Sedel, maîtresse de conférences, directrice de recherche en sociologie et science de l’information et autrice de plusieurs travaux sur ce sujet dans les années 2000 (voir Les Médias et la banlieue Lormont, INA/Bord de l’eau, 2009).
Invitée sur France Inter ce matin, Camille Chaize, porte-parole du ministère de l’Intérieur, a fait le point sur les dégradations, en choisissant pour exemple le bâtiment de la brigade d’assistance des sans-abri de la préfecture de police de Paris, touché par des mortiers. « Donc ce n’est pas seulement des symboles de l’État, c’est tous les services publics, même ceux à destination des plus démunis qui ont été touchés. Il ne faut pas forcément chercher des symboles derrière tout ça. C’est vraiment des émeutes, de la violence. » Sans être contredite, ni par la journaliste Léa Salamé, ni par les autres invités.
Cette phrase illustre la représentation qu’une large partie des médias livrent depuis mardi soir : la colère qui embrase l’Île-de-France et ailleurs n’est pas d’ordre politique. Il suffit pour s’en rendre compte, de comparer le vocabulaire utilisé avec celui du traitement des nombreuses manifestations « sauvages » qui avaient lieu chaque soir au pic du mouvement contre la réforme des retraites. C’était une « colère noire face à une réforme jugée injuste ». Même lorsqu’elles dégénéraient, c’était une « foule » de « manifestants », dont des « personnes, parfois cagoulées » qui mettaient le feu aux poubelles. Et dans la majorité de ces reportages, les journalistes donnaient la parole aux insurgés pour exprimer leurs revendications.
« Télégénie de la violence »
Or, dans tous les récits des deux dernières nuits, même ceux des médias aux lignes éditoriales qualifiées de « neutres », le regard ne se tient que d’un côté de la barrière : celui des forces de l’ordre. Au mieux, peut-on entendre la voix de quelques habitants, des « parents d’élèves », venus défendre leur quartier. Les « émeutiers », eux, sont réduits à une masse informe, silencieuse, anonyme et dangereuse.
Une voiture qui brûle, ça génère du clic, de l’audience du trafic.
Déjà en 2005, c’était le même constat, selon Julie Sedel. « On se retrouvait avec un traitement journalistique assez homogène, focalisé sur les débordements, les dégradations, les aspects les plus spectaculaires et visuels de ces soulèvements. Cela sans prise de distance, d’analyse des événements. Pour comprendre le traitement journalistique de ces soulèvements, il faudrait pouvoir étudier l’ensemble des acteurs impliqués, à la fois, les jeunes de ces quartiers pour qui « l’émeute » peut constituer un mode d’action pour interpeller les pouvoirs publics, l’État pour qui l’enjeu, à travers les interventions de forces de l’ordre, est de montrer sa capacité à rétablir l’ordre, les syndicats de police qui défendent leur corporation, les avocats qui représentent les familles de victimes, les acteurs politiques qui se saisissent des soulèvements pour se positionner dans le champ politique, etc. ». « Il y a une télégénie de la violence. Une voiture qui brûle, ça génère du clic, de l’audience du trafic, détaille Alexis Lévrier, historien de la presse et des médias. Aujourd’hui, c’est même plus le cas qu’en 2005 avec un paysage médiatique dominé par les chaînes d’infos en continu, dont CNEWS, qui mène, en plus, une guerre culturelle terrible. »
Au-delà des plateaux d’éditorialistes et d’experts, sur le terrain une chose est indéniable : il est difficile pour les journalistes de travailler dans les cités. D’un côté les policiers verrouillent leurs infos, mais garantissent aux journalistes une protection. De l’autre, les habitants consentent rarement à répondre à leurs questions. Une conséquence, selon Julie Sedel, du traitement médiatique des banlieues depuis les années 1980, où ont été mis en lumière les premiers cas de « bavures policières ».
« Il y a chez les médias une hésitation à donner la parole à ces jeunes. »
« S’il y a ces colères, c’est qu’il y a des années de violences policières dans les quartiers populaires, et cette violence reste peu traitée par les médias dans ses dimensions quotidiennes. Or, quand on travaille avec des jeunes qui y habitent, c’est la première chose qui vient. Un jeune racisé, aujourd’hui, a peur de la police. Et il a raison d’avoir peur », estime Marie-Hélène Bacqué, sociologue et urbaniste, coauteure de Banlieues populaires : territoires, sociétés, politiques (Bibliothèques des territoires, 2018). « Il y a chez les médias une hésitation à donner la parole à ces jeunes. Moi-même, quand je suis invitée à m’exprimer sur ces questions sur des plateaux TV, je ressens souvent un malaise », ajoute-t-elle.
Certes, le paysage médiatique s’est enrichi depuis novembre 2005 de nouvelles voix, notamment via le Bondy Blog, média né de ces événements collectivement traumatiques. Mais face aux reportages diffusés depuis mardi soir, on est en mesure de se demander quelle a été la marge de progression au sein des médias mainstream qui, force est de constater, ne s’aventurent dans les quartiers populaires que sous l’angle du fait divers et de la violence urbaine.
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

Justice climatique : quatorze citoyens en colère

« Que l’État joue enfin son rôle avec un vrai plan d’adaptation climatique »

L’inceste et l’affaire Le Scouarnec : ni silence, ni omerta