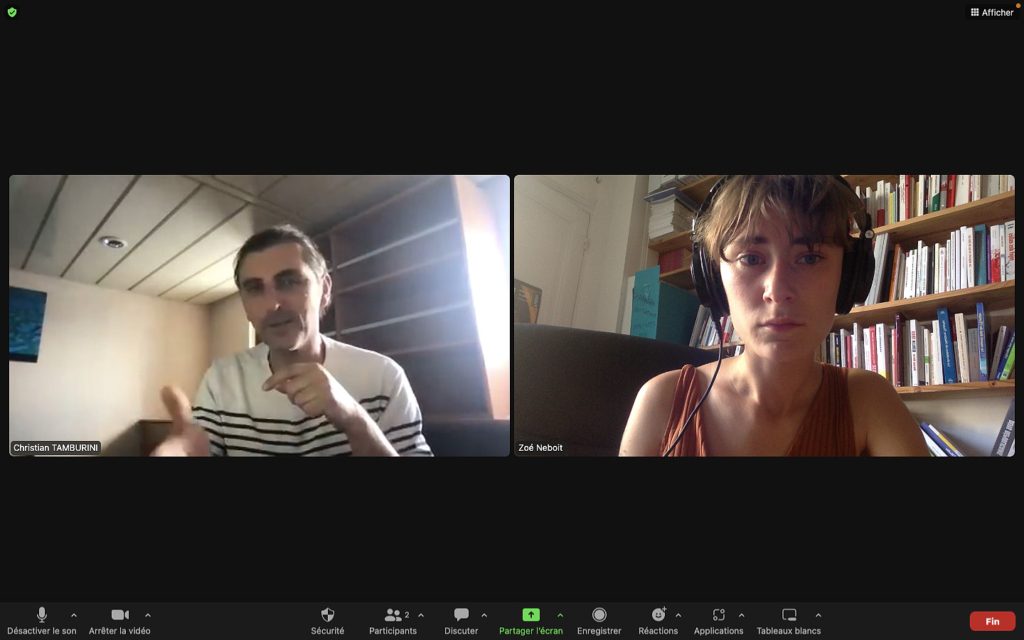Exploitation minière : 20 milliards sous les mers
Peu connue du grand public, l’exploitation minière des fonds marins est l’une des grandes batailles écologiques actuelles. En passe d’être gagnée ?
dans l’hebdo N° 1767-1771 Acheter ce numéro

Dans le même dossier…
Face à la prédation humaine, une lutte globale surgit de la mer Dans la Manche, les cétacés sur écouteIl n’y a pas si longtemps dans l’histoire de l’humanité, la surface des océans était une frontière. La limite nous séparant d’un monde aussi inconnu qu’inquiétant, au-dessus duquel marins et passagers n’embarquaient pas sans une prière. Mais, en 2023, même les abysses cèdent à la vaste anthropisation du monde. Exploitations offshore, câbles sous-marins, submersibles touristiques, etc. L’économie bleue est en train d’exploser « à tous les niveaux », constate sans détour Joachim Claudet, directeur de recherche et conseiller pour l’océan du CNRS. Si vite que le droit international ne suit pas.
La France est pour l’heure le seul pays au monde à demander l’interdiction de toute activité minière.
C’est précisément ce qui est en train de se passer avec l’exploitation minière des fonds marins, souvent désignée par sa dénomination anglophone, le deep sea mining. Jusqu’ici, un vide juridique et le statut de « patrimoine commun de l’humanité » accordé à ces fonds en haute mer rendaient cette pratique d’extraction de facto interdite. Mais c’est précisément ce vide qui pourrait donner lieu, dès cette année, à une exploitation des nodules polymétalliques, ces cailloux noirs riches en métaux – cobalt, manganèse, nickel et cuivre – qui tapissent les profondeurs, essentiellement du Pacifique Sud.
Consensus scientifique
La connaissance encore partielle du milieu ne permet pas de prévoir d’avance l’ensemble des conséquences de cette activité sur l’environnement, le climat et la biodiversité. Mais un consensus scientifique quasi inédit s’accorde sur une hypothèse : l’exploitation minière des fonds marins pourrait avoir des impacts catastrophiques et irréversibles. « Je crois même que ce consensus scientifique est plus partagé que celui sur le réchauffement climatique », avance Joachim Claudet.
Christian Tamburini, océanologue microbien au CNRS et chercheur à l’Institut méditerranéen d’océanologie, travaille sur les fonds marins depuis vingt ans. Depuis le bateau Pourquoi pas ?, sur lequel il s’est embarqué pour la campagne de recherche « APERO » visant à étudier le stockage de carbone par l’océan dans l’Atlantique Nord, il partage ses inquiétudes. « Dans les milieux extrêmes comme les fonds marins, le temps est plus lent. Cela veut dire que la biodiversité met plus de temps à accomplir ses cycles, elle est plus fragile. » Si l’on estime que ces milieux restent moins connus par la science que la surface de la lune, il est déjà possible d’imaginer l’étendue des impacts humains. « Des collègues allemands ont fait une étude sur une première petite expérience, en 1989, de collecte de nodules. Trente ans après, la perturbation était encore visible au niveau local. »
Ce consensus scientifique est plus partagé que celui sur le réchauffement climatique.
Joachim Claudet
Mais une activité minière n’impacterait pas uniquement l’écosystème local. « Il y a une interconnectivité globale dans l’océan. Vous voyez les fumées des incendies au Canada qui se sont déplacées dans l’atmosphère jusqu’en Europe ? Eh bien c’est pareil dans l’océan, avec immensément plus d’impact », assure le chercheur. Une sombre prophétie que complète Joachim Claudet : « Les engins miniers, à eux seuls, produisent des nuisances sonores, lumineuses et une pollution sédimentaire qui pourrait aller jusqu’à perturber la pompe à carbone de l’océan. »
Nauru, « l’île qui s’est mangée elle-même »
Le 10 décembre 1982 à Montego Bay, Jamaïque, l’ONU ratifie la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, un traité historique qui définit les principes généraux de l’exploitation des ressources. C’est sur ces bases juridiques qu’est créée l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM) lors de l’entrée en vigueur de la convention en 1994. À l’époque, la richesse en métaux de ces eaux profondes, bien que difficiles d’accès et peu explorées, attise déjà les convoitises. L’AIFM décide alors de ne pas légiférer sur l’exploitation avant de mieux connaître le milieu. Depuis trente ans, ce ne sont pas moins d’une trentaine de licences d’exploration qui ont été cédées à des chercheurs du monde entier, dont deux à la France.
Et la course contre la montre imposée par Nauru, État insulaire de 12 000 habitants dans le Pacifique, ne va pas arranger les choses. Surnommée « l’île qui s’est mangée elle-même », elle est tristement célèbre pour avoir ravagé la quasi-entièreté de sa surface entre les années 1970 et 1990. Un temps pays avec le deuxième plus gros PIB par habitant du monde grâce à ses mines de phosphate – utilisé par l’agro-industrie pour fabriquer ses engrais –, Nauru est devenue en moins de trente ans une friche à ciel ouvert, les gisements n’étant pas inépuisables. Les taux de chômage, d’obésité et de pauvreté y sont désormais parmi les plus élevés au monde.
En juin 2021, l’île ressurgit subitement sur le plan international lorsqu’elle enclenche « la règle des deux ans ». Dès lors, en vertu de cet obscur article prévu par la convention de Montego Bay, l’AIFM avait jusqu’au 9 juillet 2023 pour adopter un code minier. Faute de quoi, depuis cette date, n’importe quel État peut déposer une demande de licence d’exploitation. Or, il suffit du vote de 12 membres de l’Autorité pour les valider. Nauru, avec ses moyens dérisoires et sa dette colossale, espère retrouver une santé économique grâce à ses exploitations marines, mais n’est pas seul dans le coup. L’entreprise canadienne The Metals Company propose ainsi de lancer l’exploitation à échelle industrielle avec les permis obtenus par l’île, en lui promettant des royalties. « Ce sont des apprentis sorciers qui s’aventurent sur un terrain extrêmement incertain et dangereux », estime François Chartier, chargé du dossier à Greenpeace France.
L’entreprise prétend être la seule à disposer des moyens techniques pour aller miner les fonds. Son PDG, Gerard Barron, était le principal investisseur de la société minière Nautilus Minerals qui, après sa faillite en 2019, a laissé la Papouasie-Nouvelle-Guinée avec une dette de 24 millions de dollars et des dégâts écologiques considérables. En août 2022, le journaliste d’investigation du New York Times Eric Lipton, triple lauréat du prix Pulitzer, publie une vaste enquête dans laquelle il décortique les liens occultes entre la start-up et Michael W. Lodge, secrétaire général de l’AIFM. « Le comité technique de l’AIFM, qui accorde ou non les permis, le fait lors de discussions fermées au public, très obscures et souvent favorables aux entreprises, sans fournir de justifications », tempête François Chartier.
Détermination militante
C’est dans ce contexte trouble que, depuis deux ans, un ensemble d’ONG et d’activistes écologistes est sur le pont pour faire interdire toute exploitation avant qu’il ne soit trop tard. Un lobbying qui a porté ses fruits puisqu’en novembre 2022, à la COP 27, Emmanuel Macron a créé la surprise en soutenant clairement cette interdiction, à contre-courant de ses précédentes déclarations. « Cela faisait deux ans qu’on y travaillait. On n’a pas accompagné cette position, on l’a forcée », tranche Anne-Sophie Roux, cofondatrice avec Camille Étienne du collectif Look Down et représentante en France de l’ONG Sustainable Ocean Alliance.
Un revirement dû à la mobilisation des activistes, sans réelles conséquences pour la France. « Elle n’a pas de contrat avec une entreprise française d’exploitation. Les fonds marins soulèvent tout un tas d’enjeux géostratégiques et, actuellement, elle n’a aucun intérêt à ouvrir la voie à l’exploitation », précise Anne-Sophie Roux. Par ailleurs, la Nouvelle-Calédonie est actuellement le cinquième producteur de nickel au monde. Une position potentiellement menacée par l’arrivée du nickel des fonds marins sur le marché.
Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, nous allons peut-être renoncer à quelque chose en raison de son impact sur l’environnement.
Joachim Claudet
De plus, le deep sea mining ne promet pas d’être si rentable que The Metals Company veut le faire croire quand la société prétend que les ressources océaniques en cobalt sont la solution pour « financer la transition énergétique ». « On estime qu’il y aurait besoin de dix à quinze ans pour qu’un marché viable se mette en place, explique François Chartier. Il faudrait établir des procédés, créer les bateaux, construire les usines. Et, d’ici là, le cobalt ne sera peut-être même plus utilisé pour fabriquer des batteries. »
Reste que la France est le premier et le seul pays au monde à demander l’interdiction pure et simple. Une quinzaine d’États ont, pour leur part, signé un moratoire visant à laisser la science mieux évaluer les impacts d’une potentielle activité minière. Parmi les derniers en date, la Suisse. « C’était un très gros morceau pour nous parce que c’est un pays financeur », estime Anne-Sophie Roux. Car le volet financier est majeur. The Metals Company, jadis cotée au CAC 40, perd un à un ses financeurs à mesure que les négociations approchent. Des avancées prometteuses avant l’assemblée de l’AIFM à Kingston en Jamaïque, du 10 au 28 juillet, au terme de laquelle les 167 pays membres devront se prononcer sur le moratoire et le code minier. En mars dernier, une absence de majorité avait empêché l’autorité de statuer.
« Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, nous allons peut-être renoncer à quelque chose en raison de son impact sur l’environnement », analyse Joachim Claudet. Le traité sur la haute mer adopté en mars 2023 par la Nations unies constituait déjà une étape historique dans la protection des océans. Ses vigies espèrent remporter la prochaine bataille, et elle s’annonce rude.
Pour aller plus loin…
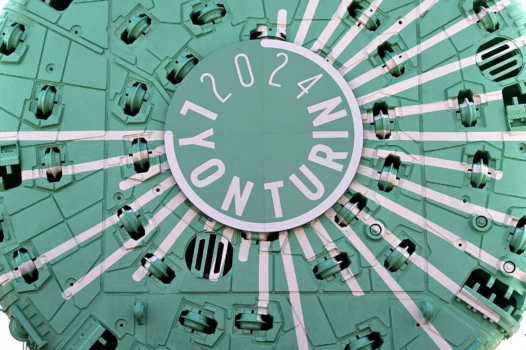
« La LGV Lyon-Turin est la quintessence du déni de démocratie »

Justice climatique : quatorze citoyens en colère

« Que l’État joue enfin son rôle avec un vrai plan d’adaptation climatique »