Pêcheurs artisans, des hommes à la mer
Ce n’est pas celui auquel on pense instinctivement, mais le métier de pêcheur est – de très loin – le plus dangereux. Souvent attribués à la malchance, les accidents s’expliquent pourtant par des causes structurelles. Enquête.
dans l’hebdo N° 1767-1771 Acheter ce numéro

© Leon Harris / Image Source via AFP
Le 1er janvier 2022, au large de l’île de Saint-Barthélémy, le Mazra prend la mer. À bord du petit navire de 11 mètres, Joseph G., le patron de 65 ans, et son matelot de 45 ans, Denis M., pêchent à la palangre, une longue ligne à laquelle sont attachés des hameçons. Alors que Denis M. attrape une bouée pour remonter une ligne, il bascule par-dessus bord. Malgré les efforts de son patron, il part à la dérive. Son corps ne sera pas retrouvé. Ces drames, il en existe des centaines d’autres, mais ils peinent à dépasser le stade du simple fait divers. Il faut dire que les pêcheurs artisans exercent un métier d’invisibles. En 2017, sur les 13 500 marins pêcheurs français, plus de la moitié pratiquaient la « petite pêche ». Sur des bateaux de moins de 12 mètres, ils naviguent à la journée et utilisent des engins peu invasifs pour les milieux aquatiques – filets, casiers, lignes – pour capturer l’équivalent de 14 % du volume de pêche français, loin derrière les pêcheurs industriels.
« Notre métier est le plus dangereux, et de très loin, en termes d’accidents du travail en France. Pourtant, nous n’avons aucune réflexion là-dessus », s’indigne Charles Braine, président de l’association Pleine Mer, qui milite pour une transition durable dans le secteur. En 2019, selon un bilan du ministère de la Mer, la proportion d’accidents mortels était de 10,42 pour 10 000 salariés, soit 10 fois plus que dans le BTP pourtant connu pour être un secteur particulièrement accidentogène. Et, selon un rapport du Bureau d’enquêtes sur les événements de mer (BEAmer), en 2022, 48 % des accidents survenus à bord des navires de pêche concernaient des embarcations de moins de 12 mètres.
Des épaves hors de prix
Après chaque drame, le BEAmer investigue sur ses circonstances, puis émet des enseignements et des recommandations. Au sujet de l’accident du Mazra, l’institution publique désigne une raison principale : l’âge du bateau, construit avant 1981, avec des normes de sécurité datées. Selon le rapport, le pavois – rambarde entourant le pont du navire – était trop bas pour empêcher le matelot de tomber à l’eau. Le bureau recommande à l’administration de « mener une étude sur la possibilité d’aligner réglementairement la hauteur des protections contre les chutes à la mer des navires anciens sur celle actuellement requise, et de modifier la réglementation en conséquence ».
La proportion d’accidents mortels est de 10,42 pour 10 000 salariés, soit 10 fois plus que dans le BTP.
Parmi les nombreux dangers auxquels sont exposés les professionnels, pour Sandrine Thomas – marin pêcheur en Bretagne depuis près de vingt ans –, c’est bien la vétusté des navires qui vient en premier : « Les bateaux des pêcheurs artisans sont vieux de 30 ans en moyenne. Ils sont archaïques, aussi gourmands en carburant qu’en énergie physique. À terre, les tracteurs agricoles de cet âge sont dans les musées ou au fond des granges. Nous, c’est notre outil de travail. » Pêcher sur des bateaux aux normes obsolètes, c’est une réalité rendue possible par les règles européennes complexes de la politique commune de la pêche. Depuis 1993, pour contrôler la taille de la flotte et éviter l’épuisement des ressources marines, chaque professionnel doit obtenir un permis de mise en exploitation (PME) avant d’exercer.
Après cela, il doit encore obtenir une licence – régionale, nationale ou européenne en fonction des espèces de poissons – qui l’autorise à pêcher dans une zone délimitée, avec une méthode précise. Problème : ces droits ne sont pas accordés au pêcheur, mais à son bateau. Or, après des décennies de surpêche, l’État n’en délivre presque plus. Les navires, même vieillissants, se vendent donc à prix d’or lorsqu’ils disposent de licences rares et intéressantes. « Aujourd’hui, la valeur intrinsèque d’un bateau, c’est un quart de son prix de vente. Les jeunes qui se lancent achètent des épaves hors de prix. Ce qu’ils payent, ce n’est pas le bateau, c’est les licences, c’est du papier », explique Ken Kawahara, secrétaire de l’association des Ligneurs de la pointe de Bretagne.
De jeunes pêcheurs victimes
De nombreux jeunes pêcheurs perdent donc la vie en mer. Au BEAmer, on parle même d’une « nouvelle accidentologie » touchant cette population. « Le schéma d’emprunt classique dans le métier, c’est sept ans de crédit. Donc, pendant sept ans, on a un bateau pourri et pas ergonomique, mais on ne peut pas le moderniser parce qu’on est endetté », précise Charles Braine.
Les jeunes qui se lancent achètent des épaves hors de prix.
Ken Kawahara
L’accident du Breiz illustre dramatiquement ce constat. Le 14 janvier 2021, au large de Port-en-Bessin, ce coquillier – petit bateau utilisé pour la pêche à la drague de coquilles Saint-Jacques – de 11 mètres connaît une avarie de barre, son gouvernail ne répond plus. Alors que le soir tombe et que la mer se creuse, un navire de sauvetage est dépêché sur place pour remorquer le vaisseau. Alourdi par ses dragues aux poches pleines de coquilles et de roches, le pont inondé par les vagues, le Breiz chavire pendant l’opération. À bord, trois pêcheurs de 19, 26 et 27 ans décèdent. Quentin Varin, le plus âgé, était aussi le patron du navire. Après plusieurs années sur un grand chalutier, il avait racheté le Breiz deux mois seulement avant l’accident, pour se lancer à son compte.
Le jeune patron pêcheur avait déjà connu des problèmes avec son embarcation, construite en 1979. « Pendant une marée, en action de pêche, le Breiz a eu un mouvement inattendu et dangereux. Après cet incident, les deux équipiers ne souhaitent plus rester à bord et démissionnent avant Noël, laissant le patron sans équipage », indique le BEAmer, qui conclut que l’accident n’est pas sans lien avec l’âge avancé du bateau. Lors des deux derniers rapports d’activité du BEAmer, en 2021 et 2022, cet enseignement se transforme même en alerte. « Plusieurs accidents impliquant des navires de pêche ont mis en évidence les risques associés à l’utilisation de navires anciens acquis par de jeunes pêcheurs peu expérimentés. Ces navires, qui répondent à une réglementation datant de plus de trente ans, ont subi de nombreuses modifications et sont exploités de manière différente de leur conception initiale, ce qui les rend délicats d’usage », s’inquiète François-Xavier Rubin de Cervens, directeur du bureau d’enquêtes.
Les travaux de modernisation incombent au marin avec ses propres moyens financiers. Sandrine Thomas a travaillé à rendre son bateau plus ergonomique, mais déplore toujours l’absence de contrôles extérieurs : « Les bateaux sont inspectés par les services de l’État, mais c’est uniquement pour s’assurer qu’il y a bien des médicaments et du matériel de sauvetage à bord. Les pêcheurs doivent remplir eux-mêmes un “document unique de prévention”, chargé de déterminer les risques les plus flagrants. Il nous faudrait un regard extérieur, parce qu’avec l’habitude de ces conditions de travail, certains n’ont pas la notion du risque. »
« Aux coupables les mains pleines »
En raison de la surpêche, ces réglementations qui compliquent tant l’activité des jeunes artisans sont pourtant nécessaires. « Nos outils de production ont une capacité bien supérieure à ce que la mer peut nous donner. On y est allé comme des bourrins pendant des années avec de gros bateaux, on a mis à mal différents stocks de poisson », constate Charles Braine. Le système actuel n’en est pas moins inégalitaire, ce qui agace tout particulièrement Ken Kawahara : « Ceux qui en bénéficient, ce sont les patrons des années 1980-1990. Ils ont pêché comme des salauds, sans régulation ou presque, et maintenant ils prennent leur retraite et touchent le jackpot en vendant leur bateau. »
Nos outils de production ont une capacité bien supérieure à ce que la mer peut nous donner.
Charles Braine
En plus des licences, des quotas de pêche ont été introduits pour tenter de préserver de nombreuses espèces. Seuls les professionnels réunis au sein d’une organisation de producteurs (OP) peuvent pêcher les espèces soumises aux quotas. Ces instances au fonctionnement assez opaque répartissent les droits entre les navires. Une difficulté de plus pour les pêcheurs artisans, car le partage fonctionne selon le principe des antériorités : ceux qui ont pêché le plus par le passé sont ceux qui ont le droit de pêcher le plus dans le futur. « Dans la pêche, c’est aux coupables les mains pleines », résume avec indignation Ken Kawahara. Rien n’empêche donc les plus gros de continuer à accaparer la ressource. « Moi, je pêche à la ligne pour attraper du maquereau. Mais, depuis cinq ans, il n’y en a presque plus à cause des chalutiers-usines qui pêchent vers chez nous. Ils détruisent la mer, tout simplement, regrette Bernard*, pêcheur artisan d’une soixantaine d’années. Mais ça rapporte tellement d’argent, ce sont d’énormes lobbys, on ne peut rien contre ça. »
Des poissons pas toujours au rendez-vous, des quotas qui limitent la pêche : il est difficile de bien vivre de la pêche artisanale. Ce qui oblige parfois les pêcheurs artisans à prendre des risques importants. Le naufrage du Mordu, le 6 décembre 2019 au large de Fécamp, en est la triste illustration. Ce jour-là, Pascal Hodierne part en mer à bord de son petit ligneur d’un peu plus de 8 mètres. En dépit du mauvais temps, le marin aguerri souhaite récupérer ses casiers à crevettes avant un week-end de tempête. Le bateau chavire, le marin et son matelot, Anthony Letourneur, décèdent. Pascal Hodierne était l’unique ligneur de bar du port de Fécamp, mais la surexploitation de l’espèce par les bateaux-usines de la Manche l’avait obligé à diversifier son activité. « Mon interprétation, c’est qu’il avait le couteau sous la gorge, il devait payer le salaire de son matelot, les charges. Il n’arrivait plus à vivre du bar, la pêche aux casiers était un métier accessoire. Il ne pouvait pas se permettre de ne pas aller les récupérer ce jour-là », analyse Ken Kawahara.
Le patron pêcheur vendait ses poissons via la plateforme Poiscaille, spécialisée dans le commerce de produits issus de la pêche durable. « Les pêcheurs comme Pascal Hodierne sont les premières victimes de la surexploitation des ressources, estime son fondateur, Charles Guirriec. La pêche, c’est l’entreprise la plus aléatoire : elle dépend de la météo, des poissons et des variations de prix à la criée. Il y a cette culture ancrée de faire du volume, pour espérer préserver son revenu. Mais ce système ne fonctionne plus, il a dégradé la ressource et la santé des pêcheurs. »
Il y a cette culture ancrée de faire du volume. Mais ce système ne fonctionne plus.
Charles Guirriec
Prendre des risques pour payer ses charges, de nombreux artisans pêcheurs y sont contraints. « Quand j’avais mon bateau à rembourser, je regardais moins la météo. J’étais jeune, plus téméraire », confie Bernard. Son métier, c’est sa passion. « Ce n’est pas du sang que j’ai dans les veines, c’est de l’eau de mer, dit-il en riant. Alors parfois on prend le risque, on se dit qu’il y a du poisson à aller travailler. » À la fois passionnés et contraints de faire du chiffre, nombreux sont ceux qui ne comptent pas leurs heures. « La durée du travail, quand elle est trop longue, est un facteur d’accident, explique Baptiste*, inspecteur du travail compétent dans le secteur maritime sur la côte Atlantique. Or, dans le milieu de la pêche, il y a des durées dérogatoires ahurissantes ! » En effet, le temps de travail du secteur n’est pas régi par le code du travail, mais par le code des transports. « Donc il y a des dérogations qui permettent de travailler jusqu’à 72 heures par semaine, parfois 15 heures par jour ! Forcément c’est accidentogène », souffle-t-il.
Le prénom a été changé.
Le 24 mai dernier, alors qu’il faisait grand beau au large de Roscoff (Finistère), Philippe Le Bihan est mort sur son bateau. Ce ligneur expérimenté, seul à bord, se serait fait happer par le treuil à l’arrière de son bateau. « Quand on est tout seul, on ne peut pas se reposer, or c’est un métier où il faut être vigilant tout le temps », commente Bernard. Lui affirme n’avoir jamais eu d’accident grave. Lorsqu’on lui demande si, désormais à l’approche de la retraite, il commence à ressentir des douleurs, il s’esclaffe avant d’égrener : « Avec l’humidité, on a beaucoup de rhumatismes, le dos qui nous fait souffrir. Mais je fais avec. J’aime ce métier. Si j’ai pas la mer, je meurs. »
Pour aller plus loin…
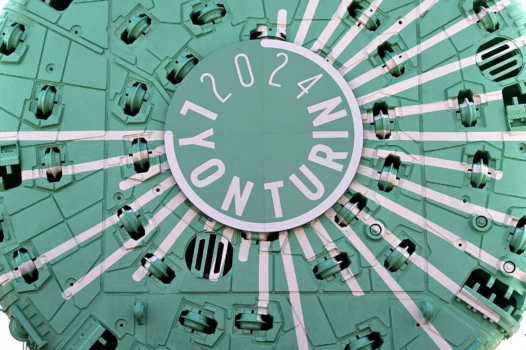
« La LGV Lyon-Turin est la quintessence du déni de démocratie »

Justice climatique : quatorze citoyens en colère

« Que l’État joue enfin son rôle avec un vrai plan d’adaptation climatique »







