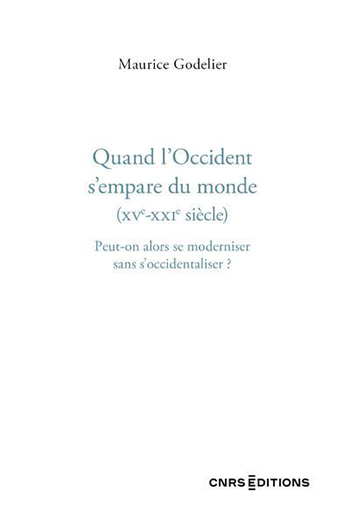Howard S. Becker, au plus près de la société
Dernière grande figure de la sociologie interactionniste, Howard S. Becker vient de disparaître. Il laisse une œuvre pionnière et novatrice, notamment en matière de « sociologie de la déviance ».
dans l’hebdo N° 1773 Acheter ce numéro
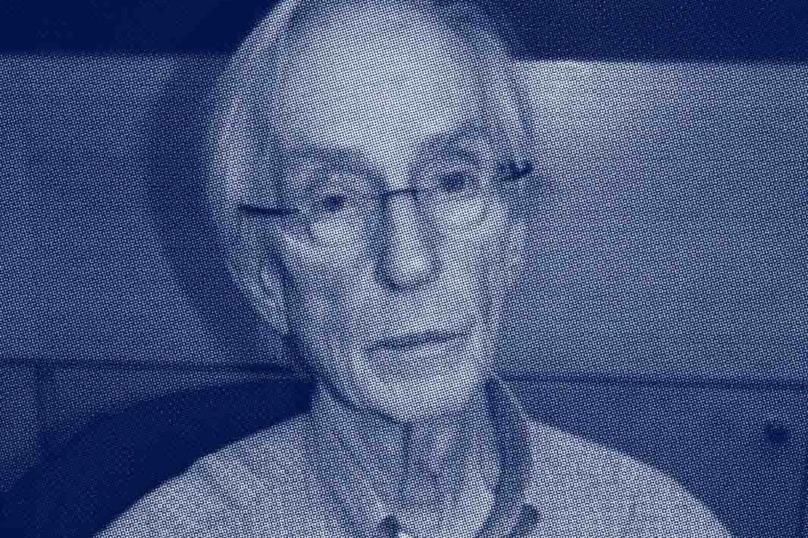
© Thierry Caro
En relisant certains textes d’Howard S. Becker pour écrire cet article après sa récente disparition, le 16 août à San Francisco, je ne peux m’empêcher de penser à l’idiotie qu’avait proférée Manuel Valls, alors Premier ministre, après les attentats de novembre 2015 : « Expliquer, c’est déjà vouloir excuser. » Cette attaque – bien pauvre – pouvait concerner l’entière discipline sociologique et les sociologues français ne s’y sont pas trompés, multipliant les réponses, dont l’une des plus cinglantes fut l’excellent petit essai de Bernard Lahire intitulé Pour la sociologie. Et pour en finir avec une prétendue « culture de l’excuse » (La Découverte, 2016).
Le travail de Howard S. Becker, dernière grande figure vivante de la très importante école de Chicago (à ne pas confondre avec celle des néolibéraux en économie) et de la sociologie interactionniste, ne cessa également d’être raillé, voire attaqué par les autorités. En tant que sociologue de la « déviance », il produisait en effet, selon ses propres termes, des « analyses interactionnistes adopt[a]nt une position relativiste à l’égard des accusations et des définitions de la déviance construites par des gens respectables et les pouvoirs établis ». Mieux, ces analyses devenaient selon lui « radicales » quand, alors que « les autorités exercent le pouvoir en recourant pour une part au brouillage et à la mystification, une science qui rend les choses plus claires attaque inévitablement les bases sur lesquelles repose ce pouvoir ».
Dans cette conclusion du dernier article de son ouvrage le plus célèbre et traduit presque partout dans le monde, Outsiders, sous-titré « Études de sociologie de la déviance » (1), on devine déjà l’engagement politique et sociologique de Howard Becker. Après George Mead (1863-1931) et Robert E. Park (1864-1944), les fondateurs de l’« interactionnisme symbolique », il contribua largement, avec Erving Goffman (1922-1982), Anselm Strauss (1916-1996) et Alfred Lindesmith (1905-1991), à renouveler par cette approche (ou méthode) la sociologie outre-Atlantique et bien au-delà.
Sorti en 1963, il est traduit en français par J.-P. Briand et J.-M. Chapoulie et publié aux éditions Métailié en 1985.
Né en 1928 à Chicago dans une famille juive d’origine lituanienne, « Howie », comme il souhaitait être appelé, cheveux mi-longs, lunettes rondes, chemise et veste décontractées, vivant à San Francisco, incarnait parfaitement le radical American – rappelons (pour faire simple) qu’aux États-Unis les libéraux sont les gens de gauche, et les radicaux, les gauchistes. Il fut, jusqu’à sa disparition, considéré comme une sorte de « monument vivant » de la sociologie, interactionniste en l’occurrence, saluée à travers le monde, notamment par Pierre Bourdieu – même si l’intérêt de ce dernier pour cette approche fut quelque peu tardif.
Le parcours de ce grand sociologue fut aussi chaotique qu’original. Outre son usage de la photographie, documentant ses recherches sur le terrain, il n’entreprit des études universitaires qu’après avoir été pianiste, dès l’âge de 15 ans et plusieurs années durant, dans les clubs de jazz de sa ville natale. En même temps – pour rassurer ses parents –, il s’inscrivit à l’université Northwestern. Fort de son observation du milieu nocturne, artistique et interlope où il jouait, il fut formé par les plus brillants sociologues « interactionnistes » de l’école de Chicago. Après Lindesmith, qui s’intéressa dès les années 1930 à la sociologie des addictions, son observation de la consommation fréquente de marijuana parmi les musiciens de jazz oriente ses premiers travaux, bientôt rassemblés dans Outsiders, vers une « sociologie de la déviance ». Où il ne cesse d’interroger – voire de contester – justement les signification, justification et pertinence du terme « déviance ».
Petite révolution
On peut bien sûr se demander pourquoi son maître-ouvrage dut attendre plus de vingt ans pour se voir traduit en français. C’est que l’« interactionnisme symbolique » appréhende les actions des personnes, non pas comme directement induites par leur origine sociale, mais d’abord par leur interaction avec autrui, dans une sorte de jeu de rôles, plus proche d’une « société du spectacle » que d’un « marché », où les agents pâtiraient seulement de leur manque de capital, économique, symbolique ou culturel. Cette conception fut donc longtemps contestée ou dénigrée, autant par le courant marxiste que par les sociologues libéraux, mais même, au départ, par celui de Pierre Bourdieu. Toutefois, elle permit de renouveler et surtout d’élargir tout un pan de la sociologie en s’intéressant à des secteurs du monde social jusqu’alors trop délaissés par la discipline. Howard S. Becker, avec son camarade Erving Goffman, fut ainsi parmi les premiers qui, à travers l’interactionnisme, développèrent une conception « fluide » des relations sociales, outre une approche radicale et empirique de l’enquête de terrain. Une petite révolution dans les sciences sociales.
Les autres livres de la semaine
Dieu n’a pas créé la nature, Jean-Christophe Attias, Les Éditions du Cerf, 304 pages, 22 euros.
Si Jean-Christophe Attias n’a pas lu tous les livres, il dit en avoir lu quelques-uns, d’Élisée Reclus à Bruno Latour en passant par Philippe Descola et Aymeric Caron. Autant dire que nous entrons en écologie. Mais une écologie originale, comme l’est toujours Attias. C’est dans l’Ancien Testament qu’il nous entraîne, dans un « vagabondage » savant et non dépourvu d’humour. Dieu, auquel l’auteur croit modérément, n’a pas créé la nature mais le monde. C’est-à-dire l’homme dans la nature, et comme humble partie d’elle-même. Et, chemin faisant, Attias cherche dans son judaïsme des réponses à la question essentielle de notre responsabilité. Ou comment préserver la nature sans aliéner notre liberté.
Quand l’Occident s’empare du monde (XVe-XXIe siècle). Peut-on alors se moderniser sans s’occidentaliser ?, Maurice Godelier, CNRS éditions, 504 pages, 25 euros.
Comptant parmi les plus grands anthropologues, Maurice Godelier s’interroge, dans ce livre fondamental, sur les raisons qui ont amené l’Occident à s’imposer, « par les armes ou par la propagande », comme « le modèle de la modernité ». Comment cette « vaste mutation » est-elle advenue, et comment certaines sociétés ont-elles pu – et d’autres non –, dans ce mouvement d’ensemble, conserver des « traits spécifiques, différents, voire opposés à ce qui était promu par l’Occident » ? C’est tout l’objet de cette impressionnante réflexion, alors que les sociétés occidentales sont aujourd’hui en butte à une « hostilité exacerbée et sur le point, peut-être, de perdre le leadership économique, politique et militaire ».
Un monde complètement surréel, Noam Chomsky, Lux éd., coll. « Instinct de liberté », 72 p., 8 euros.
À travers ce recueil de quatre brèves interventions, le linguiste Noam Chomsky, professeur émérite au Massachusetts Institute of Technology, reprend ici quelques-unes de ses analyses radicales de l’ordre géopolitique contemporain, marqué par le néolibéralisme autoritaire. Il y dénonce en particulier le système actuel de « lavage de cerveau sous régime de liberté » auquel nous sommes soumis et que « nous servons trop souvent en tant qu’instruments consentants ou inconscients ». En décryptant le vocabulaire d’un environnement où le droit international n’est qu’une « supercherie » dont les puissants « se servent lorsqu’ils cherchent à jeter un voile sur ce qu’ils ont décidé de faire ».
Pour aller plus loin…

Palestine : quatre auteurs pour l’histoire

George Monbiot : « Après l’hégémonie culturelle néolibérale, nous risquons celle du fascisme »

La sociologie est un sport collectif