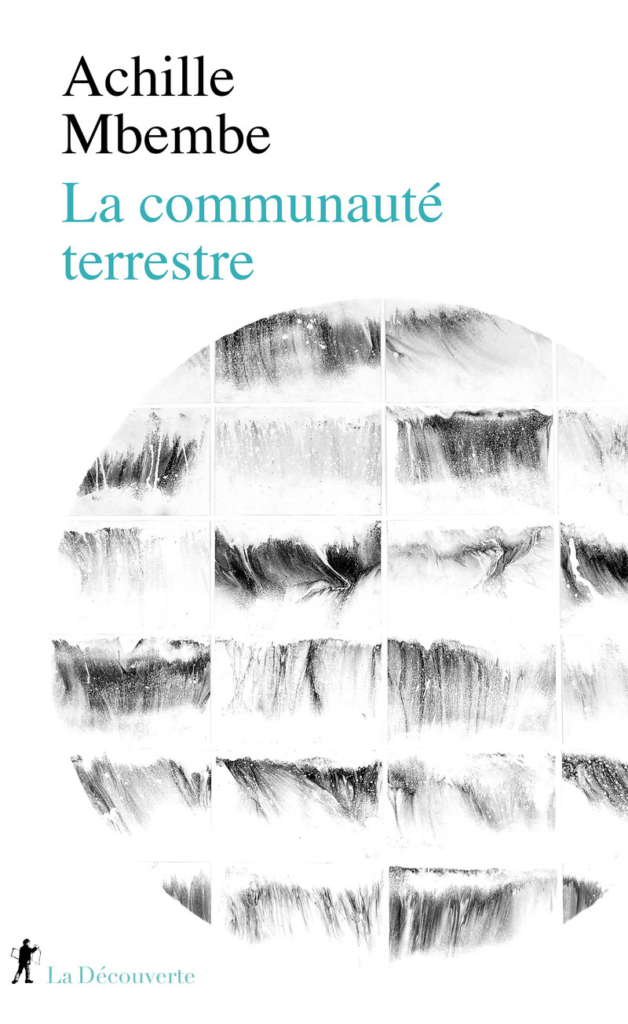« La société française ne s’est pas véritablement décolonisée »
Les coups d’État en Afrique laissent l’État français désemparé. L’intellectuel camerounais Achille Mbembe dresse un tableau impitoyable de la responsabilité de Paris, inapte à comprendre la demande d’émancipation des populations locales, désormais détentrices, selon lui, du futur de leurs pays.
dans l’hebdo N° 1777 Acheter ce numéro

© Ludovic Marin / AFP
La Communauté terrestre, Achille Mbembe, La Découverte, 208 pages, 20 euros.
Achille Mbembe, né au Cameroun, est historien et politiste, enseignant et directeur de recherche au sein de l’université sud-africaine Witwatersrand. Il est à l’origine de la Fondation de l’innovation pour la démocratie (2022), organisation panafricaine dédiée à l’émergence d’une démocratie « substantive » sur le continent. Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire de l’Afrique mais aussi, en philosophe, sur le devenir des sociétés humaines.
Après le Mali, la Guinée Conakry, le Burkina Faso et le Niger, le Gabon vient de connaître à son tour un coup d’État. Que nous disent ces événements de la France, dont ces pays sont tous d’anciennes colonies ?
Un cycle historique est arrivé à sa fin, celui que l’on a appelé la Françafrique. Mis en place au lendemain de la décolonisation, ce modèle de prédation et d’accaparement de rentes de toutes sortes reposait sur le maillage du continent par des bases militaires, ainsi qu’une présence active dans un certain nombre de pays transformés en têtes de pont de l’influence française sur le continent. S’y ajoutait un ordre monétaire articulé sur les francs CFA en Afrique de l’Ouest, en Afrique centrale et dans certaines îles de l’océan Indien. Cet ordre monétaire, pendant très longtemps, a gouverné les échanges avec la France, qui occupait une position privilégiée dans les transactions économiques avec ces États nouvellement indépendants.
Enfin, le troisième pilier était culturel. Il opérait par le biais d’institutions chargées de redistribuer du capital symbolique, notamment aux élites politiques, administratives et intellectuelles, par le biais de la langue française. Les nouveaux États indépendants étaient pensés par la France comme son pré carré, domaine privilégié où elle pouvait intervenir presque à loisir par le biais, par exemple, d’opérations militaires à répétition, voire par le choix direct de dirigeants qui lui étaient soumis. Dispendieux, inefficace et désormais contesté par les nouvelles générations, ce système de vassalisation arrive à sa fin à un moment où la France ne semble avoir ni l’imagination, ni les moyens intellectuels pour savoir comment et par quoi le remplacer.
Qu’est-ce qui en a provoqué la chute ?
La France ne dispose plus des moyens de ses ambitions en Afrique. Elle n’est plus en état d’imposer sa volonté à ses anciennes colonies, ni sur le plan militaire ni sur le plan politique, et encore moins sur le plan moral et culturel. Beaucoup évoquent par ailleurs l’irruption, dans ces régions, de nouveaux acteurs géopolitiques, la Russie et la Chine en particulier, mais aussi la Turquie, le Brésil, l’Inde, les pays du Golfe. Le plus important peut-être, c’est le basculement démographique et générationnel. Une majorité de jeunes aspirent à une réelle souveraineté et à la transformation de leurs conditions de vie en Afrique même.
Avec son nouvel ouvrage, l’auteur complète une trilogie entamée avec Politiques de l’inimitié (2016) et Brutalisme (2020). Explorant ce que les humains ont en partage, après avoir, dans les précédents, exposé ce qui les sépare, il s’affirme comme philosophe d’une pensée à la fois universelle et profondément ancrée dans les puissantes « métaphysiques africaines du lien », où le vivant tient une place centrale.
La perte de légitimité et de crédibilité française est l’une des conséquences de la montée, sur l’ensemble du continent, de ce que j’appelle le néosouverainisme. Ce nouvel état d’esprit contribue au renversement historique des rapports de force en faveur des acteurs endogènes. Le continent entre dans une nouvelle période de son histoire au cours de laquelle les conflits centraux autour du contrôle et de l’accaparement des moyens de prédation opposeront de plus en plus les Africains à d’autres Africains. Les coups d’État sont l’une des manifestations de ce glissement. Les systèmes hérités de la colonisation étant systématiquement bloqués et l’espoir d’une véritable révolution sociale mis en berne, ils apparaissent aujourd’hui comme le seul moyen pour les jeunes générations, en particulier, de provoquer des changements au sommet de l’État, ou bien une forme d’alternance entre les générations. Dans ces conflits dont beaucoup tournent autour du contrôle des moyens de prédation, la France et les autres acteurs externes ne joueront souvent qu’un rôle secondaire.
Doit-on s’attendre, alors, à un effet de contagion de ces coups d’État dans la région ?
Les dynamiques internes vont s’accélérer. Conséquence de la béante fracture démographique, les soulèvements des jeunes se poursuivront sur fond de mutations de l’autorité familiale. La rébellion silencieuse des femmes entraînera de son côté une aggravation des conflits de genre, auxquels se grefferont ceux de classe et de génération. De manière générale, on assistera, parmi les couches populaires, à une intensification des luttes pour les moyens d’existence. Les classes dirigeantes chercheront à accumuler des positions de rente et à renforcer à tout prix leur mainmise sur l’État, à sécuriser les grandes zones de ponction et à consolider leur arrimage aux réseaux transnationaux de la finance et du profit. L’important aujourd’hui, c’est donc d’identifier les lames de fond qui sous-tendent les ébullitions de surface dont les coups d’État ne sont qu’une manifestation parmi d’autres. D’ailleurs, il faut s’attendre à ce qu’il y en ait d’autres tant que les possibilités de sortir d’une démocratie de façade restent fermées.
La France ne dispose plus des moyens de ses ambitions en Afrique.
Même déclassée, la France a-t-elle un rôle à jouer pour enrayer cette mécanique de crises à répétition ?
Sous la présidence d’Emmanuel Macron, la France a mené une politique africaine à deux faces. L’une, nocturne, est fondée sur la psychose militaro-sécuritaire et une vision régressive de la paix, de la stabilité et de la sécurité sur le continent. Cette vision, on la voit à l’œuvre dans le Sahel, mais aussi dans les relations avec les vieux potentats de l’Afrique centrale. Elle est à l’origine de la vertigineuse dégradation de l’image de la France en Afrique et de la propagation d’un populisme anti-français, sorte de panafricanisme frelaté et porté en particulier par les mouvements néosouverainistes. Il faut rompre avec cette psychose militaro-sécuritaire si l’on veut nouer des relations apaisées avec l’Afrique. L’autre face, solaire, se donne à voir dans les chantiers tels que la restitution des objets d’art, le travail sur les mémoires coloniales, l’organisation de la Saison Africa2020, la mise en place de la Fondation de l’innovation pour la démocratie et de la Maison des mondes africains, ou l’intérêt porté aux industries culturelles et créatives et autres tiers-lieux.
Elle mise sur une Afrique à fuseaux multiples et en création, mobile, sûre d’elle-même et ouverte sur le siècle. Entre ces deux visages, il y a la relation profondément mercantile en train d’être tissée avec les États anglophones et lusophones, à l’exemple de l’Afrique du Sud, du Nigeria, de l’Ouganda, du Kenya, de l’Angola et du Mozambique. Quitte à me répéter, au cours de la nouvelle période historique qui s’ouvre, les grands conflits qui détermineront l’avenir du continent opposeront désormais les Africains entre eux. Par rapport à ce tournant historique, la politique de la France doit, sur le moyen terme, être celle de la juste distance.
Vous qui avez côtoyé les dirigeants français, comment expliquez-vous que les gouvernements successifs de la France n’aient pas pris conscience de ce qui était en cours ?
La recherche française en sciences sociales, ces dernières décennies, n’a eu de cesse de décrire et d’analyser ces mutations. Nous disposons, avons leur sujet, dans la langue française, d’une somme inestimable de connaissances, la plupart très fines. Mais dans les cercles du pouvoir, toutes strates confondues, la méconnaissance du continent, de son histoire et de sa culture est abyssale. Ce n’est pas seulement le cas au Trésor ou dans les milieux militaires, voire du renseignement. C’est aussi le cas au Parlement ou chez les diplomates. Les institutions de recherche ne sont pas en reste. Il y a de moins en moins de crédits. Punitive, la politique des visas et des recrutements jette dans les bras des Américains la fine fleur des chercheurs africains ou de descendance africaine.
Il y a un déclassement, et pas seulement de la France, plus largement de l’Europe, qui n’est plus le centre de gravité du monde.
Pour les jeunes chercheurs français, les possibilités de travail de terrain se sont amenuisées et très peu parlent les langues locales. Le fait est que la société française ne s’est pas véritablement décolonisée. Elle n’a pas pris la peine de comprendre ce qu’impliquait de passer de la colonisation à la décolonisation. Le désir d’Afrique s’amenuisant et la relative indifférence aidant, les logiciels culturels sont restés dépendants des vieux a priori qui ne voient, en Afrique, que des sociétés primitives en quête d’un salut qui viendrait de l’extérieur. Il suffit d’écouter les paroles et les discours, y compris de personnes haut placées, et d’observer les manières de faire pour s’en convaincre.
L’historien Jean Chesneau disait que la France souffrait du syndrome de l’ancien empire rabattu au rang de puissance moyenne…
Oui, manifestement il y a un déclassement, et pas seulement de la France, plus largement de l’Europe, qui n’est plus le centre de gravité du monde qu’elle fut pendant très longtemps. La Chine monte en puissance, l’Inde, le Brésil, la Turquie et quelques autres puissances émergentes ont gagné en autonomie. Les déplacements culturels et intellectuels qui accompagnent ces glissements géopolitiques sont peu pris en compte en Occident, ou carrément combattus. La France en particulier vit très mal ce déclassement. La question qui se pose aux vieilles puissances d’antan n’est évidemment pas de retrouver leur grandeur passée, mais de garder une marge de jeu et de considération dans ce qui s’apparente non plus à un « univers » mais à un « plurivers » où les alliances se font à la carte.
En 2021, vous avez activement participé, à l’invitation d’Emmanuel Macron, au « nouveau sommet Afrique-France » tenu à Montpellier, et qui se donnait pour objectif de bâtir une nouvelle alliance entre la France et les sociétés africaines. Tout cela n’arrivait-il pas à contretemps ?
En arrivant au pouvoir, Emmanuel Macron a hérité d’un ensemble de problèmes non résolus, voire non reconnus comme tels, au plus haut niveau de l’État pendant très longtemps. On ne le lui reconnaît peut-être pas suffisamment, mais il a ouvert de nombreux chantiers, même si les trois visages de sa politique africaine, évoqués plus haut, ont souvent été à l’origine de nombreuses contradictions, au point de la rendre parfois illisible. Par exemple, il y a la question lancinante des interventions militaires de la France en Afrique, avec la présence de bases militaires dont très peu aujourd’hui, parmi les jeunes générations locales, voient la légitimité. Ou l’incapacité à répondre à la demande d’abolition pure et simple du franc CFA ou de réformer maints outils de la coopération. Que dire de l’utilisation des visas – y compris pour les entrepreneurs, les étudiants, les intellectuels, les artistes ou les chercheurs – comme instrument de punition au lieu d’en faire des instruments de l’attractivité de la France ? Toutes ces questions restées en suspens sont comme autant de chiffons rouges aujourd’hui agités par les néosouverainistes en Afrique dans leur effort pour faire de la France le bouc émissaire des malheurs du continent.
Vous évoquez la récente restriction des visas pour les citoyen·nes en provenance du Niger, du Mali, du Burkina Faso, vécue comme une mesure de rétorsion ?
C’est la toute dernière en date, mais il s’agit d’un problème structurel. Je mets actuellement en place la Fondation de l’innovation pour la démocratie, ce qui me conduit dans plusieurs pays africains, notamment francophones. Eh bien, je constate souvent que les ambassadeurs de France ou les services culturels passent une grande partie de leur temps à négocier avec les consulats l’octroi de visas pour des catégories de professionnels locaux qui pourraient aider à cimenter la relation avec la France. Ces derniers parviennent difficilement à obtenir les visas qu’exigent leurs simples obligations professionnelles, quand bien même ils n’ont aucune intention d’émigrer et que leurs déplacements pourraient aussi bénéficier à la France.
Il faut démilitariser la politique africaine de la France.
Cette attitude empoisonne complètement l’atmosphère et enflamme partout, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Maroc, au Cameroun, au Gabon, au Togo ou au Bénin, le sentiment de rejet de la France. Alors oui, les initiatives d’Emmanuel Macron sont peut-être arrivées trop tard. Cela dit, sur le terrain, de nombreux projets ont été initiés, hélas peu visibles et peu connus, dans de nombreux domaines – santé, éducation, développement des infrastructures, numérique, industries culturelles et créatives, sport, PME, etc. Un personnel souvent jeune et dévoué est très conscient du fait qu’il est temps de substituer aux liens qui enchaînent d’autres qui libèrent.
N’est-ce pas parce que ce qui est saillant, au Sahel notamment, c’est l’échec de la France dans la lutte contre le jihadisme, mais aussi un double langage, avec une présence militaire française persistante, ou encore des propos peu respectueux ici ou là, montrant que ce désir d’émancipation africain n’a toujours pas été compris ?
Il y a eu d’énormes contradictions, qui ont parfois déprécié la parole institutionnelle, et une grande difficulté à donner une cohérence intellectuelle à tous ces chantiers qui ont été ouverts. On n’a pas réussi à inscrire ces efforts dans un narratif puissant, qui aurait pu répondre aux angoisses, mais aussi aux attentes des nouvelles générations, en particulier dans leur quête d’autonomie, de sens et de souveraineté. On constate par ailleurs une énorme difficulté, voire des réticences, à opérer une rupture mentale radicale avec des cadres cognitifs dépassés, mais restés puissants aux sommets de l’État et ses multiples strates. Je dirai en particulier qu’au plus haut niveau de l’État français il persiste une emprise démesurée de la raison militaire et du monde des affaires quand il s’agit de redéfinir, de fond en comble, une politique africaine conforme aux intérêts de long terme de la France.
Si l’on veut véritablement refonder la relation entre la France, l’Europe et l’Afrique, il va falloir arrêter de penser le continent uniquement sous l’angle sécuritaire, en termes de parts de marché à conquérir ou de zone d’influence. En fait, il faut démilitariser la politique africaine de la France et abandonner cette conception de l’Afrique comme terrain de promotion de l’influence de la France, comme le professe la nouvelle doctrine du ministère des Affaires étrangères. C’est à un complet réaménagement mental qu’il faut procéder, au plus haut niveau de l’État, pour trouver la juste distance – ni ingérence ni indifférence –, qui permettra la coconstruction d’un partenariat qui n’impose rien. Il faudra, pour cela, accepter au besoin une période de purge et admettre que, là ou les intérêts sont inconciliables, des ruptures auront lieu. Mais celles-ci n’ont pas besoin de provoquer des drames ou de déboucher sur des attitudes revanchardes, à l’image de l’amant éconduit.
Vous avez été violemment critiqué par des intellectuels africains pour votre démarche de dialogue avec la France, qui s’apparenterait à une compromission. Comment progresse le débat sur l’émancipation des pays africains ?
La plupart de ces critiques étaient peu informées et souvent sans objet. Dans ce nouveau cycle historique africain, dont je dis qu’il sera dominé par les acteurs internes, il y a ceux qui disent que, pour recréer l’environnement dont le continent a besoin pour se tenir debout lui-même, il faut mettre dehors les puissances considérées comme impérialistes, et identifier un ennemi – la France, pour l’occasion. Ou encore ceux qui expliquent que les futurs africains résident dans un hypothétique retour à des traditions anciennes hypostasiées. Puis d’autres qui ne croient qu’en la violence et la force des armes, qu’il s’agisse des coups d’État militaires ou de la violence jihadiste. Pour tous, la raison est suspecte, et ceux qui se prêtent à ce type d’exercice sont des traîtres. Le débat est donc violent entre ces néosouverainistes et ceux et celles d’entre nous qui plaident pour d’autres voies, ou font d’autres paris sur l’avenir. Pour moi, les chemins d’avenir passent nécessairement par la réinvention de la démocratie, une démocratie substantive, soucieuse du vivant, et qui sera le fruit de l’intelligence collective des Africains.
Que dire de l’utilisation des visas comme instrument de punition au lieu d’en faire des instruments de l’attractivité de la France ?
Quel contenu mettez-vous dans cette notion ?
C’est une démocratie sortie des entrailles même de l’Afrique et des luttes quotidiennes de la majorité de ses habitants. C’est une démocratie qui répond à leur demande d’accès universel et inconditionnel aux moyens permettant de reproduire la vie dans sa base matérielle – nourriture, eau, éducation, soins de santé, possibilité de se vêtir et de redevenir des créateurs de sens. C’est aussi une démocratie qui, par le biais d’une formation permanente à l’esprit critique, s’efforce de répondre à la quête des jeunes générations pour l’autonomie individuelle, la souveraineté collective et le sens. La démocratie substantive est un type de régime politique fondé sur le soin, des corps, des esprits, du vivant dans ses dimensions humaines et non humaines.
Proche de ce que les Anglo-saxons appellent le « care » ?
Elle est fondée sur des intuitions africaines, tel que je les décris dans La Communauté terrestre, mon dernier livre (voir encadré). Elle puise dans ces cosmogonies anciennes qui font du soin du vivant et de la réparation du monde l’horizon ultime de l’action humaine. Son avènement nous oblige à effectuer de nouveaux investissements intellectuels et, surtout, à miser sur l’intelligence collective des Africains, qu’il faut nourrir et accompagner. C’est une démocratie qui serait, au fond, le dernier nom du vivant.
Comment cette proposition peut-elle prospérer dans le contexte actuel ?
Je suis éminemment conscient qu’elle est minoritaire dans les champs culturel, intellectuel et politique. Mais qu’y a-t-il d’autre, en face, sinon le désir de séparation et de partition du monde ?
Pour aller plus loin…

Didier Lestrade : « On assiste à des retours en arrière effroyables »

Portfolio : À Jinba, en Cisjordanie occupée, une vie rythmée par les attaques de colons

En Cisjordanie occupée, la vie clandestine des habitants de Jinba