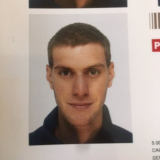« Emmanuel Macron, il faut que cela cesse »
Le 27 juin 2023, Nahel, 17 ans était tué par un policier à Nanterre. Aujourd’hui, victimes et familles de victimes de violences d’État sont plusieurs dizaines à prendre la plume dans Politis. Si les parcours et les époques sont divers, la conclusion est toujours la même : une douleur immense et une soif de justice.
dans l’hebdo N° 1777 Acheter ce numéro

© Maxime Sirvins
Dans le même dossier…
Non-lieux, instructions en cours : le combat sans fin des familles « J’ai été sauvagement agressé par trois policiers » Violences policières : pour les familles, quelques victoires symboliques « Il faut engager une décroissance sécuritaire »Cinquante ans. Cinquante ans séparent la mort de Malika Yezid, 8 ans, en 1973, de celle de Nahel, 17 ans, en juin dernier. Cinq décennies au cours desquelles ont défilé, dans les journaux télévisés et jusqu’aux brèves de la presse locale, les personnes mortes, blessées ou mutilées par les forces de l’ordre. Avec une augmentation de 57 % en trois ans, révélait Politis cet hiver. Une hausse que l’on peut relier à celle du nombre de personnes dépositaires de l’autorité publique mises en cause dans des affaires de violences policières.
Derrière ces données, que les pouvoirs publics s’efforcent de ne pas compiler, il y a des familles. Chacune d’entre elles se souvient du jour où la nouvelle a bouleversé sa vie. Cet appel qui fait tout basculer. Un père, un frère, une cousine, une épouse. Disparu, là, dans la rue, dans sa voiture, dans un commissariat, en cellule. Ou revenu chez soi avec un œil, une main, des doigts, une partie du cerveau en moins. Un corps sans vie ou marqué à vie par l’action de la police ou de la gendarmerie. L’effondrement. Et puis cette force, résumée dans un message et réclamée comme un mantra : Vérité et Justice. Deux mots aux centaines de visages. Politis et Basta ! ont réuni certains d’entre eux. Plus de 30 familles et victimes de violences d’État ont pris la plume pour s’adresser directement à Emmanuel Macron. Et lui dire d’une seule voix : « Il faut que cela cesse. »
1944 Création des CRS.
1968 « Frapper un manifestant tombé à terre, c’est se frapper soi-même en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière », dixit le préfet de police Maurice Grimaud.
1971 Création de la première BAC à Saint-Denis (93), dirigée par un ancien fonctionnaire aux colonies, Pierre Bolotte.
1983 Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité, qui conduit aujourd’hui aux dérives sur les contrôles au faciès.
1992 Généralisation des BAC dans toute la France.
1995 Arrivée du Flash-Ball pour les BAC.
2009 Généralisation du lanceur de balles de défense, dit LBD 40.
2017 Loi relative à la sécurité publique qui vise à assouplir les règles sur l’usage des armes à feu pour les policiers. On dénombre cinq fois plus de victimes depuis la mise en place de cette loi par rapport à la période 2012-2017.
2019 Création de la très controversée Brav-M (brigade de répression de l’action violente motorisée).
2021 Loi sécurité globale qui autorise le port d’armes pour les policiers en dehors de leur service dans les établissements recevant du public.
2021 Abandon de la clé d’étranglement, très critiquée après la mort de Cédric Chouviat.
2021 Mise à jour du schéma national du maintien de l’ordre (SNMO), qui confirme l’approche répressive du maintien de l’ordre en France. Le site violencespolicieres.fr a recensé à ce jour 5 102 victimes et faits de violences policières depuis novembre 2018.
Trois mois après la mort de Nahel et les révoltes massives qui l’ont suivie, le gouvernement devait avoir une priorité : réformer ses forces de l’ordre. Par exemple, en abrogeant la loi du 28 février 2017, qui offre un véritable permis de tuer, notamment pour les refus d’obtempérer – comme ce fut le cas pour l’adolescent de Nanterre. En supprimant l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) pour créer une véritable instance indépendante de contrôle. Ou en interdisant les techniques d’immobilisation qui tuent. Trois mesures qui figuraient parmi la liste de revendications des organisations présentes, samedi 23 septembre, lors de la manifestation dans plusieurs villes françaises contre les violences policières et le racisme systémique. Mais l’exécutif n’a pas pris cette voie-là. Il n’en a pas eu le courage politique, comme celui d’avant, et celui d’encore avant. L’option privilégiée fut la répression. Et le déni, toujours.
Des violences policières ? « Je m’étouffe », avait osé Gérald Darmanin, contestant l’existence même du phénomène devant la commission des lois de l’Assemblée nationale, le 28 juillet 2020. L’expression brûle les lèvres du pouvoir, trop habitué à se murer dans le silence devant les vidéos implacables, les preuves dissimulées et les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a condamné à cinq reprises la France entre 2017 et 2020 dans des affaires qui avaient, pourtant, abouti
à un non-lieu dans les tribunaux nationaux.
Les policiers sont des citoyens comme les autres. Si on renonce à les juger en tant que tels, nous ne sommes qu’au début d’une lente déliquescence de l’État de droit.
Michel Zecler
Révéler les violences d’État, puis les faire condamner. Le chemin est semé d’embûches, la première étant la capacité qu’ont les forces de l’ordre, le parquet et le gouvernement à faire corps. Une seule et même machine face au courage de familles et de victimes qui n’ont d’autre arme que leur « détermination ». « Depuis le début, des gens me disaient que je me battais contre un mur. Ma détermination ainsi que celle de ceux qui m’ont épaulé l’ont mis à terre », écrit Salah Zaouiya, le père de Jawad, 20 ans, mort asphyxié en détention provisoire dans la nuit du 22 au 23 juillet 1996. Le 17 décembre 2008, le Conseil d’État lui a donné raison : l’État a été jugé responsable de la mort de son fils.
Quinze ans après cette décision, historique, le vieil homme continue d’œuvrer à Mantes-la-Jolie auprès des jeunes sur le sujet de la police. Une victoire que bien d’autres ne connaissent pas. Pour une grande majorité, les non-lieux s’enchaînent au cours de procédures longues, complexes et coûteuses. Les auteurs des violences ou des morts sont souvent innocentés. Certains sont promus. « Les policiers sont pourtant des citoyens comme les autres. Si on renonce à les juger en tant que tels, nous ne sommes qu’au début d’une lente déliquescence de l’État de droit », prévient Michel Zecler, sauvagement agressé le 21 novembre 2020.
Dans chacun de leurs textes, familles et victimes nous racontent leur combat. Elles reviennent sur les faits. Précisent les événements, donnent ce fameux « contexte » qui, dans la bouche des syndicats de police, et notamment de l’extrême droitier Alliance, est réclamé pour légitimer n’importe quelle violence des agents. Enfin, elles terminent leur témoignage, chacune à leur manière, par une interpellation au président de la République, au gouvernement, à l’État. L’affirmation d’une mesure forte. De simples condoléances, une reconnaissance. Et surtout, toujours : que justice soit faite et que l’impunité cesse.
Un dossier réalisé en partenariat avec Basta!
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

Justice climatique : quatorze citoyens en colère

« Que l’État joue enfin son rôle avec un vrai plan d’adaptation climatique »

L’inceste et l’affaire Le Scouarnec : ni silence, ni omerta