« Si un propos antisémite est tenu, il importe de le combattre »
Sociologue et écrivaine, Kaoutar Harchi est l’autrice de Comme nous existons (Actes Sud, 2021), une enquête sur la vie, dont la sienne, de celles et ceux qui sont confrontés à l’islamophobie. Entretien, à l’heure du conflit entre Israël et le Hamas.
dans l’hebdo N° 1782 Acheter ce numéro

© DR
Dans le même dossier…
Antisémitisme à gauche : du début du XXe siècle à nos jours, un mythe et des réalités Lutte contre l’antisémitisme : pourquoi la gauche doit reprendre un combat historique Antisionisme et antisémitisme, une opération politique avortéeComment construire une lecture décoloniale du conflit entre le Hamas et Israël sans qu’elle ne débouche sur des formes d’antisémitisme ?
Kaoutar Harchi : Il ne me semble pas du tout que la lecture décoloniale – le terme anticolonial est peut-être plus juste, d’ailleurs – soit le problème. Cette lecture ne fait que rappeler l’histoire et appeler à une levée de la domination par le démantèlement du système colonial afin qu’une situation de justice, de paix, d’égalité, puisse surgir pour tous et toutes et demeurer pérenne. Dit en d’autres termes : pour que plus personne ne meure. Si un propos antisémite est tenu, et nous savons bien que c’est le cas, il importe de le dénoncer, de le refuser, de le combattre. C’est un délit que la justice doit condamner.
L’accusation d’antisémitisme dirigée contre les défenseurs de la cause palestinienne dissimule-t-elle des formes de racisme ?
Si la criminalisation de la défense de la cause palestinienne est motivée par des formes de racisme anti-arabe, par une forme d’islamophobie, oui, sûrement. Je serais presque tentée de dire que c’est ainsi maintenant, Emmanuel Macron ayant affirmé, par exemple, en 2017, que l’antisionisme est une forme renouvelée d’antisémitisme. Ce à quoi Dominique Vidal a d’ailleurs répondu par la rédaction d’un livre intitulé Antisionisme = antisémitisme ?, paru aux éditions Libertalia. C’est à travers cet écheveau que la cause palestinienne a appris à avancer, malgré tout. Et cela en rappelant à quel point, si confessionnalisation de la question il y a, ce n’est pas pour autant que la question est d’ordre confessionnel, que la question opposerait « les musulmans » aux « juifs ». Loin de là.
La question est d’ordre politique : indifféremment aux appartenances religieuses, c’est la question de l’ordre d’un monde qui est posée. Comment vivent les êtres à l’intérieur de ce monde ? Ils vivent inégalement. Cette forme inégalitaire que le colonialisme produit à la fin de sa propre survie, comme il l’a produite en d’autres terres, en d’autres temps, tient prisonniers de politiques guerrières et meurtrières des individus prêts à vivre en égaux. En ce sens, la cause palestinienne nous rappelle que le colonialisme n’est pas obligé ; si le colonialisme s’est révélé fatal pour tous ceux et toutes celles qui en sont morts, il n’est pas une fatalité. La justice et la paix sont des possibilités éternelles qu’il est temps de réaliser.
Faut-il comprendre les difficultés, en France, à qualifier de génocidaire la politique menée par Netanyahou à l’égard des habitant·es de Gaza comme résultant d’une forme de refoulé colonial ?
Tout d’abord, il est important de rappeler que le terme « génocide »
a été employé par l’Organisation des Nations unies, à travers de nombreux communiqués, après, notamment, que des expressions telles qu’« animaux humains » ont été prononcées par des responsables politiques israéliens pour justifier le bombardement de la bande de Gaza. Il existe donc un fondement juridique à l’emploi de ce mot. Au regard des « débats » qui se sont tenus et se tiennent encore, il apparaît une volonté claire d’atténuer la gravité des actions menées. De dire que ce n’est rien. Et pourquoi ce n’est rien ? Parce que ce ne sont que des « animaux », que des Palestiniens. Cette manière de décriminaliser le crime est criminelle. C’est un encouragement à l’ensanglantement de Gaza au moyen, à ce jour, d’une totalité de 12 000 tonnes d’explosifs. Mona Chollet, dans son article « Le conflit qui rend fou » pour Mediapart, a en effet exprimé cette idée selon laquelle le refoulé colonial des anciennes puissances coloniales, la France donc, trouvait à travers cette guerre un nouveau chemin d’expression. Nous semblons donc bien passer du refoulement au défoulement.
Une partie de la gauche s’est vue reprocher de ne pas avoir qualifié le Hamas d’organisation « terroriste » après son attaque du 7 octobre. Une bataille lexicale s’est depuis engagée. Plus largement, quels sont les mots qui manquent à la gauche pour parler aux juif·ves et aux Palestinien·nes ?
Les douleurs sont immenses : celles du passé et du présent. Rares sont les personnes dont la mémoire est paisible. Cela, dès lors, est une affaire qui rappelle la gauche à son devoir historique de promotion de l’égalité et de la justice. Est-ce que la gauche, alors, manque de mots ? Je pense que ce qui nous manque le plus aujourd’hui, avant les mots de la gauche, c’est en vérité la gauche elle-même. Jean-Luc Mélenchon et quelques personnalités de La France insoumise se sont associés à toutes les douleurs, en les faisant leurs, puis ils ont appelé au cessez-le-feu, à la recherche diplomatique d’une solution. Or, il y a peu, un député Renaissance réclamait que Jean-Luc Mélenchon soit « fiché S ». Que répondre à cela ? C’est l’actuel renversement du monde. Ou alors pire : ce serait sa révélation. Rechercher la justice, la paix, l’égalité, la fin du colonialisme est devenu une infamie quand encourager la guerre, sa poursuite, la poursuite du colonialisme s’apparente à un honneur.
Un hors-série Politis et Orient XXI
Dans ce hors-série paru en 2018, Politis et Orient XXI retraçaient l’histoire complexe des relations entre Israël et Palestine. Un numéro exceptionnel à retrouver sur notre boutique.
Pour aller plus loin…
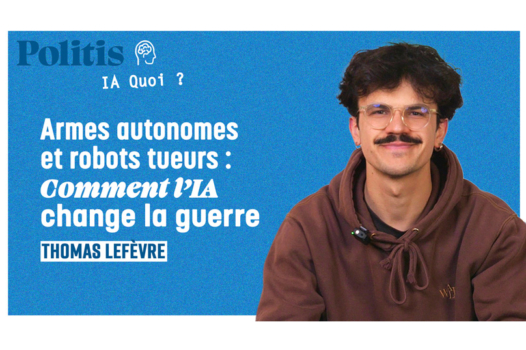
Armes autonomes et robots tueurs : comment l’intelligence artificielle change la guerre

Comment la guerre par drones redessine les champs de bataille
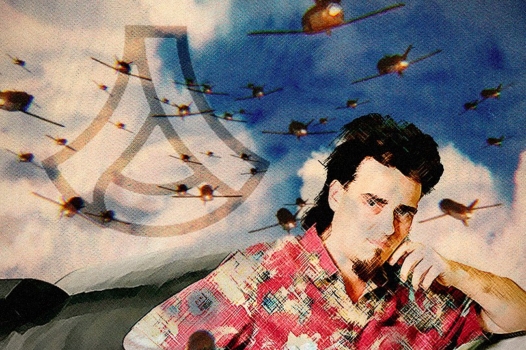
Anduril, la start-up de la guerre qui recrute sur internet









