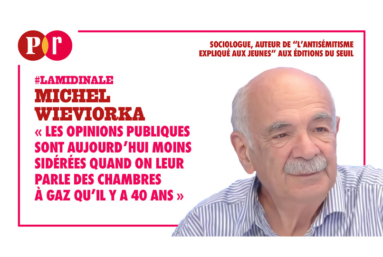« Même si tu vas sur la lune », les méandres de l’entre-deux
Laurent Rodriguez décrit avec sensibilité et onirisme, le parcours de quatre jeunes Syriens installés en France.

© Unifrance
Même si tu vas sur la lune / Laurent Rodriguez / 1 h 33.
« C’est comme s’il y avait le Hasan français et le Hasan syrien », explique l’un des protagonistes du documentaire de Laurent Rodriguez, Même si tu vas sur la lune. Lorsque cette phrase retentit dans le film, Hasan est à Paris. En 2015, il est arrivé en France après avoir fui Alep. Un passage par l’Allemagne, puis un voyage en stop vers Paris. Là, Hasan rejoint le programme que l’université de la Sorbonne propose alors pour accueillir des réfugiés. L’objectif : acquérir les connaissances nécessaires en français pour fonctionner dans la capitale, effectuer les tâches administratives, s’acheter un paquet de tabac…
À la Sorbonne, Hasan rencontre d’autres Syriens, Sara, Khairy et Ghaith. Ensemble, ils évoquent leurs expériences. Les paroles fusent et les points de vue s’accordent ou s’opposent. Certains pensent au retour – utiliser l’expérience française pour agir sur la terre natale –, d’autres soulignent le sentiment d’éloignement grandissant avec celle-ci. Certains discutent le statut de réfugié qui, parfois, contraint leur liberté artistique et d’expression, d’autres énoncent les stratégies qui leur permettent de contourner les assignations.
Fruit d’un projet mené pendant six ans, le film capte avec une grande sensibilité l’évolution des protagonistes filmés, leurs avis variés et changeants. Au long du film, on les entend, on les voit, s’accommoder de leur nouveau statut passant de celui de réfugié, à celui d’exilé, de celui d’apprenant de la langue française à celui de Parisien bilingue et biculturel. Ce parcours, Laurent Rodriguez le montre en alternant plusieurs textures, accentuées par le montage, et plusieurs techniques cinématographiques.
L’immense fluidité de l’expérience de l’exil
Le présent est celui de la couleur, dans lequel les amis sont en week-end à la campagne avec leur professeur de français. Là, ils dressent un premier bilan de leurs expériences, redéfini dans un très bel épilogue. Le passé, lui, est double ; d’un côté, celui de l’animation, réalisée par Sara, elle-même filmée ici, qui conte des épisodes clés précédant l’arrivée en France, de l’autre, celui du noir et blanc dans lequel Hasan, Sara, Khairy et Ghaith sont étudiants et apprennent à négocier les différentes parts de leurs identités. Lorsque Sara évoque son arrivée à Paris, elle insiste sur la difficulté à se rendre compte que tout ceci, tout ce qu’elle a vécu et qu’elle vit, est bien « vrai ».
Le passé syrien s’estompe peu à peu, glissant dans les méandres de la mémoire.
La société d’accueil semble irréelle, le passé syrien s’estompe peu à peu, glissant dans les méandres de la mémoire, et l’attitude à adopter pour agir « à la française » ravit en même temps qu’elle fait violence. Il faut parfois jouer un jeu, porter un masque, comme l’évoquait le sociologue W.E.B. Du Bois lorsqu’il décrivait les contraintes imposées aux populations noires des États-Unis. Cet entre-deux, entre passé et présent, mais aussi entre rêve et réalité, est magnifiquement mis en image dans le film. Le documentaire devient onirisme et sa profusion retranscrit pour le spectateur l’immense fluidité de l’expérience de l’exil, sa facture en perpétuels mouvements.
Pour aller plus loin…

« La Pampa », l’amitié pour toujours

« Presence », au-delà du dispositif

« La Pie voleuse », l’argent fait le bonheur