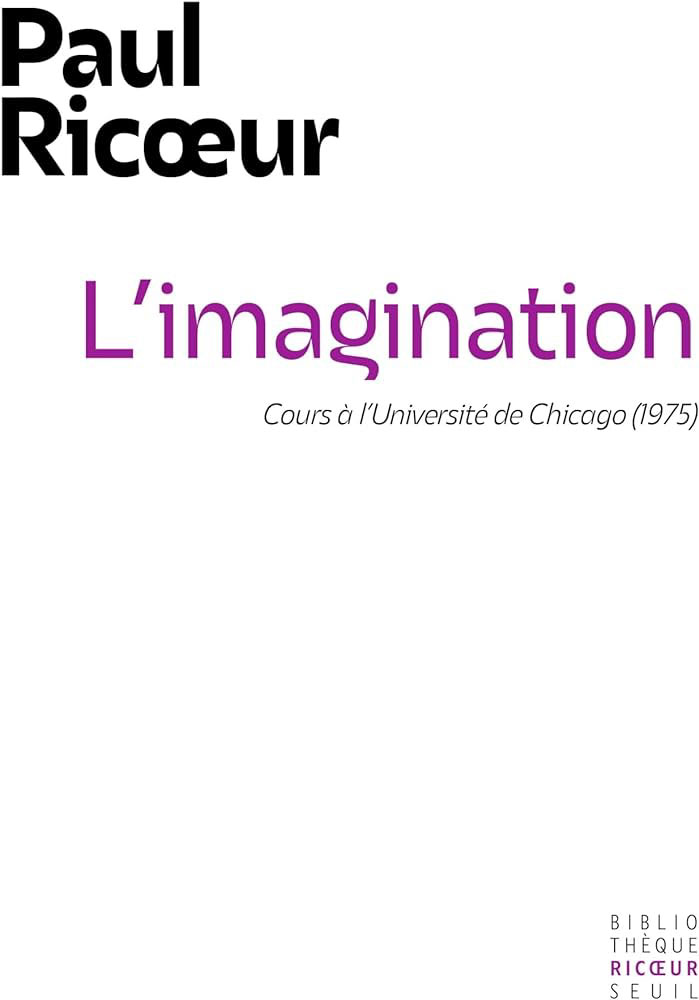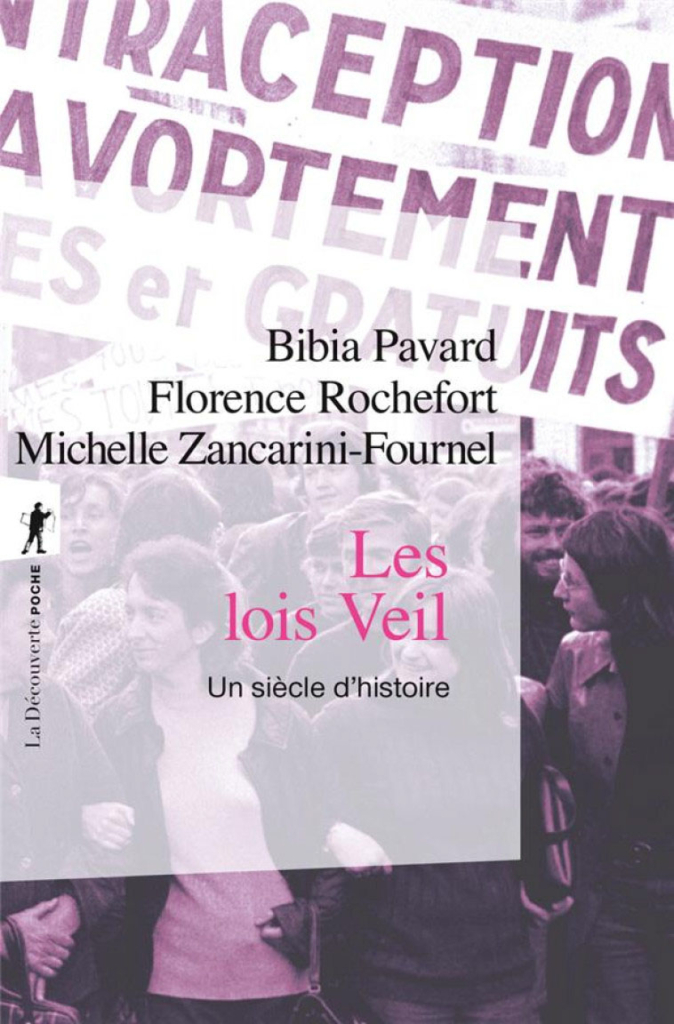Édition raisonnée des grands intellectuels français
Plusieurs maisons d’édition, en premier lieu le Seuil, publient des « bibliothèques », ou collections spécifiques, rassemblant des archives ou des cours de penseurs prestigieux, jusqu’ici inédits. En commençant par ceux de Derrida et Ricœur, après Althusser et Foucault.
dans l’hebdo N° 1816 Acheter ce numéro

© Ulf Andersen / Aurimages / AFP
La somme est déjà impressionnante. La « Bibliothèque Derrida » (Seuil) compte près d’une dizaine de volumes de plusieurs centaines de pages chacun. La plupart sont des cours délivrés outre-Atlantique ou au Collège international de philosophie à Paris, institution indépendante que le philosophe s’employa à créer au mitan des années 1980 – l’Université française, encore moins le Collège de France, n’ayant jamais proposé un poste prestigieux à ce penseur français incontournable aujourd’hui, traduit dans de nombreuses langues, parmi les plus cités et étudiés au monde, au côté des Foucault, Barthes, Deleuze, Guattari… Ce qu’outre-Atlantique on désigne et rassemble, peut-être parfois un peu rapidement, sous l’appellation de « French Theory ».
Publier (ou republier) ces cours et séminaires est une façon de documenter la production philosophique hexagonale de cette époque.
Impossible de ne pas citer d’abord, dans cette collection, les deux tomes consacrés à la question de l’« hospitalité », séminaires conduits par Jacques Derrida de 1995 à 1997 à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), alors que la question de l’étranger, de l’autre, mais surtout de l’accueil et de l’immigration, de l’intégration et de l’exil, ne cesse d’acquérir une importance centrale dès cette époque. Des cours auxquels France Culture, notamment dans son émission quotidienne « Staccato », dirigée alors par Antoine Spire, consacra plusieurs numéros, sous l’égide de la journaliste Tania Rizk.
Rappelons seulement qu’alors, en août 1996, la police française fracasse à la hache l’imposant portail de l’église Saint-Bernard, dans le nord de Paris, où se sont réfugiées des dizaines de familles de sans-papiers, avec enfants en bas âge, et quelques personnalités venues les soutenir. Dont l’actrice Emmanuelle Béart, dont on se souviendra de la sortie de l’église, un nourrisson d’origine africaine dans les bras, encadrée par les CRS.
Publier (ou republier) ces cours et séminaires est une façon de documenter la production philosophique hexagonale de cette époque, commencée dès les années 1950, de penseurs qui nous manquent grandement aujourd’hui : Sartre, Beauvoir, Foucault, Barthes, Deleuze, Bensaïd, Lévinas, Vernant, Vidal-Naquet, Poulantzas et, disparus plus récemment, Jean-Luc Nancy ou Bruno Latour.
Combler un vide
Dans la même veine, les éditions du Seuil se sont lancées récemment dans une autre aventure : une « bibliothèque Ricœur », dont le premier opus est un passionnant cours dispensé en anglais à l’université de Chicago en 1975, traduit en français sous le titre L’Imagination (1).
L’Imagination. Cours à l’université de Chicago (1975), Paul Ricœur, inédit, traduit de l’anglais et préfacé par Jean-Luc Amalric, Seuil, 560 pages, 560 pages, 27 euros.
À ces collections, il faut évidemment ajouter celle, plus ancienne et très prestigieuse assurément, intitulée « Hautes Études » (une coédition entre Gallimard, Seuil et l’EHESS), où ont été publiés, entre autres, tous les cours au Collège de France de Michel Foucault et, plus récemment, certains de ses enseignements plus anciens, tout aussi importants (2). Ainsi que d’autres intellectuels et philosophes qui continuent de marquer durablement la pensée française du second XXe siècle et de ce début de XXIe siècle, toujours admirée et surtout amplement citée de nos jours, sous la plupart des latitudes. On n’évoquera ici que les ouvrages du philosophe, sociologue, médecin et anthropologue Didier Fassin, récemment élu au Collège de France.
À l’instar de ses « cours, conférences et travaux », inédits, consacrés à Nietzsche (Gallimard/Seuil/EHESS, 410 pages, 28 euros). Lire notre recension récente.
Toutes ces initiatives éditoriales viennent en tout cas rappeler les contributions à une pensée théorique reconnue internationalement, alimentée par nombre d’intellectuels français, qui prirent une place prépondérante dans les débats de leur époque comparable alors à celle d’intellectuel·les comme Hannah Arendt, J. L. Austin, Howard Becker, Erving Goffman ou Noam Chomsky outre-Atlantique, sans oublier celle de l’école de Francfort, d’Horkheimer et Adorno à Marcuse ou Oskar Negt, outre-Rhin. Et ces « bibliothèques » permettent de disposer de manière raisonnée de cette pensée, trop souvent éparse jusqu’ici, s’employant à combler un vide, dans une tâche à laquelle il était grand temps de s’atteler.
Les parutions de la semaine
La France, tu l’aimes mais tu la quittes. Enquête sur la diaspora française musulmane, Collectif sous la direction d’Olivier Esteves, Alice Picard et Julien Talpin, Le Seuil, 320 pages, 23 euros.
Voici un livre désolant, accablant même, mais ô combien passionnant, surtout à l’heure où l’on craint l’arrivée de l’extrême droite à Matignon. Mourad, Samira, Karim, mais aussi Sandrine ou Vincent, sont tous né·es en France, diplômé·es bac + 5 et plus, mais se sont installé·es à Casablanca, New York, Manchester, Dubaï, Montréal ou La Haye. Les femmes portent parfois le voile, d’autres non, les hommes et celles-ci sont tous·tes discriminé·es sur le marché de l’emploi en France, jamais reconnu·es pour leur compétence, sans cesse stigmatisé·es pour leurs origines, noms de famille et/ou leur confession musulmane.
Enquête fouillée auprès d’un échantillon de plus de 1 000 personnes (plutôt jeunes, 35 ans en moyenne), ce livre s’appuie sur près de 140 entretiens approfondis avec des personnes ayant quitté la France depuis environ six ans, ayant trouvé dans d’autres pays le moyen d’une ascension sociale qui leur était refusée dans l’Hexagone, mais surtout un « droit à l’indifférence » qui leur permet au-delà des frontières françaises de « se sentir simplement français ». Elles et ils expliquent leur choix de destinations, les raisons de leur départ, leur expérience d’expatrié·es, le regard sur la France quittée, voire leurs perspectives de retour. Cette étude de haute tenue vient souligner une société française rongée par les préjugés ethnico-raciaux et travaillée « à bas bruit » par ce triste phénomène social d’ampleur. Une réussite sur un sujet trop souvent tu.
Les lois Veil. Un siècle d’histoire Bibia Pavard, Florence Rochefort & Michelle Zancarini-Fournel, La Découverte/poche, 312 pages, 13 euros.
Les lois Veil sur la contraception (4 décembre 1974) et l’avortement (17 janvier 1975) furent un premier aboutissement de longues décennies de luttes féministes, commencées dès la fin du XIXe siècle et finalement victorieuses. Cinquante ans après leur adoption, les trois autrices de cette belle étude, historiennes et politistes renommées, ne se sont pas contentées de retracer cette histoire, rassemblée sous l’appellation des « lois Veil », du nom de celle qui fit voter ces textes législatifs si précieux, car elles ont voulu y inclure les réformes les plus récentes en la matière – dont l’inscription de l’IVG comme « liberté fondamentale » protégée par la Constitution.
Non sans souligner la lente évolution de la société française, depuis les « campagnes agressives » contre ce qui était considéré un « fléau social », avant la prise de conscience des innombrables drames de l’avortement clandestin et ses souffrances, puis l’acceptation – toujours « fragile » – du libre choix des femmes à disposer de leurs corps. Fragile car on déplore encore trop d’idiots utiles ou convaincus, toujours prêts à relever la tête pour revenir sur ce qui doit désormais être un droit intangible et inamovible. Comme dans l’entourage de Marine Le Pen et Bardella, sans oublier les Laurent Wauquiez ou François-Xavier Bellamy (LR). Encore largement contesté à travers le monde, ce droit fondamental doit être partout défendu – et revendiqué – en tant que tel. En France aussi. Un livre précieux.
Pour aller plus loin…

Médecine alternative : l’ombre sectaire

Didier Lestrade : « On assiste à des retours en arrière effroyables »

Julie Couturier : « Attaquer l’État de droit, c’est attaquer la démocratie »