Juliette Rousseau : « J’essaye de détricoter les mythes de la ruralité »
Comment porter une parole sensible, de gauche et féministe dans un milieu rural d’apparence hostile ? L’autrice de Péquenaude utilise sa plume tantôt douce, tantôt incisive pour raconter sa campagne bretonne natale, où elle est retournée vivre, en liant les violences sociales, patriarcales et écologiques.
dans l’hebdo N° 1829 Acheter ce numéro

© Maxime Sirvins
Lutter ensemble. Pour de nouvelles complicités politiques, Cambourakis, 2018
Joie militante. Construire des luttes en prise avec leurs mondes, Carla Bergman et Nick Montgomery, traduction Juliette Rousseau, Éditions du Commun, 2021
La Vie têtue, Cambourakis, 2022
Péquenaude, Cambourakis, 2024
Juliette Rousseau est née en 1986, en Ille-et-Vilaine. Porte-parole d’Attac puis de la Coalition Climat 21 lors de la COP 21 en 2015, elle est aussi passée par des collectifs féministes et la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Elle a toujours développé une vision globale des luttes, tout en gardant un regard critique sur les écueils de celles-ci. Elle est également directrice de la collection « Poésie » aux Éditions du Commun.
Toutes les campagnes n’étant pas identiques, pouvez-vous nous raconter la vôtre, telle qu’elle apparaît dans votre nouveau livre, Péquenaude ?
Je vis en Ille-et-Vilaine, en Haute-Bretagne, dans un territoire où les principales ressources économiques sont celles de l’agro-industrie : des exploitations en conventionnel, Lactalis, des abattoirs, des usines de fabrication de matériaux et de machines agricoles. Mon village – chez moi, l’équivalent d’un hameau – est situé au bord d’une forêt et était habité par plus d’une centaine de personnes au début du XXe siècle.
À ma naissance, on n’était plus que dix. C’était quelques années après le remembrement (1). Avant, le village était entouré de vergers, et il y avait sept parcelles jusqu’à la forêt. Après, il n’y avait plus de verger et plus qu’une seule parcelle. Les chemins menant jusqu’au bourg ont aussi disparu. Dans mon livre, une phrase décrit tout ça : « Naître au champ après la bataille dans une ruine des mots et du sens de soi. » Je fais partie d’une génération née dans les ruines, mais qu’on n’a pas appris à voir ainsi, car cette condition effondrée était considérée comme la meilleure pour nous.
Le remembrement, qui a accompagné la modernisation de l’agriculture française, s’est principalement déroulé entre 1955 et 1975.
Ce remembrement – qu’on devrait plutôt nommer démembrement – a détruit en vingt ans le fruit de cinq mille ans de travail humain, à savoir le bocage. J’avais à cœur de donner à sentir ce qui constitue des fantômes, c’est-à-dire tous les endroits qui sont des survivances cachées dans la lande, dans les restes du bocage, afin de nommer la violence, ses conséquences, et pour nous rappeler ce dont on hérite malgré tout.
Une forme d’intégrité perdue. Sans être dans une relation passéiste, je pense qu’il faut reconnaître collectivement ce qui nous a été fait, sous peine d’alimenter les moteurs les plus forts de la résistance à la critique de l’agro-industrie. Cette violence subie a été telle qu’elle a rompu des liens de solidarité dans les villages et a exacerbé la mise en compétition des familles et des exploitations.
Votre livre est un alliage entre récit autobiographique, essai socio-historique sur la ruralité et poésie. Qu’est-ce qui a guidé votre écriture et le choix du titre, Péquenaude ?
Il m’a fallu un peu de temps pour l’assumer, mais il n’y a que dans cette forme d’écriture en fragments que je me retrouve réellement. Mon premier texte était un essai de 400 pages qui portait sur les pratiques militantes, car il y avait sans doute en moi l’idée tenace que, pour être acceptée dans le champ intellectuel, il faut en adopter les codes. Finalement, en tant que femme et/ou en tant que rurale, une violence existe quasiment dès le départ : cette nécessité de devoir adopter des codes et des formes qui ne nous ont pas forcément été transmis. Et, par conséquent, écrire d’une façon immédiatement excluante pour « les nôtres ».
Mon essai, personne ne l’a lu dans ma famille, et c’était une forme de violence car cela signifiait que l’écriture était définitivement une façon de rompre avec une partie de mon environnement familial et amical. Mon deuxième texte, La Vie têtue, a été lu plus facilement par les femmes de mon entourage, ce qui a permis de recoudre quelque chose qui avait été rompu, avec le geste même de l’écriture, qui porte une charge sociale particulièrement forte dans la ruralité.
Quand on vient de la ruralité et qu’on a la prétention d’écrire sur la ruralité, il faut souvent la quitter.
Quant au choix du titre, c’était assez évident car ce mot est omniprésent. J’y vois une double provocation : pour une majeure partie des gens, une péquenaude qui écrit, ça n’existe pas, et une écrivaine péquenaude, ça n’existe pas non plus. Du côté du monde rural, écrire est déjà une forme de trahison. J’essaye aussi de détricoter les mythes de la ruralité. L’imaginaire de la ruralité est entièrement résumé à l’agriculture. Or je me revendique péquenaude alors que je ne suis ni agricultrice ni fille d’agriculteurs.
D’où vient la rupture entre le monde de l’écriture et le monde dans lequel vous avez grandi ?
C’est lié à une histoire dont il faut prendre la responsabilité. J’ai essayé de raconter l’existence d’une culture paysanne qui réside encore dans les ruines d’un paysage, d’un territoire, d’une culture. C’est pour cela que j’ai décidé de parler de la chouannerie, un soulèvement populaire spécifique à mon territoire après la Révolution française, mais qui a un point commun avec d’autres territoires : la concomitance entre la disparition des cultures paysannes et l’arrivée de l’écriture.
Celle-ci était incarnée par les écrits de l’administration qui soumettent les populations à l’impôt et à la conscription. Or il n’y a jamais vraiment eu de réappropriation de l’écriture par les populations rurales, donc elle est restée un instrument de la domination. Quand on vient de la ruralité et qu’on a la prétention d’écrire sur la ruralité, il faut souvent la quitter, adopter les habitus urbains pour pouvoir se saisir de cet outil. Il faut partir pour pouvoir dire la ruralité.
Vous-même avez quitté la campagne pour vivre, étudier, travailler et militer ailleurs, en ville. Dans le livre, vous mentionnez souvent le mélange de sentiments entre honte et fierté, mais aussi les interrogations sur votre légitimité.
Le point de départ du livre vient de la prise de conscience du niveau de violence lié au fait de grandir dans un endroit auquel on s’attache tout en ayant conscience très tôt que notre seule ambition sera de le quitter. Lors de l’écriture du livre, j’ai discuté avec mes amies d’enfance – l’une vit à Vannes, l’autre au Mexique – sur ce besoin de partir qui n’était pas nommé mais une évidence pour toutes.
Nous en sommes arrivées à des réflexions sur la violence de classe et patriarcale qui a pu traverser nos relations car, en tant que jeunes filles, il était évident qu’on n’avait aucun avenir sur ce territoire. Personne ne dit que devoir partir pour s’en sortir est une violence immense. Ce n’est pas seulement l’urbanité et la modernité qui nous font partir, mais aussi la mainmise des forces réactionnaires sur les campagnes desquelles nous sommes issu·es, et le patriarcat.
Un exemple de violence patriarcale qui s’exerce dans les campagnes ?
La mobilité. En lisant le travail de la sociologue Yaëlle Amsellem-Mainguy, Les Filles du coin, j’ai compris ce qui s’était passé pour moi, adolescente. Les garçons ont un accès privilégié à la mobilité car leurs parents leur achètent plus facilement un scooter, parce qu’ils passent leur permis de conduire plus tôt, etc. Pour les filles, l’accès à la mobilité revient à marchander les corps puisqu’il faut avoir un copain qui a un scooter.
Si on tire le fil pour interroger le genre et la ruralité, il faut également regarder la condition territoriale. Pourquoi faut-il aujourd’hui un engin à moteur (scooter, voiture, tracteur…) pour se déplacer dans la campagne ? À cause du remembrement. Avant, on marchait sur les chemins, l’accès à la mobilité n’était pas genré. Ce livre est une façon de semer des graines, de cartographier les tapis qu’il faudra soulever pour se poser cette question de l’habiter depuis la position de femmes et de rurales.
Le lien entre corps et territoire, entre paysages et femmes inonde vos écrits. Est-ce un texte écoféministe ?
Oui, même si j’ai du mal avec les étiquettes, car il y a toujours une appropriation, une marchandisation par le capitalisme qui parvient à les vider de leur sens. D’ailleurs, l’écoféminisme en a énormément souffert ces dernières années. Mais je ne peux pas renier l’héritage de l’écoféminisme dans mes écrits, dans ma trajectoire, notamment depuis ma rencontre avec des syndicalistes, des femmes qui travaillent sur les questions d’extractivisme en Amérique du Nord et du Sud. L’idée de ne plus établir de rupture entre la condition d’un territoire et celle des femmes et minorités de genre sur un territoire éclaire la réalité du lieu où je vis.
J’avais d’abord envie d’écrire sur le corps, mais je n’arrivais pas à le faire sans intégrer le territoire. Mon point de départ était la colère que je ressentais, car les principaux outils qu’on trouvait sur les façons de réparer un corps de son histoire, notamment dans une histoire patriarcale, faisaient abstraction du lieu, du milieu dans lequel le corps est censé se réparer. Or on ne se répare pas de la même façon selon le lieu où on habite : plus ton milieu vivant est moribond, plus ça sera difficile. Ayant grandi à la campagne, le lien d’attachement, la relation avec mon environnement vivant ont été fondamentaux pour m’aider à survivre aux diverses violences que j’ai vécues enfant. À l’âge adulte, c’est toujours le cas.
À propos des forces réactionnaires qui s’emparent des campagnes, la séquence politique des élections européennes puis législatives a remis un coup de projecteur sur les « milieux ruraux » qui seraient des voix acquises au Rassemblement national. Vous et d’autres personnes avez fait campagne sur le terrain pour la gauche, alors que vous n’appartenez à aucun parti. Que signifie « faire campagne » dans ces lieux-là, par rapport à la ville ?
Tout d’abord, nous n’avons pas les mêmes cadres organisationnels de gauche qu’en ville, à part les syndicats. Le milieu associatif se tient écarté du jeu politique afin de survivre, même s’il mène des actions qu’on pourrait facilement qualifier de gauche, de solidarité. Pour s’organiser sur ces territoires, il faut penser, construire des cadres via des espaces qui font la vie des campagnes, et les investir avec des valeurs de gauche : autour de l’école, des comités des fêtes, des clubs sportifs.
Il est vital de donner à voir les différents reliefs que sont ces territoires, et de les repolitiser.
Il y a aussi la question de l’interdépendance. En ville, tu peux choisir d’évoluer dans des espaces affinitaires sans changer ton quotidien. À la campagne, tu composes en permanence avec des relations sociales dans lesquelles il peut y avoir des divergences politiques énormes mais qui doivent rester conviviales, donc tu ne peux pas poser le débat de manière aussi affirmative. Il faut mettre au travail la conflictualité politique d’une autre façon, et surtout ne pas la fuir. Or c’est ce qu’il se passe aujourd’hui : on ne parle pas de politique, donc on laisse plus de pouvoir aux espaces déjà organisés – chez moi, ceux de l’agro-industrie.
Troisième chose importante : le commun politique. Ces territoires ont été historiquement exclus du commun politique tel que formulé par la gauche, et sont désormais exclus d’un certain commun, celui de l’État social, notamment par la disparition des services publics. Aujourd’hui, qui a la main sur la fabrication d’un commun politique qui inclut la ruralité et exclut les minorités, les racisés, les queers ? C’est l’extrême droite.
Quelle responsabilité a la gauche dans cette situation ?
Il y a un regard hégémonique porté sur les ruralités qui en fait la ruralité. Il est donc vital de donner à voir les différents reliefs que sont ces territoires, et de les repolitiser. Pendant la période des législatives, j’ai répété qu’il y avait une responsabilité partagée de la gauche et de la droite sur l’aliénation des ruralités, notamment liée à l’incapacité de démythifier la ruralité. La gauche s’est enlisée dans une histoire d’assimilation en les considérant comme des terres en dehors de la modernité, qu’il faut acculturer.
Il y a une rupture de confiance flagrante entre la gauche et les ruralités, et la gauche n’a pas l’air d’avoir très envie d’y remédier.
Cette attitude s’assortit souvent d’une tendance à retirer le pouvoir politique à celles et ceux qui sont catégorisé·es comme minorisé·es. Ce regard extérieur qui se veut bienveillant peut facilement basculer vers du mépris. En face, nous avons un récit de droite, traditionaliste, profondément réactionnaire, qui fait appel à un passé mythifié dessinant les campagnes comme l’incarnation d’une France éternelle. À la différence de la gauche, la droite ne les efface pas – ce qui a contribué au succès de la droite et de l’extrême droite lors de la période électorale –, mais cela dépolitise la ruralité, qui devient un objet fantasmé, homogène, servant un projet a minima xénophobe, voire racialiste.
Dans tous les cas, il n’y a pas d’existence en propre des ruralités comme territoires pluriels traversés par des histoires, des cultures, des personnes, des batailles politiques multiples. Par ailleurs, c’est un ressort de l’agro-industrie pour asseoir son empire en disant : « Nous, ruraux, prenons notre destin en main et prenons notre revanche sur l’histoire grâce à la réussite dans le capitalisme. » Or celle-ci se marie bien avec une interprétation politique à l’extrême droite de l’échiquier.
La gauche n’a pas été capable de produire un discours pour refabriquer un sens commun inclusif. Par exemple, le fait que le Nouveau Front populaire n’ait pas fait un seul meeting en territoire rural en dit long sur son mépris envers ces populations. Il y a une rupture de confiance flagrante entre la gauche et les ruralités, et la gauche n’a pas l’air d’avoir très envie d’y remédier. L’emprise de l’extrême droite est très forte sur la perception de la ruralité, en raison d’un héritage historique relativement peu égratigné qui a essentialisé ce rapport à la terre. Et cela nous empêche de faire des ruralités des espaces habitables et d’émancipation.
Pour aller plus loin…

Michaël Fœssel : « Nous sommes entrés dans un processus de fascisation »

Rose Lamy : « La gauche doit renouer avec ceux qu’elle considère comme des ‘beaufs’ »
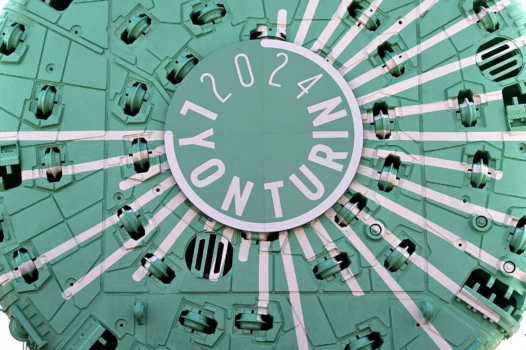
« La LGV Lyon-Turin est la quintessence du déni de démocratie »












