COP 16 : « Les élus et décideurs sont peu sensibles aux questions de biodiversité »
Le 21 octobre s’est ouverte la COP16 sur la biodiversité à Cali, en Colombie, jusqu’au 1er novembre. Une conférence moins médiatisée que celle sur le climat, mais qui traite pourtant d’un sujet central. Entretien avec Philippe Grandcolas, écologue et directeur adjoint scientifique de l’institut CNRS Écologie & Environnement.

© JOAQUIN SARMIENTO / AFP
Quelle est la situation aujourd’hui pour la biodiversité ? Comment a-t-elle évolué ?
Philippe Grandcolas : Aujourd’hui, nous sommes dans un moment de crise qui va en s’accélérant. Il y a vraiment un parallèle assez frappant avec la crise du climat. Ce n’est pas seulement l’interrelation entre le climat et la biodiversité, mais aussi l’effet de l’industrialisation de nos sociétés, et des pressions qui seront exercées sur les écosystèmes. Il y en a cinq : la disparition des habitats, la surexploitation, le changement climatique, les pollutions, et le transport d’espèces exotiques.
Cette accélération a été parfaitement synthétisée dans le rapport publié par l’IPBES en 2019. Malheureusement, la plupart des gens n’ont retenu qu’un élément de communication sur la crise d’extinction. Le souci est que cette crise est perçue uniquement comme un problème éthique : on va perdre des espèces et c’est grave. Effectivement, on n’a pas le droit de disposer d’organismes qui ne nous appartiennent pas.
Mais il ne faut pas que l’arbre cache la forêt, et que les gens pensent que c’est l’unique problème. Il y a des risques naturels qui découlent des effondrements de populations avant même les extinctions. Et il y en a beaucoup. Si vous avez supprimé la végétation et que vous avez des extrêmes climatiques, comme des sécheresses, ou des événements pluvieux, vous allez exacerber le résultat car 60% de l’eau de pluie se trouve dans la végétation.
La biodiversité est puissante, mais on ne le perçoit pas.
Pourquoi la biodiversité est-elle moins considérée que le climat ?
À la base, il y a un problème de représentation culturelle dans nos sociétés occidentales de la notion de biodiversité. Le Giec, groupe d’experts intergouvernemental sur le climat, est né avant l’IPBES qui s’occupe, elle, de la biodiversité. Le mot climat est aujourd’hui connu de tous. On regarde la météo à la télé, on croit savoir ce qu’est le climat. Mais le terme biodiversité est plus récent. Malheureusement c’est un cercle vicieux. Comme l’IPBES a été créé après le Giec, les élus et les décideurs sont moins sensibles à cette problématique. De fait, on l’envisage moins. J’ai d’ailleurs écrit un livre intitulé La puissance de la biodiversité, pour faire comprendre que la biodiversité est puissante, mais qu’on ne le perçoit pas.
Quels sont les enjeux de cette COP ? Y-a-t-il un réel pouvoir d’action ?
C’est tout le problème des COP. On râle toujours parce que ce sont de grandes messes internationales qui accouchent d’une souris mais si elles n’étaient pas là, on ne saurait même pas qu’on ne va ni assez vite, ni assez loin. Il y a quand même trois bénéfices aux COP : un bénéfice de visibilité d’une problématique, un bénéfice de négociations internationales, parce que ce sont des problèmes globaux, et le troisième bénéfice arrive lorsqu’on parvient à des accords.
Dans ce contexte, il est important que les pays du Sud soient considérés, comme la Colombie où se déroule la COP. Les accords doivent favoriser la solidarité financière, mais aussi éviter d’aggraver les tensions Nord-Sud avec des abus industriels et des attitudes moralisatrices du Nord sur le Sud. La COP 15 était une énorme négociation dans laquelle un cadre mondial a été formulé mais, deux ans après, peu d’États ont proposé des stratégies correspondantes. Pour celle-ci, la plupart des pays n’ont même pas indiqué quelles cibles ils voulaient viser dans l’immédiat.
Pire encore, certains comme la France prennent des décisions qui vont à l’encontre de la stratégie nationale biodiversité 2030 adoptée en 2023 : la suspension du plan Écophyto, le moratoire sur la déforestation, des aires marines protégées qui ne le sont pas vraiment. Et je crains que cela provoque de l’exaspération chez les gens et que des citoyens rationnels se détournent de ce genre de décisions. Il est important d’être honnête parce que dissimuler des échecs derrière des explications politiquement correctes ne trompe personne.
Justement, le journal Le Point a récemment publié un article sur l’absence de crise. Quelle est l’ampleur des biodiversité-sceptiques ? Est-ce un danger ?
Les « biodiversité-sceptiques » sont des gens qui sont soit dans le déni et n’aiment pas l’écologie politique, soit qui ont des conflits d’intérêt énormes. Par exemple, une personne travaillant pour l’agro-industrie aura du mal à critiquer l’utilisation des pesticides. Que l’écologie soit devenue un enjeu politique est une bonne chose, mais le problème vient de certains partis ou personnalités de mauvaise foi qui jouent sur ce clivage. Une manière de limiter le jeu de ces personnes malsaines est de limiter l’exaspération en présentant les choses autrement et de manière honnête.
Les efforts demandés ne sont pas que des renoncements et peuvent avoir des bienfaits au quotidien pour tout le monde : végétaliser la ville permet d’avoir en face de sa fenêtre un beau jardin public plutôt qu’un mur gris et de ne pas crever de chaud grâce aux arbres. On peut aussi opter pour des transports en commun, plutôt que de se faire écraser quand on est à vélo ou de conduire des gros SUV idiots. Il faut, pour cela, mettre en place un bon réseau de transports, comme à Strasbourg, à Lyon ou à Rennes.
Il faut que les gens comprennent qu’on ne va pas sauver la biodiversité de manière idéale.
C’est aussi une notion de compromis car il faut que les gens comprennent qu’on ne va pas sauver la biodiversité de manière idéale. Dans un monde réel, si on ne gère pas le climat, la biodiversité va perdre aussi. Les politiques doivent donc être transversales.
Pour aller plus loin…
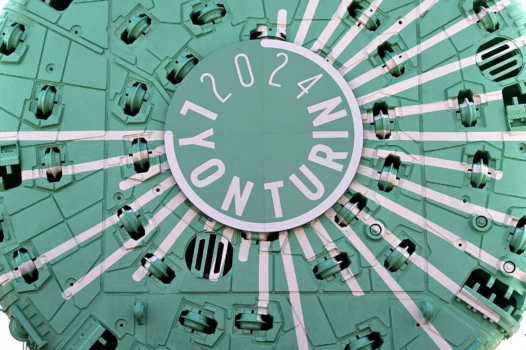
« La LGV Lyon-Turin est la quintessence du déni de démocratie »

Justice climatique : quatorze citoyens en colère

« Que l’État joue enfin son rôle avec un vrai plan d’adaptation climatique »









