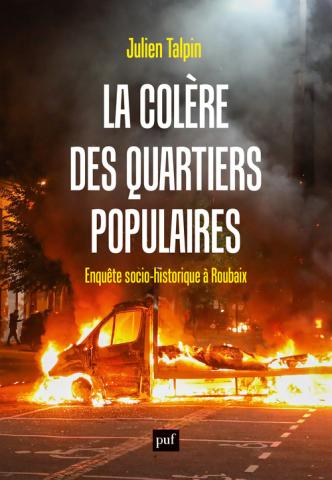« Aujourd’hui, le nouveau front, c’est d’aller faire communauté dans les territoires RN »
Auteur de La Colère des quartiers populaires, le directeur de recherches au CNRS, Julien Talpin, revient sur la manière dont les habitants des quartiers populaires, et notamment de Roubaix, s’organisent, s’allient ou se confrontent à la gauche.

© Hugo Boursier
Dans le même dossier…
2026 : un scrutin crucial pour les quartiers populaires « Les municipales sont vitales pour que La France insoumise perdure » Municipales 2026 : LFI à la conquête des villesC’était une promesse du Nouveau Front populaire après les législatives de cet été : reconquérir les catégories populaires. Le tout, pour renverser l’attrait de celles-ci pour le Rassemblement national, mais aussi, voire surtout, souffler sur ce sentiment de résignation pour qu’il disparaisse. Six mois plus tard, où en sommes-nous ?
La Colère des quartiers populaires / Julien Talpin / PUF / 2024 / 456 pages.
Quelle relation la gauche noue-t-elle avec une frange des populations précaires, celles vivant dans les quartiers de centres urbains ? Comment leurs habitants s’organisent, luttent, avec ou sans le camp progressiste ? C’est à toutes ces questions et plein d’autres que Julien Talpin, directeur de recherche au CNRS – Ceraps à l’Université de Lille, tente de répondre dans une enquête passionnante depuis la ville de Roubaix.
Votre enquête essaie d’explorer cette grande question sociologique : en dépit de leur colère, pourquoi les catégories populaires ne se révoltent-elles pas davantage ? Pourtant, il y a eu les Gilets jaunes, les manifs contre la réforme des retraites, les révoltes après Nahel, etc. Est-ce qu’on n’idéalise pas trop la révolte populaire ?
Julien Talpin : Un des enjeux de mon livre, c’est de donner à voir combien les habitants des quartiers, y compris ceux les moins organisés collectivement, ont une lecture politique des difficultés qu’ils connaissent. Ponctuellement, cette lecture débouche sur des mobilisations collectives, mais peu souvent par des organisations pérennes. Et, surtout, il y a peu de victoires. Le sentiment de résignation, très profond, qui explique aussi les formes de surgissement de la colère, se base sur cette conviction : la politique ne peut pas grand-chose. Le vote, les manifestations, l’engagement associatif sont empêtrés par un sentiment lié à une succession d’expériences déçues.
Vécues au quotidien, les discriminations raciales ne suffisent pas pour s’auto-organiser et confronter les pouvoirs publics ?
Quel « nous » habite dans les quartiers populaires ?
La dimension collective de l’expérience est réelle, mais fragile. Quel « nous » habite dans les quartiers populaires ? Contre ce « nous », il y a tout le spectre du « communautarisme », du « séparatisme », toutes les formes d’identité collective qui peuvent exister sur une base d’origine nationale et migratoire, religieuse, éthno-raciale, etc. Malgré ce contexte défavorable, des identités collectives se forment, mais ne permettent pas nécessairement une organisation qui débouche sur des revendications entendues par les pouvoirs publics. Dans cette histoire populaire de Roubaix, je raconte aussi combien c’est dur, au regard des formes de répression que subissent ceux et celles qui se mobilisent, de gagner, d’élargir le cercle, de transmettre à la génération suivante ses expériences militantes…
Une de vos explications repose sur les causes politiques d’une telle démobilisation. Cette inertie est-elle entretenue par les pouvoirs publics pour éviter toute velléité de transformation du système ?
Un des grands paradoxes qui traverse la participation des quartiers populaires en France, c’est que d’un côté les pouvoirs publics n’ont que la démocratie participative à la bouche et de l’autre, toutes les formes plus oppositionnelles qui échapperaient au cadre fixé par l’institution, sont difficilement accueillies. Y compris les formes plus ordinaires de participation, les centres sociaux, les associations de quartier, par leurs liens de dépendance (notamment financière) aux pouvoirs publics, sont souvent confinées dans leur capacité d’action et de politisation des problèmes sociaux.
Je pense par exemple au restaurant associatif, l’Univers, dans le quartier de l’Épeule, à Roubaix. Espace de solidarité ordinaire, il est devenu à un moment un espace de forte politisation – au moment des Gilets jaunes en particulier – où des débats, des discussions étaient organisés. La municipalité a coupé ses financements et a menacé l’existence même de cette association. On produit, ce faisant, la dépolitisation de la société civile.
La résistance des habitants du quartier l’Alma-Gare, promis à la démolition dans les années 1970, ne montre-t-elle pas une forme de saine collaboration avec les pouvoirs publics ?
C’est un exemple intéressant. Effectivement, cela s’est passé autrement. À cette époque, le champ du pouvoir était lui-même assez divisé. Le ministère de l’Équipement, à droite, a soutenu les habitants contre la mairie socialiste. Il y avait aussi des fonctionnaires militants qui voulaient les soutenir. Au-delà, un des enseignements de l’Alma c’est d’interroger la capacité des élus – y compris de gauche – à accueillir la critique et les contre-pouvoirs citoyens.
Comment expliquer qu’une ville comme Roubaix, où les minorités sont numériquement majoritaires, n’ait jamais élu un maire minoritaire ?
Ce qui ressort de mon enquête, c’est aussi une attente d’identification raciale aux représentants. Les gens ne veulent pas nécessairement avoir des gens qui leur ressemblent, mais qui ont les mêmes expériences qu’eux. Dans une ville comme Roubaix, on est frappé par la difficulté des minorités à accéder aux postes les plus élevés. C’est un peu en train de bouger : en Seine-Saint-Denis, ces dernières années, des personnes racisées ont pu devenir maires. Longtemps les minorités ont été cantonnées aux postes subalternes.
Jusqu’à quel point le fonctionnement interne aux partis écarte les populations racisées ?
J’accorde beaucoup de place au Parti socialiste qui a été longtemps à la tête de Roubaix. Je raconte le cas de Mehdi Massrour, qui aurait dû être le successeur du PS local. Et pour des raisons, entre autres de racisme, on va lui savonner la planche. Les Verts vont incarner cette représentation de populations minoritaires, mais ils se sont fait écraser par le PS à de nombreuses reprises.
Au sein du PS, plusieurs épisodes montrent que la consigne était de ne pas faire de place aux personnes racisées.
D’un côté, des formes de racisme interne jouent – au sein du PS, plusieurs épisodes montrent que la consigne était de ne pas faire de place aux personnes racisées. Mais aussi des formes de division intracommunautaires qui éclatent. Mehdi Massrour n’a pas pu être maire aussi parce qu’on lui a reproché de faire trop de place aux Marocains sur sa liste municipale et pas assez aux Algériens. Aujourd’hui, la ville est dirigée par la droite et la possibilité de voir un maire racisé, et a fortiori algérien, est pour le moins incertaine.
Cette donnée peut-elle changer avec les élections municipales de 2026, alors que le député blanc, David Guiraud, est ouvertement en campagne ?
L’annonce de la candidature de Guiraud a été mal vécue par tout le reste de la gauche locale, de par sa dimension très solitaire. Les Verts, à certains égards le PC, et surtout le PS, ont vu cette décision comme un coup de force. Ceux qui sont le plus sensibles aux questions de discriminations raciales questionnent à bas bruit le fait, qu’à nouveau, ce soit un homme blanc qui représente la gauche. Une position d’autant plus forte que David Guiraud est sensible aussi à ces questions. Il en est parfaitement conscient. En même temps, il est en vraie position de force.
Les résultats électoraux le soulignent, bien qu’ils puissent être marqués aussi par la dynamique du Nouveau Front populaire, au paravent de la figure de Jean-Luc Mélenchon, au cadrage de la France insoumise sur la Palestine… Évidemment, David Guiraud bénéficie d’un contexte national. Et en même temps, il a travaillé politiquement depuis deux ans pour construire sa légitimité. S’il devenait maire en 2026, ce serait aussi une forme d’aboutissement de la décomposition de la gauche roubaisienne, qui fait que seul un agent extérieur peut l’emporter. Derrière les reproches qui lui sont dirigés, il y a aussi la faiblesse des acteurs politiques à Roubaix dont l’ancrage populaire est extrêmement ténu.
Ce qui marche, ce sont les dynamiques d’alliance interpartisane, et l’identité politique qu’a réussi à construire tel ou tel candidat.
Ces dernières années, la France insoumise a investi des sujets qui sont centraux pour une partie importante des habitants des quartiers populaires : les discriminations, les violences policières ou encore la Palestine. Jusqu’à quel point cette focalisation peut lui permettre de conquérir des villes en 2026 ?
Cela peut fonctionner d’un point de vue électoral. Et c’est déjà le cas : les très bons scores de la FI à Roubaix pour les élections européennes le soulignent. La participation dans les bureaux de vote populaires a augmenté. Ce que nous enseigne la science politique, c’est que les élections ne se gagnent pas sur un programme. Ce qui marche, ce sont les dynamiques d’alliance interpartisane, et l’identité politique qu’a réussi à construire tel ou tel candidat. C’est pour cela que David Guiraud part avec de l’avance de ce point de vue là. À la condition qu’on ne se retrouve pas avec une gauche divisée. Jusqu’à quel point les divisions peuvent malgré tout conduire à un rassemblement au second tour ? Nous le verrons.
Cela pose aussi la question d’une prise en main sérieuse des inégalités et des discriminations à l’échelle d’une municipalité…
Tout à fait. Il ne suffit pas de prendre le pouvoir, il faut en faire quelque chose. J’ai montré dans mon livre combien les expériences de pouvoir déçues par la gauche ont conduit à la résignation des habitants. Il faut « faire mieux », pour paraphraser un livre célèbre. Comment expliquer que dans une ville où ces questions sont aussi sensibles pour ces habitants, l’institution municipale consacre si peu de moyens à la lutte contre les discriminations ? C’est assez significatif : les failles voire l’absence des politiques censées lutter contre le racisme dans des villes de gauche expliquent aussi la méfiance du politique dans les quartiers.
L’abstention et le discours critique des habitants envers les partis ouvrent-ils la voie à l’émergence de listes citoyennes qui pourraient représenter un renouveau démocratique ?
À Roubaix, et dans de nombreuses villes, il y a une histoire des listes citoyennes. Dès 1995 et plus encore en 2001, il y a déjà des listes autonomes qui se constituent. Ces listes-là vont être celles qui vont le plus ouvertement parler de racisme. Ce que ne font pas les partis de gauche à l’époque. Diversifier les candidatures élargit l’offre politique. Mais souvent, elles font des scores modestes ou, si elles l’emportent, c’est grâce au jeu d’alliance avec certains partis. L’arrivée de David Guiraud, à Roubaix limite fortement l’espace pour de telles initiatives en 2026.
Certains militants des quartiers populaires, tentés par ce type d’aventure, sont très conscients de leur situation de faiblesse par rapport à la FI, qui est plus forte qu’avant. Au-delà, je pense que le renouveau démocratique passe à la fois par un renouvellement du personnel politique, que permettent les listes citoyennes, mais aussi par la construction d’organisations populaires plus pérennes. Or les listes citoyennes sont souvent des coups politiques éphémères.
L’une des promesses du NFP cet été, c’était la reconquête des catégories populaires pour faire face à l’extrême droite. Où en est-on, six mois plus tard, selon vous ?
Renouer avec les catégories populaires, en milieu urbain comme rural requiert un travail militant de longue haleine et la construction d’un ancrage local durable. Il faut des organisations, et pas nécessairement obnubilées par les échéances électorales, mais aussi sur l’amélioration quotidienne de la vie des habitants. Aujourd’hui, le nouveau front, c’est d’aller faire communauté dans les territoires RN. Il y a besoin d’organisations collectives pour rompre les racines du vote RN. Cela n’arrivera pas uniquement par un travail au moment des campagnes.
Quelle que soit la fraction des classes populaires, il y a une attente d’État et d’égalité.
Ensuite, à partir d’un ancrage populaire fort, et malgré la diversité des territoires, il faut des programmes communs. Comment les construire parmi toutes les fractions des catégories populaires sans mettre de côté les intérêts spécifiques propres à chaque groupe ? Cette équation est très difficile pour la gauche, même s’il faut qu’elle soit capable de parler à la fois de services publics, de la santé, mais aussi de Palestine et d’islamophobie. Dans tous les cas, quelle que soit la fraction des classes populaires, il y a une attente d’État et d’égalité, et la défense des services publics peut contribuer à rassembler des populations qu’on oppose trop souvent.
Pour aller plus loin…

Aux États-Unis, l’habit fait le trumpiste

Naturalisation : des Palestiniens sous pression de la DGSI

« La surveillance des Palestiniens en Europe est très répandue »