« La généralisation de la contraception n’a pas permis une révolution sexuelle »
Dans son livre Des corps disponibles, la sociologue Cécile Thomé revient sur l’histoire des méthodes contraceptives pour comprendre comment elles façonnent la sexualité hétéro.
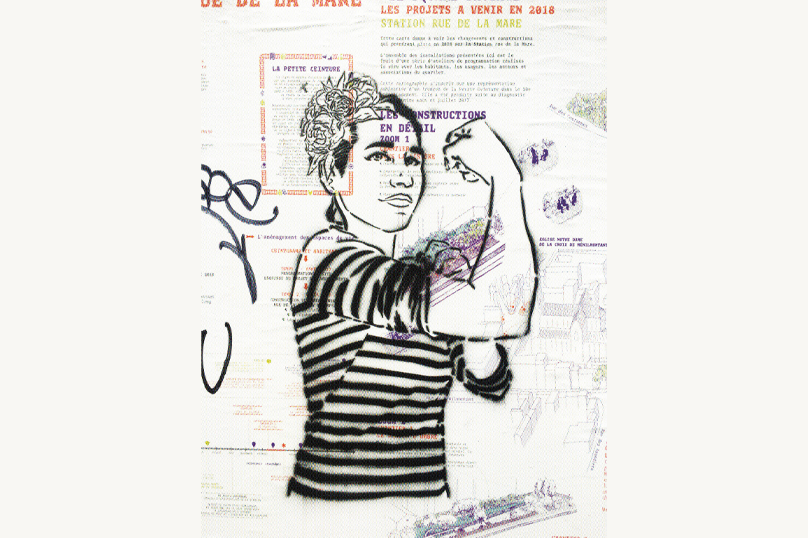
© Louise Moulin
Pendant dix ans, vous avez interrogé des femmes de tous âges sur leur vie contraceptive (1). La contraception est-elle perçue comme une charge par toutes les générations ?
Cécile Thomé : Quand la pilule est arrivée, il n’y avait rien d’aussi efficace. Elle paraissait tellement magique qu’elle n’était pas perçue comme une charge. Au fil du temps, l’idée de pouvoir choisir le moment où l’on tombe enceinte devient de plus en plus normale. Aujourd’hui, on considère le droit à la contraception comme acquis, donc on peut formuler des critiques sans avoir peur qu’il soit supprimé.
Concernant la charge contraceptive, les critiques s’inscrivent dans un contexte global de remises en question féministes qui tendent à plus d’égalité entre les hommes et les femmes. Ces réflexions sur la contraception émergent en même temps que la remise en cause des hormones. Il y a vraiment des effets de génération en matière de contraception, et les femmes évoluent dans leur réflexion au cours de leur vie.
Dans mes travaux, j’utilise d’ailleurs plutôt le terme de « travail contraceptif ». La charge contraceptive fait écho à l’idée de charge mentale, donc à ce qu’on a dans la tête. En ce qui concerne la contraception, la charge est aussi matérielle : acheter son contraceptif, poser un congé pour aller chez le médecin, gérer les effets secondaires, etc. C’est un travail qui prend du temps de vie disponible.
Il y a des femmes qu’on encourage à faire des enfants, et d’autres pour lesquelles on préfère qu’elles évitent.
Les conséquences sur le corps des femmes
Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :
Pour aller plus loin…

Municipales 2026 : à Cayenne, l’enjeu sécuritaire dépasse la campagne

Au quartier pour mineurs de la prison de Metz, « sans liberté, on fait comme on peut »

« L’expression “ferme France” perpétue un imaginaire paysan bleu-blanc-rouge »







