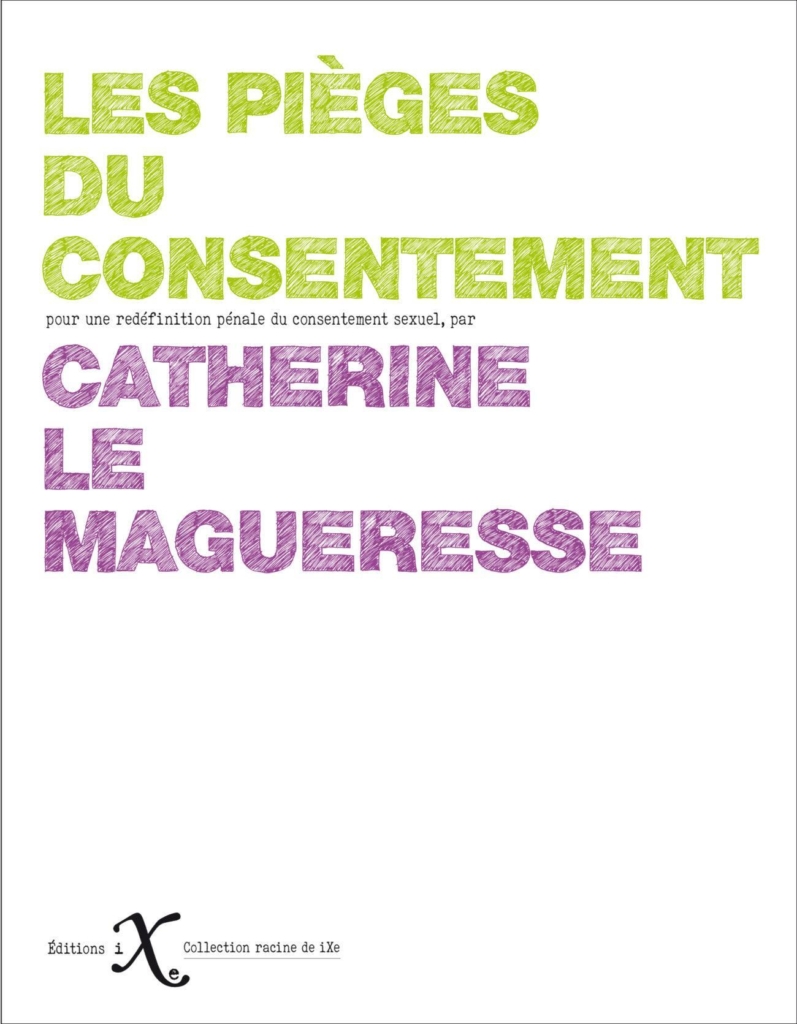Faut-il introduire le consentement dans la définition du viol ?
Tandis que des féministes considèrent, comme Catherine Le Magueresse, que la loi serait plus juste et efficace si elle contenait la notion de consentement, d’autres, comme Suzy Rojtman, craignent que cela ne focalise encore plus les magistrats sur les victimes.

© Anna Margueritat / Hans Lucas / AFP
Avec le procès dit de Mazan, la question de la définition du viol est revenue dans l’agenda politique. Le ministre de la Justice, Didier Migaud, s’est dit favorable à l’inscription du consentement dans la loi. Les députés de La France insoumise (LFI), reprenant des travaux interrompus par la dissolution, ont ajouté une proposition de loi en ce sens dans leur niche parlementaire. Pourtant, dans le champ féministe, la question suscite de vifs désaccords.
Les unes estiment qu’il s’agirait d’un véritable « changement de paradigme », quand d’autres considèrent que cette évolution irait à « contre-courant d’un véritable progrès sur la répression des violences sexuelles ». Pour saisir les enjeux du débat, entretien croisé entre Catherine Le Magueresse, juriste et ex-présidente de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, autrice du livre Les Pièges du consentement (iXe, 2021), et Suzy Rojtman, cofondatrice du Collectif féministe contre le viol (CFCV), et aujourd’hui porte-parole du Collectif national pour les droits des femmes.
Selon vous, quelle nécessité y a-t-il aujourd’hui à changer la loi sur le viol forgée en 1980 en y intégrant la notion de consentement ?
Catherine Le Magueresse : Intégrer le consentement dans la loi permettrait de changer de paradigme en matière de violences sexuelles. Historiquement, pour les juristes, ce qui constitue le viol, c’est la violence. Avec l’arrêt Dubas de 1857, la Cour de cassation fait émerger les notions de contrainte et de surprise. Avant la loi de 1980, le viol n’était pas défini par le code pénal. Il l’a donc été par la jurisprudence.
Pour qu’il y ait viol, les magistrats estimaient que les femmes devaient avoir résisté, et donc porter des traces de coups sur elle, avoir crié, déposé plainte immédiatement, etc. Avec l’affaire d’Aix-en-Provence, en 1978, Gisèle Halimi fait un procès politique du viol, qui s’appuie sur les luttes menées par les féministes dans les années 1970. Ce procès aboutit à la loi du 23 décembre 1980.
Durant les débats parlementaires, la question du consentement est omniprésente, mais la loi ne l’intègre pas. Elle intègre en revanche la jurisprudence du XIXe siècle, et avec elle l’idéologie patriarcale et les stéréotypes sexistes de ce siècle. Selon cette jurisprudence, toujours citée par la Cour de cassation, « le défaut de consentement » résulte du recours à une « violence, contrainte, menace ou surprise » et non principalement du refus des femmes ou de leur silence.
Au fond, la façon dont le viol est conceptualisé repose sur ce que j’appelle « une présomption de consentement dans la loi » qui profite aux agresseurs. C’est-à-dire que, par défaut, les femmes sont présumées consentantes. Repenser la définition pénale du viol en y intégrant une définition du consentement positif serait une façon de changer radicalement d’approche.
Suzy Rojtman : Non : la question du consentement n’est pas omniprésente dans les débats de la loi de 1980. Ceux-ci ont porté surtout sur les discriminations homosexuelles, l’échelle des peines, la partie civile des associations et la publicité des débats. Le livre Qualifié viol (1) le montre bien. Les féministes se sont battues pour que le viol soit reconnu comme un crime, non sur le consentement, dont personne ne parlait.
Qualifié viol / Michèle Bordeaux, Bernard Hazo et Soizic Lorvellec / Méridiens-Klincksieck / 1990.
Le problème aujourd’hui n’est pas la définition du viol, mais la manière dont les magistrats l’interprètent. Si on introduit le mot « consentement » dans la définition du viol, on quitte le domaine de la prédation et du pouvoir pour celui de la sexualité, ce que le viol n’est pas. Le sexe est un outil de domination dans le viol, mais ce n’est pas de la sexualité, même si celle-ci n’est pas exempte de domination patriarcale. Introduire le consentement dans la loi sème la confusion.
Ce qui fonde les décisions des magistrats, plus que la définition du viol, c’est une justice qui est patriarcale.
S.R.
La loi actuelle couvre toutes les situations : « Tout acte de pénétration sexuelle […] commis sur la personne d’autrui […] par violence, contrainte, menace ou surprise constitue un viol. » Mais les magistrats ont une conception très patriarcale et hétéronormée de la sexualité, qu’ils appliquent dans leurs décisions au détriment des victimes. Après le vote de la loi, par exemple, beaucoup de magistrats ont discuté de ce qu’était une pénétration sexuelle, ne reconnaissant bien souvent ni la sodomie, ni la fellation, ni le viol conjugal.
Sur le viol conjugal, il y a eu une décision de la Cour de cassation en 1990. Il n’empêche qu’il a fallu relégiférer en 2006 car, vingt-six ans après, le viol conjugal n’était quasiment jamais reconnu. Cet exemple montre que ce qui fonde les décisions des magistrats, plus que la définition du viol, c’est une justice qui est patriarcale, bourgeoise et souvent raciste.
Comment vos parcours féministes et professionnels vous ont-ils conduites à forger vos positions actuelles sur le consentement ?
C. L. M. : En accompagnant des victimes à l’AVFT-Libres et égales (Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail), j’ai constaté que les poursuites et les condamnations étaient très rares, même dans des procédures où il y avait des éléments de preuve solides. Je me suis donc interrogée sur les causes de cette réalité. La critique féministe du droit sur les biais tant de la conceptualisation que de la mise en œuvre du droit m’a beaucoup apporté.
Certes, le sexisme des magistrat·es opère fréquemment et fait qu’il y a peu de renvois devant les tribunaux. Mais, dans nombre d’affaires, l’absence de poursuite ou de condamnation s’explique par le fait que les magistrat·es ne parviennent pas à qualifier ce que requiert le code pénal. Concrètement, cela veut dire que, sans preuve d’un recours à une violence, contrainte, menace ou surprise (VCMS), il n’y a pas de viol. Or il y a des situations dans lesquelles il y a viol sans qu’il y ait ces éléments.
Pour que les infractions de viol et d’agression sexuelle soient constituées, il est nécessaire de caractériser l’élément matériel (pénétration ou non, commis avec VCMS) et l’élément intentionnel. Ce qui distingue le viol d’une relation sexuelle, c’est le consentement. C’est la raison pour laquelle les mis en cause allèguent ce consentement et disent par exemple « j’ai cru qu’elle était d’accord ». Et le droit le leur permet, parce qu’il ne définit pas le consentement.
Ce consentement allégué se retrouve toujours au cœur de la stratégie de défense des agresseurs qui vise à ramener le viol dans le champ de la sexualité. Or la preuve de l’intentionnalité découle pour une large part de la preuve d’une VCMS. Il est fréquent de lire des décisions dans lesquelles les magistrats disent en substance « on vous croit, madame, quand vous nous dites que vous n’étiez pas d’accord ; pour autant, en l’absence de preuve de VCMS, nous sommes obligés de relaxer ».
Définir le consentement d’une façon féministe (…) empêchera les agresseurs de dire ‘j’ai cru qu’elle était consentante’.
C.L.M.
Définir le consentement d’une façon féministe, imposer à la personne qui initie un contact sexuel de s’assurer de l’accord libre de toute coercition de l’autre empêchera les agresseurs de dire « j’ai cru qu’elle était consentante ». Il ne s’agit pas de « croire » mais de s’en assurer. Cela permettra notamment de prendre en compte des états de sidération ou de dissociation qui sont courants lorsqu’il y a des violences sexuelles.
S. R. : J’ai cofondé en 1985 le Collectif féministe contre le viol, j’ai animé pendant treize ans des groupes de parole. Donc je parle d’une parole militante. Le droit ne doit pas être laissé aux juristes. C’est éminemment politique. C’est de cette expérience militante auprès des victimes que j’ai forgé mon point de vue. Lors des procès en général, on met la victime sur la sellette. Au lieu de prouver ce qu’on appelle la « stratégie de l’agresseur », à savoir ce qu’il a mis en œuvre pour réussir à isoler la victime pour pouvoir passer à l’acte et assurer son impunité, on va se focaliser sur la victime.
Mais c’est la stratégie de l’agresseur qui est la caractéristique du viol, non le défaut de consentement. Systématiquement, l’agresseur crée les conditions qui vont lui permettre d’attaquer. Ce sont ces éléments-là qui doivent apparaître dans les dossiers. Si on ajoute le consentement, on va encore plus se focaliser sur la victime. Je ne fais absolument pas confiance aux magistrats et au personnel de justice pour modifier leur façon de juger, car on est dans une société où il y a un nombre faramineux de classements sans suite et où très peu de victimes portent plainte, voyant bien comment ça se passe.
En quoi le recul permis par des législations ayant introduit le consentement dans la loi, comme le Canada ou la Suède, vous conforte-t-il dans vos points de vue respectifs ?
S. R. : Le Canada a introduit en 1992 le consentement dans le code pénal et ça n’a absolument rien changé. Le nombre de dépôts de plainte est de 5 %, le nombre de condamnations est très faible, et on se heurte de nouveau à la façon dont les magistrats envisagent le viol. Alors, penser qu’avec un coup de baguette magique on va avoir beaucoup plus de condamnations et beaucoup moins de classements sans suite est une illusion totale.
Ce à quoi travaillent de nombreuses associations féministes actuellement, c’est une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles qui touchera aussi les violences sexistes, les choses sont inséparables. Insister sur la prévention me semble déterminant : la sensibilisation du public pour qu’il sache décrypter ce qu’est un viol, la formation des professionnels, la solidarité vis-à-vis des victimes, la prévention de la récidive, etc.
C. L. M. : En Suède, où le système juridique est proche du nôtre, le changement de la loi a augmenté de 75 % le nombre de condamnations. Quant au Canada, je me suis intéressée à son système en lisant l’arrêt Ewanchuk, l’un des premiers arrêts de la Cour suprême appliquant la loi de 1992. C’est un arrêt de critique féministe du droit qui est important. Aujourd’hui, le droit canadien peut permettre de qualifier de viol des situations qui échappent au droit français. Lors d’un colloque que j’ai coorganisé dernièrement avec François Lavallière, une procureure canadienne nous a présenté une affaire qu’elle était amenée à juger. Selon le droit français, le mis en cause était acquitté ; selon le droit canadien, il a été condamné.
Pour qu’il y ait consentement, il doit être libre et éclairé, c’est-à-dire libre de toute coercition.
C.L.M.
Je suis, bien entendu, convaincue de l’importance d’agir sur l’application du droit. Simplement, les acteurs de la chaîne judiciaire ont l’obligation d’appliquer le code pénal. Si on modifie le droit, ils ne pourront plus poser les mêmes questions. Ils seront obligés d’interroger l’agresseur. « Comment vous êtes-vous assuré du consentement de madame ? » Le changement de paradigme recherché, ce n’est pas, contrairement à ce qui est souvent dit, le fait d’interroger principalement les femmes sur leur consentement (absent puisqu’elles déposent plainte pour viol), mais d’abord interroger l’agresseur.
Aujourd’hui, on peut lire dans des décisions, « je n’ai pas cru que le non était sérieux ». Ou encore : « Effectivement, elle a dit non. » À l’heure actuelle, la preuve d’un refus n’entraîne pas nécessairement une condamnation. Alors qu’avec une définition du consentement positif, quand on dit non, ça veut dire non, quand on ne dit rien, cela veut aussi dire non et quand un accord est donné, sa validité doit être interrogée car « céder n’est pas consentir ». Pour qu’il y ait consentement, il doit être libre et éclairé, c’est-à-dire libre de toute coercition. Si le consentement est cédé, quand bien même il aurait été énoncé, il n’est pas valable.
S. R. : Il faut savoir que l’agresseur peut mentir. Il ne prête pas serment, il raconte ce qu’il veut. C’est le droit de la défense. Interroger l’agresseur sur son argument du consentement, les avocates féministes le font déjà. Ce qu’il faut, c’est obliger les juges à établir la stratégie de l’agresseur. Ils vont encore se retourner vers la victime pour l’interroger sur son comportement. Je l’ai vu par mes activités au CFCV : les femmes résistent toujours d’une façon ou d’une autre, mais finissent par céder, car au bout d’un moment elles se disent que leur vie va y passer.
Il y a l’effet de dissociation. Ça, les magistrats ne le savent pas, il faut le leur apprendre.
S.R.
Et il y a l’effet de dissociation. Ça, les magistrats ne le savent pas, il faut le leur apprendre. Ce n’est pas uniquement un problème de formation, mais de rapport de force. Il faut imposer un rapport de force pour expliquer ce qu’est une situation de viol, et ce n’est pas l’histoire du consentement qui va changer quoi que ce soit. D’autant plus que le fait d’ajouter des qualificatifs au consentement tels que positif, libre ou éclairé, montre bien que la notion n’est pas claire.
Plusieurs propositions de loi ont été déposées pour introduire le consentement dans la loi. La plus récente est celle déposée par les députés insoumis dans leur niche parlementaire, qui sera discutée fin novembre. Vos avis ont-ils été sollicités pour son élaboration ?
S. R. : Il faut que les groupes parlementaires prennent des avis éclairés. On a été auditionnées par la mission parlementaire pour une redéfinition du viol de l’Assemblée nationale, par Véronique Riotton et Marie-Charlotte Garin. Concernant LFI, on va les solliciter pour être auditionnées avant le 28 novembre avec d’autres associations.
C. L. M. : J’ai été sollicitée par la mission parlementaire pour une redéfinition du viol. Concernant les propositions de loi déposées au Sénat et à l’Assemblée nationale par Mélanie Vogel et Sarah Legrain, je n’ai pas été sollicitée, mais serais ravie d’échanger avec elles. Ces propositions de loi pourraient être contre-productives car la définition du consentement proposée est pauvre et n’indique pas, par exemple, dans quel cas il n’y a pas consentement.
En fait, on n’est pas loin du consentement libéral tel que je le dénonce dans mon livre et qui justifie les rapports de domination par le consentement. L’objectif est d’analyser le consentement à l’aune de ces rapports de pouvoir et de domination. Il est au cœur des travaux que nous menons au sein de notre groupe de travail composé d’associations, d’avocates, de magistrat·es et d’universitaires.
Que pensez-vous de l’opportunité d’avoir ces débats qui révèlent des dissensions au sein du mouvement féministe ?
C. L. M. : Toutes les critiques font progresser et permettent d’affiner nos textes. Notre objectif, partagé avec mes camarades féministes, est d’éradiquer les violences et de faire que les victimes soient entendues et que les agresseurs soient condamnés. En l’état, ni le droit ni le traitement judiciaire des violences sexuelles ne permettent de rendre justice correctement ; au point que nous hésitons à conseiller aux victimes de déposer plainte, à moins que des avocat·es, psychologues, proches, associations, formés ou sensibilisés, formant un cercle de solidarité, ne les accompagnent.
S. R. : Le consentement n’est pas le débat essentiel. On pourrait toutes s’unir sur une loi-cadre intégrale qui aborde toutes les problématiques des violences sexuelles et sexistes. Et établir un rapport de force par nos luttes féministes pour les mesures qu’on préconise dans la loi-cadre intégrale. Par la dénonciation des jugements qui sont dégueulasses, par la solidarité avec les victimes.
Pour aller plus loin…

5,3 milliards d’euros : l’inquiétant pactole de Vincent Bolloré

« L’affiche a encore le pouvoir de communiquer avec tout le monde »

Algérie – France : « Le problème, c’est la connaissance »