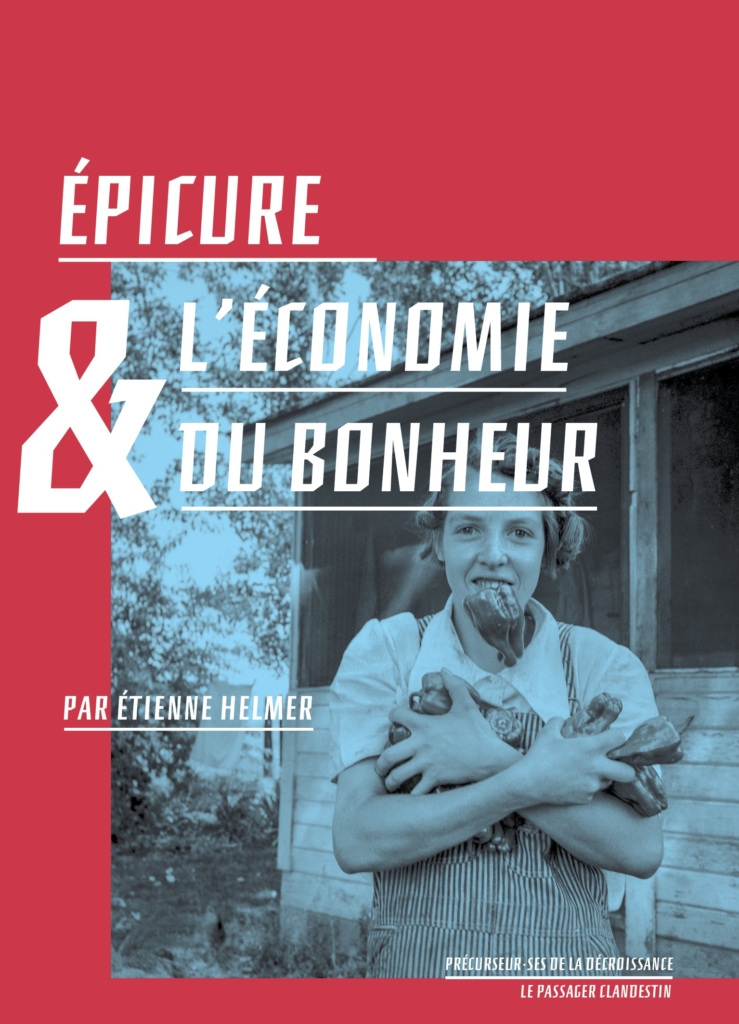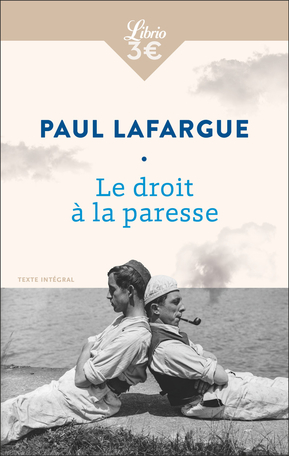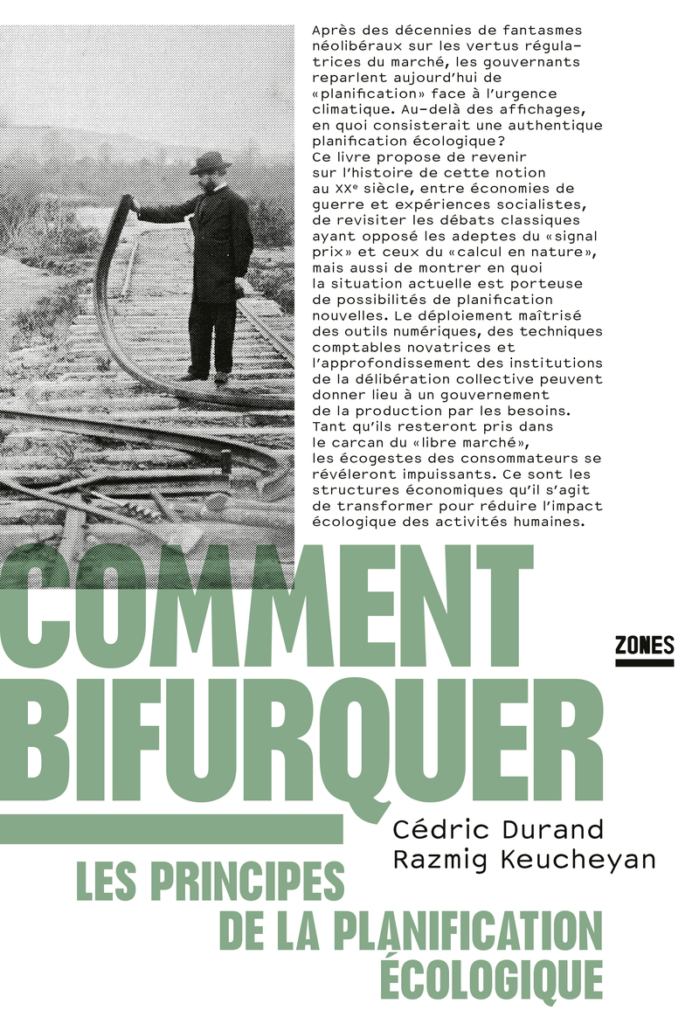Le droit à la paresse, c’est (toujours) de gauche !
Les congés payés et la réduction du temps de travail appartiennent à l’histoire des combats pour l’émancipation des travailleurs. Mais, aujourd’hui, ces luttes vont de pair avec l’indispensable bifurcation écologique. Prôner le buen vivir, c’est aussi refuser la croissance infinie qui ne satisfait que les capitalistes et détruit notre cadre de vie.
dans l’hebdo N° 1841-1843 Acheter ce numéro

© Charles Chaplin Productions / Collection ChristopheL / AFP
Au-delà du fantasme des chars russes défilant place de la Concorde, notre bonne vieille bourgeoisie hexagonale jouant à se faire peur – sans jamais y avoir vraiment cru –, il n’y eut sans doute rien en juin 1981, au lendemain de l’élection de François Mitterrand, qui exaspéra plus la droite française que la création d’un ministère du Temps libre. Certes, ces braves gens s’étaient, depuis l’été 1936, habitués à voir des millions de travailleurs « envahir » durant les vacances ce qui fut longtemps « leurs » plages (1).
Cf. le savoureux témoignage du philosophe Gilles Deleuze, dans son Abécédaire, narrant combien sa mère, pourtant généreuse et catholique, fut littéralement outrée, au mois d’août 1936, par l’arrivée de « ces gens », désignés comme « les congés payés », à Deauville, où sa famille bourgeoise avait ses habitudes chaque été.
L’attribution de ce ministère de plein exercice, de mai 1981 à mars 1983, à André Henry, ancien instituteur et syndicaliste enseignant, représentant, à ce titre, du noyau dur de l’électorat de François Mitterrand à cette époque, fut un signe politique assumé par le nouveau pouvoir socialiste. La fin d’une période d’opposition de vingt-trois ans promettait notamment la satisfaction d’un grand nombre de revendications anciennes, notamment celles portées durant la turbulente décennie 1970, où la promotion du temps libre figurait en bonne place en tant que valeur de gauche, honnie à droite et par le patronat.
Cette conception de la vie remonte au IVe siècle avant J.-C., avec la pensée du philosophe grec Épicure (2). Trop souvent caricaturée jusqu’à nos jours – dès l’Antiquité d’ailleurs, en particulier à Rome – comme celle d’un « bon vivant » uniquement tourné vers le plaisir à outrance, sa philosophie, maintes fois reprise ensuite, promeut au contraire une hygiène de vie fondée sur l’équilibre et la retenue.
Voir sur sa pensée, dans la collection « Précurseur·ses de la décroissance », l’excellent Épicure et l’économie du bonheur, Étienne Helmer, Le Passager clandestin, 2021.
Selon Épicure, l’excès ne peut être que source de souffrances, et la clé du bonheur est indissociable de la connaissance de ses propres limites. Foin de la trop fréquente présentation de ces supposés « épicuriens », voire libertins, courant les orgies et autres agapes, faisant dénigrer ce courant philosophique, pourtant majeur, qui a promu jusqu’à nos jours, après Rousseau, Lafargue ou Nietzsche, une vraie source d’émancipation de la condition humaine.
En bon lecteur des écrits (déjà classiques) d’Épicure, le Romain Sénèque reprend à son compte, au Ier siècle de notre ère, bon nombre de ses enseignements. Il affirme ainsi l’importance de l’oisiveté, afin de pallier une activité trop intense, pour approcher une forme de bonheur. Il promeut ce « contrepoint nécessaire » non pour « ne rien faire », mais pour privilégier une activité méditative, l’étude ou la contemplation.
Dans une sorte de retraite, l’oisiveté apparaît comme un « exil intérieur » vers le bonheur. Évidemment, à cette époque, bien peu pouvaient, économiquement, s’octroyer une telle liberté. Mais le fondement philosophique de ce droit au « repli » laissera une trace profonde dans la réflexion sur l’activité humaine.
Après de nombreux siècles de souffrances et de labeur intense, au sortir du Moyen Âge, une sorte de détente, plus contestataire, apparaît à la Renaissance, avec les écrits de La Boétie – et sa « servitude volontaire » – et surtout Montaigne et ses Essais. Mais l’heure n’est pas encore à l’éloge du temps libre proprement dit. Au XVIIIe siècle, en revanche, des philosophes mettent en avant la notion de plaisir et surtout l’octroi d’un temps propice à la réflexion, voire, comme chez Rousseau, à la rêverie, à l’observation de la nature, permettant de philosopher et de profiter de la vie.
Le ‘droit au bonheur’ dans la Constitution de la Corse indépendante.
Saluée par tous les philosophes des Lumières, de Voltaire à Diderot ou Rousseau, comme l’une des plus progressistes au monde, la brève Constitution de la Corse indépendante (1765-1769), emmenée par Pasquale Paoli, inscrit dans l’un de ses premiers articles le « droit au bonheur » pour tous les Corses, concept très original et novateur pour l’époque.
Un privilège social
Bien entendu, la flânerie pour pouvoir philosopher est loin d’être promise à tous, et seules les classes aisées peuvent en jouir et en tirer un profit intellectuel. Le peuple et les classes laborieuses n’en rêvent même pas. Il faudra l’industrialisation au XIXe siècle pour que certains des penseurs anarchistes, socialistes ou communistes de l’émancipation commencent à émettre l’idée que le prolétariat a, lui aussi, le droit de profiter de l’existence en dehors de son seul devoir de travailler pour subvenir à ses besoins.
La bourgeoisie – jusqu’au mitan du XXe siècle – s’offusque de cette prétention, ne cessant d’affirmer, avec un mépris évident, qu’octroyer du temps libre aux ouvriers ne saurait que les jeter dans l’alcoolisme, sans doute en vertu du vieil adage selon lequel « l’oisiveté est mère de tous les vices » ! Au sein du courant marxiste, le principal penseur à promouvoir l’idée du temps libre – et donc de la réduction du temps de travail – est sans aucun doute Paul Lafargue avec son célèbre Droit à la paresse (1880).
Il n’est d’ailleurs pas sans provoquer, à gauche et dans le camp socialiste même, de fortes oppositions, l’Internationale socialiste étant dans son intitulé même « ouvrière ». Et l’une de ses principales revendications est, depuis 1848 et la IIe République, le « droit au travail ». Or le sous-titre du pamphlet « marxo-rabelaisien » (selon l’historien du socialisme Gilles Candar) de Paul Lafargue est : « Réfutation du ‘droit au travail’ de 1848 ».
On sait même que le texte, paru au départ sous forme de feuilleton dans l’hebdomadaire L’Égalité, qui représente la fraction de l’aile gauche socialiste emmenée par Jules Guesde (longtemps opposé à Jaurès), ne plut pas au beau-père de Lafargue, qui n’était autre que Marx lui-même. Lafargue avait en effet épousé Laura Marx, deuxième fille de Karl Marx et principale traductrice en français de ses œuvres, et il était aussi l’un des principaux diffuseurs de la pensée marxiste dans l’espace francophone.
Ambivalence
Pourtant, dans l’œuvre de Marx, le travail a un double caractère, par nature ambivalent. Il est, d’une part, le « prolongement de l’homme », partie centrale de son existence individuelle, qui lui donne une « reconnaissance » par les autres humains et même crée une solidarité entre les individus. Mais, d’autre part, le travail est aussi aliénant dans le système capitaliste puisqu’il « tue l’homme en tuant son temps de vie ». On retrouve ici la question du temps !
Pourtant, le vieux Marx, qui allait mourir quelque temps après, verra sans doute dans les écrits de son gendre français un risque de division du mouvement ouvrier, qui se concentre alors sur la défense du droit au travail pour assurer des moyens de subsistance à la classe ouvrière (et paysanne). Et la proposition de Lafargue de réduire la journée de travail à « trois heures par jour » paraît bien utopique, sinon choquante à l’époque, y compris au sein du mouvement ouvrier – craignant sans doute sa décrédibilisation avec une telle revendication.
Les organisations ouvrières auront en effet souvent quelque gêne à affirmer fièrement ce « droit » au temps libre. Ainsi, les congés payés, conquête iconique (de deux petites semaines) de juin 1936, ne figuraient pas dans le programme du Front populaire, Blum n’y croyant pas lui-même. Ce sont les délégués syndicaux qui vont l’arracher dans les négociations, avec cette image célèbre d’un dirigeant de la CGT sortant sur le perron de Matignon, Gauloise au bec, déclarant fièrement : « On leur a pris quinze jours ! »
Depuis, les 35 heures hebdomadaires ont été un cri de ralliement des syndicats de toute l’Europe, et tous ont regardé avec fierté leur instauration en France à la fin du siècle dernier par la volonté de Martine Aubry, non sans attaques outragées du patronat. Et on a vu récemment que le même patronat n’avait pas renoncé à s’opposer à l’accroissement du temps libre pour les travailleurs. La récente défaite du mouvement contre la hausse de l’âge du départ la retraite à 64 ans l’a bien montré. Emmanuel Macron, en bon petit télégraphiste du Medef, a satisfait ses maîtres !
Le nouveau prisme de l’écologie
Suivant la pensée d’Ivan Illitch, qui prône « l’abolition du travail salarié », André Gorz, existentialiste sartrien, développe dès les années 1960 une approche s’opposant à la croissance économique incessante et au développement capitaliste infini. La préoccupation écologique prend enfin forme, induisant celle d’une décroissance sans doute inévitable à terme.
Vient enfin la conscience qu’après avoir atteint un stade de développement économique et social important, concourant aux besoins essentiels des populations – même si les inégalités demeurent et exigent d’être toujours plus corrigées –, les sociétés devraient se préoccuper de préserver leur lieu de vie, au lieu de ne songer qu’à augmenter leurs profits matériels et financiers. Pourquoi produire davantage quand on possède déjà tous les biens de consommation dont on a besoin, sachant qu’une telle surproduction ne fera que détruire l’environnement ? Cette prise de conscience est une véritable révolution.
Ce nouveau paradigme bouleverse donc l’approche de la « valeur travail », considérée jadis comme centrale. La sociologue Dominique Méda, spécialiste des questions relatives au travail, a souligné dans nombre d’ouvrages que, si le travail reste un « fait social total » et d’abord un « moyen individuel de réalisation de soi et un mode privilégié de lien social », cette affirmation ne saurait s’affranchir de la nécessité d’une réduction de la place du travail dans la vie individuelle et sociale. En particulier pour une répartition plus égale des tâches domestiques et parentales entre femmes et hommes, et entre vie professionnelle et vie familiale.
En dépit de ses faiblesses ou de ses renoncements, il faut reconnaître à la gauche française le mérite de ne pas avoir, à la fin du siècle dernier, renoncé au progrès social incontestable que constitue la réduction du temps de travail, et donc au droit au temps libre pour chaque travailleur. La loi adoptant le principe des 35 heures hebdomadaires apparaît alors au monde entier comme une évolution audacieuse.
Poursuivre le rêve de l’accumulation infinie du capitalisme néolibéral est une impasse.
J-M. Harribey
Mais, si cette disposition s’inscrit encore dans la lignée d’une revendication ancienne du mouvement ouvrier, elle peut également surgir d’une préoccupation nouvelle, nécessaire, voire urgente : celle d’un changement de mode de développement économique, industriel et social, rompant avec celui de la consommation infinie, sans égard ni limite, des ressources naturelles de la planète. Car, comme le soulignait récemment l’économiste « atterré » Jean-Marie Harribey, collaborateur de Politis, « poursuivre le rêve de l’accumulation infinie du capitalisme néolibéral est une impasse », et la question de la post-croissance est désormais posée. Indéniable.
La question du temps libre et de la réduction du temps de travail se pose donc désormais, bien sûr en termes de droits pour les travailleurs, mais interroge aussi la justification même de produire davantage. Sur une planète qui ne sait plus que faire de ses déchets – nucléaires, notamment –, qui compte un « sixième » continent de plastique au milieu de ses océans, produit à outrance des gaz à effet de serre et empoisonne tous ses sols de nitrates, le temps libre apparaît dorénavant non plus seulement comme un droit fondamental pour le bien-être des exploités sous toutes les latitudes, mais plus encore comme une question de survie à l’échelle planétaire.
La surproduction de biens de consommation, superflue – en particulier pour nous autres Occidentaux –, nous mène vers la destruction inéluctable du globe. La revendication du buen vivir mise en exergue par les Forums sociaux mondiaux, dès le premier à Porto Alegre, au Brésil, en 2001, lie la préservation de notre environnement à la nécessité de la décroissance.
L’octroi de davantage de temps libre s’inscrit donc aujourd’hui, en dépit des appétits insatiables de profits de nos boursicoteurs internationaux inconscients, dans une logique – vitale – de « bifurcation écologique », comme l’ont admirablement démontré l’économiste Cédric Durand et le sociologue Razmig Keucheyan dans un ouvrage qui a fait date (3), puisqu’il ne fait plus de doute que « le monde du capitalisme industriel, productiviste et consumériste, n’est pas compatible avec la préservation des écosystèmes vivables pour les humains ».
Cf. leur ouvrage : Comment bifurquer. Les principes de la planification écologique, Cédric Durand et Razmig Keucheyan, La Découverte/Zones, mars 2024.
C’est donc que le bien-être des travailleurs va de pair avec la préservation de la nature et de la planète tout entière. Qu’attendons-nous alors, au lieu de relever l’âge de la retraite ?
Pour aller plus loin…

« Il existe une banalisation des pratiques non conventionnelles de soin »

« Avant, 70 % des travailleurs géraient la Sécu. Aujourd’hui, c’est Bayrou. Voilà le problème »

L’atelier Missor dans le moule du combat civilisationnel