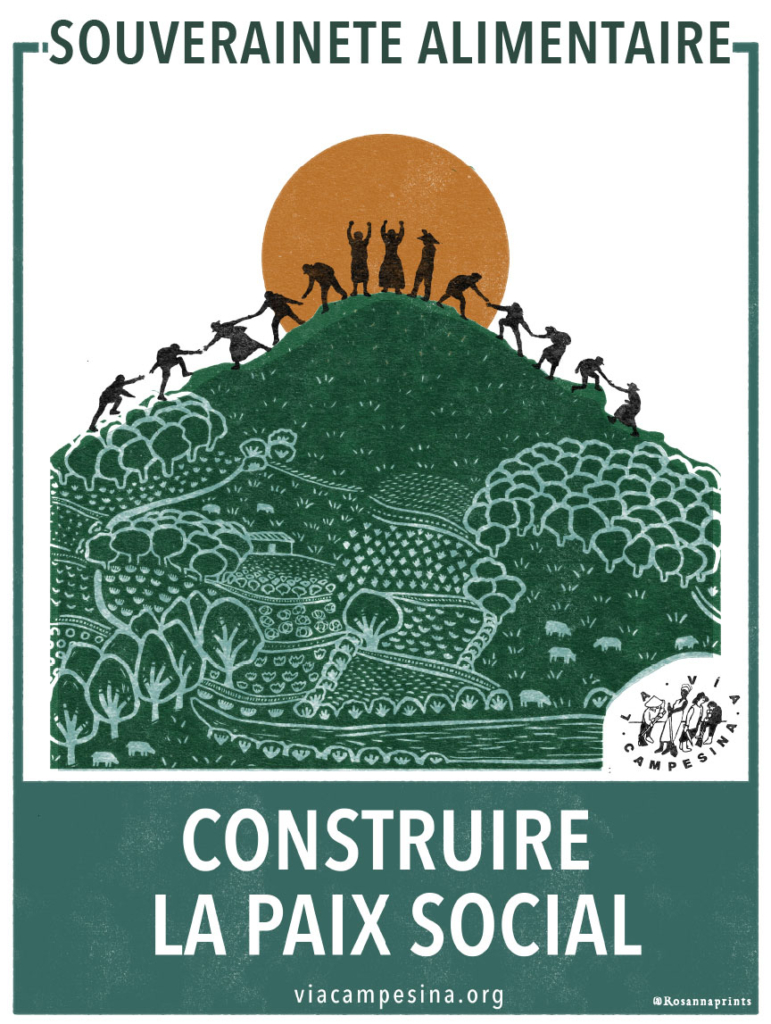Agrobusiness : quand la « faim » justifie les moyens
Le concept de souveraineté alimentaire semble être devenu une obsession pour la FNSEA et Emmanuel Macron. Mais il a été détourné de sa définition originelle, mise en avant par les altermondialistes, afin de prôner un modèle agricole exportateur et productiviste.
dans l’hebdo N° 1849 Acheter ce numéro

Dans le même dossier…
Pour Terre de liens, la souveraineté alimentaire est un « scandale made in France » François Purseigle : « La gauche paysanne doit toucher ceux qui ne partagent pas toutes ses revendications » Le Sénat au service de l’agriculture intensiveC’est une expression pleine de sens qui semble faire l’unanimité depuis quelques années et ne pas avoir d’aspérités politiques particulières : la souveraineté alimentaire. Or c’est tout le contraire. Il n’est pas inutile de rappeler que cette notion a été introduite par la Via Campesina (« La voix paysanne ») lors du Sommet mondial de l’alimentation à Rome en 1996. Pour ce mouvement international qui veut porter la voix de millions de paysan·nes, de travailleur·euses sans terre, d’autochtones et de travailleur·euses agricoles migrant·es du monde entier, impossible de penser souveraineté alimentaire sans (ré)affirmer les droits des peuples à l’autodétermination.
Sa définition est limpide : la souveraineté alimentaire est « le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite par des méthodes écologiquement respectueuses et durables, et leur droit à définir leurs propres systèmes alimentaires et agricoles […]. Des modes de production agroécologiques diversifiés, gérés par les paysan·nes et basés sur des siècles d’expérience et de preuves accumulées sont essentiels pour garantir une alimentation saine à chacun, tout en restant en harmonie avec la nature ».
Le principal aspect de la souveraineté alimentaire est de pouvoir décider démocratiquement des politiques alimentaires et agricoles.
M. Ody
Ce concept, issu de la sphère altermondialiste, était une alternative au concept dominant mais jugé trop restrictif de sécurité alimentaire, dans cette époque qui ouvrait grands les bras à la libéralisation des échanges et ne jurait que par le cadre imposé par l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
« La croyance selon laquelle la mondialisation de l’économie et la globalisation des échanges régleraient le problème de la faim dans le monde en baissant les prix de l’alimentation pour les pauvres était très forte. Mais cela ne prenait pas en compte le fait que la majorité des pauvres sont des petits producteurs, donc si on baisse les prix agricoles, on baisse leurs revenus, explique Morgan Ody, paysanne dans le Morbihan et coordinatrice générale de la Via Campesina. Le principal aspect de la souveraineté alimentaire est de pouvoir décider démocratiquement des politiques alimentaires et agricoles car cela a des impacts essentiels sur les identités culturelles, et ainsi discuter d’autres modèles agricoles. L’inverse de ce que fait le gouvernement français. »
La pandémie de covid-19 a ravivé la crainte de pénurie alimentaire. Dans son allocution du 12 mars 2020, Emmanuel Macron n’utilise pas le terme mais parle de la nécessité de « rebâtir une indépendance agricole », affirme que « déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner notre cadre de vie au fond à d’autres est une folie » et espère « une France, une Europe souveraine ». L’idée est là mais, sur le plan sémantique, ça tâtonne encore.
Dans les mois qui suivent, Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, parle de « souveraineté agricole », « agroalimentaire » et « alimentaire » à propos de la filière de betteraves sucrières et justifie ainsi les dérogations concernant les insecticides « tueurs d’abeilles » interdits, les néonicotinoïdes.
L’hypocrisie de l’agrobusiness
L’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 engendre une nouvelle passe d’armes sur le sujet, face à la hausse du prix du blé et l’affolement des marchés. En mai 2022, Marc Fesneau arrive au ministère fraîchement rebaptisé de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Le terme est devenu le thème du Salon de l’agriculture en 2024 avant d’être l’axe de réflexion pour le projet de loi tant attendu sur l’orientation agricole, censé répondre en grande partie aux inquiétudes des agriculteurs. L’article premier en discussion au Sénat a acté le principe de « non-régression de la souveraineté alimentaire » ainsi que des « conférences de la souveraineté alimentaire » pour que chaque filière fixe ses objectifs de production sur dix ans.
C’est la taille moyenne des 390 000 exploitations agricoles en 2020, contre 20 hectares en 1970 pour 1,5 million d’exploitations.
Une omniprésence de l’expression « souveraineté alimentaire », à la sauce néolibérale, qui pose de nombreuses questions. « C’était vraiment un terme de la critique, portant une vision très politique, antilibérale, axée sur les droits et la dénonciation des effets du commerce international, qui est désormais réutilisé par la FNSEA pour justifier la prétendue vocation exportatrice de la France et ne pas remettre en cause le modèle d’agriculture chimique industrielle, extrêmement dominant en France », décrypte Ève Fouilleux, directrice de recherches au CNRS en science politique, chercheuse associée au Cirad.
C’est bien l’exportation des produits qui est en fait la priorité.
È. Fouilleux
Le terme a donc été dévoyé par la FNSEA et le mythe des exportations nourricières du monde a perduré. L’ancienne présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, en usait énormément proposant même en 2020 un « Manifeste pour une souveraineté alimentaire solidaire », qui serait « ouvert et responsable, le contraire d’un repli sur soi ». Comprendre : ouverte à l’export.
« Ce phénomène est aussi lié à l’évolution des acteurs de l’agrobusiness car, il y a une vingtaine d’années, ils étaient tellement triomphants à l’exportation qu’ils ne voulaient surtout pas entendre parler de souveraineté alimentaire. Depuis quelques années, ils sont davantage dans une posture de protection. Mais l’hypocrisie de la FNSEA est de vouloir protéger ses produits tout en continuant d’exporter. Le Brésil a le même discours », complète Morgan Ody.
« Le terme de souveraineté alimentaire est brandi officiellement pour que les agriculteurs français puissent nourrir la population française. Or c’est bien l’exportation des produits qui est en fait la priorité. D’ailleurs, on exporte aussi beaucoup de choses qu’on importe, décrypte Ève Fouilleux. Mais globalement, si on regarde les chiffres de la production, on importe principalement des produits tropicaux et on est quasiment autosuffisants sur les principaux produits que les conditions pédoclimatiques françaises permettent de produire, sauf quelques exceptions comme la viande ovine ou, dans une certaine mesure, le beurre… On produit bien assez de céréales et de viande pour nourrir la France. »
Une analyse de France Agrimer (2023) sur la souveraineté alimentaire sur dix années s’appuie sur plusieurs indicateurs clés, notamment la « dépendance aux importations » et le « taux d’auto-approvisionnement » pour une trentaine de produits. Par exemple, pour le blé dur, la France est dépendante de l’exportation à 75 % alors que son taux d’auto-approvisionnement s’élève à 148 % ; pour le porc, elle dépend de l’exportation à 26 % et son taux d’auto-approvisionnement est de 103 %.
Pour Morgan Ody, la souveraineté alimentaire telle qu’elle la défend doit se construire à plusieurs échelles : territoriale, nationale, européenne et internationale. « Quand le commerce est bien pensé, il ne détruit pas les productions locales. Si l’Égypte souhaite importer du blé français, nous ne sommes pas contre, mais ce doit être son choix, pas une décision imposée, et dans un cadre où le prix sera rémunérateur pour les producteurs et acceptable pour les consommateurs, afin d’éviter la spéculation boursière », précise Morgan Ody, afin de rappeler que la Via Campesina n’est pas opposée à tout commerce extérieur mais l’envisage à égalité entre les pays.
C’est le nombre de Français qui dépendent de l’aide alimentaire, d’après une étude publiée par la Banque alimentaire. Un chiffre qui a triplé en dix ans.
Le mouvement altermondialiste planche justement sur un nouveau cadre de commerce fondé sur la souveraineté alimentaire autour de deux principes forts : le droit de tous les pays à mettre en place les politiques publiques de leur choix pour soutenir leur production locale (prix minimum d’intervention, régulation de l’offre, standards différenciés en fonction des choix des populations…) et la priorité donnée aux échanges commerciaux régionaux, moins néfastes pour l’environnement.
Des œillères libérales persistantes
Une souveraineté alimentaire saine et durable est-elle possible ? « L’autre raccourci d’une partie de la profession agricole consiste à dire que, pour nourrir la population française, il faut éviter les normes et contraintes sur le plan environnemental, en particulier les régulations sur les pesticides. Mais, quand on regarde dans quels secteurs sont utilisés les pesticides le plus intensément, on s’aperçoit que ce sont les céréales et la viticulture, principaux produits d’exportation français. Est-il judicieux de mettre ainsi en péril la qualité de notre eau, la santé de nos écosystèmes et celle de tous les Français juste pour exporter en masse des céréales pour l’alimentation animale dans le reste de l’Union européenne et en Chine ? En tout cas, c’est un choix politique», observe Ève Fouilleux.
Dans une tribune intitulée « Une vraie souveraineté alimentaire pour la France », Harold Levrel, professeur d’économie écologique à AgroParisTech et à l’université Paris-Saclay, affirme que « l’agriculture biologique pourrait être la garante de la future souveraineté alimentaire française, alors qu’elle est justement souvent présentée comme une menace pour cette dernière […]. Cette filière offre des garanties en matière de souveraineté alimentaire à court et long terme, permet de protéger l’eau et la santé des Français, est créatrice d’emplois en France. » Selon l’Agence BIO, 71 % du bio consommé dans l’Hexagone est d’origine France et le recul des imports bio, surtout composés de produits exotiques, méditerranéens ou nordiques, se confirme.
Un collectif de chercheurs et chercheuses de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) a mis en lumière quatre priorités d’action sous l’angle du rééquilibrage des choix alimentaires en vue d’« atteindre des systèmes alimentaires sains, durables et souverains ». Il faudrait d’abord réduire la consommation de produits ultra-transformés, qui représentent en moyenne 34 % des calories absorbées par l’adulte, diminuer la consommation de denrées animales, au profit des végétaux et enfin consommer davantage de produits de saison, afin de réduire les importations ou leur culture sous serre en France. Des pistes qui pourraient également permettre à l’État de réaliser des économies.
En novembre 2024, le Bureau d’analyse sociétale d’intérêt collectif (Basic), a publié une étude (1) originale et fouillée sur toute la structure du système agroalimentaire français. Selon ses calculs, le coût des impacts négatifs du système alimentaire français, pris en charge par les dépenses publiques, s’élevait en 2021 à 19,1 milliards d’euros, dont 82 % sont des coûts sanitaires et sociaux, alors que les coûts écologiques (gaspillage, pollution atmosphérique, pollution de l’eau, protection de la biodiversité, lutte contre le changement climatique) représentent 18 % du total.
(1) À la demande du Secours catholique, du réseau des Civam, de Solidarité paysans
et de la Fédération française des diabétiques.
Malheureusement, les œillères libérales et productivistes sont encore trop serrées pour prendre en considération les coûts sociétaux du système alimentaire et impulser une politique publique agroécologique ambitieuse et accessible à toutes et à tous.
Pour aller plus loin…

Face au fichage de « Frontières », les collaborateurs parlementaires exigent des mesures concrètes

À la Bourse du Travail à Paris, une journée pour dessiner une « sécurité sociale du logement »

La justice française refuse de livrer le militant antifasciste Gino à la Hongrie