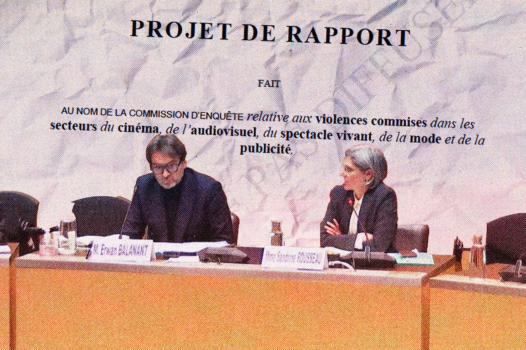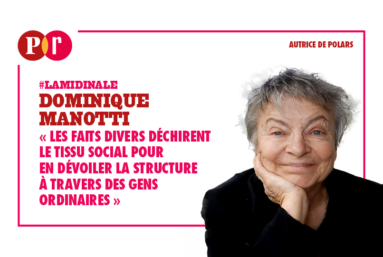Drogues : sortir de l’addiction et de la répression
Malgré des politiques toujours plus sévères contre le trafic et l’usage de stupéfiants, la consommation est en constante augmentation en France, avec son lot de violences. Une proposition de loi portée par la sénatrice écologiste Anne Souyris propose d’en finir avec la prohibition pour mettre l’accent sur la prévention et l’accompagnement des usagers.
dans l’hebdo N° 1848 Acheter ce numéro

Dans le même dossier…
Stupéfiants : « La prohibition est un échec total » Cannabis : quelles stratégies de prévention ?Un jeune racisé descend de son scooter immatriculé en banlieue et sort son portable. Il passe un bref coup de fil et retient le code de l’immeuble de centre-ville situé de l’autre côté de la rue, assez cossue. Il monte au deuxième étage. L’échange se fait sur le palier et il redescend par l’escalier en comptant une petite liasse de billets. Il s’éloigne vite sur son scooter, après avoir envoyé un SMS sur un réseau crypté : « C’est bon ! Je rentre. » La scène n’a duré qu’une poignée de minutes.
Le client n’est pas sorti sur le trottoir et inspecte le contenu du sachet dans son salon. Voici aujourd’hui le scénario classique d’une livraison « de détail » de stupéfiants. Le risque pour le client est quasi nul ; celui du livreur est très élevé, d’abord pour les infractions de détention, transport, offre, cession, etc. En espérant qu’il ne soit pas, en route, fouillé lors d’un contrôle d’identité.
Car il a, du fait de son origine présumée, selon les études du Défenseur des droits ou de l’Institut national d’études démographiques (Ined), « une probabilité 20 fois plus élevée d’être contrôlé que les autres personnes dans l’espace public ». Sachant qu’en cas d’interpellation il sera mis en garde à vue, déféré, poursuivi, souvent incarcéré en détention préventive, quand le client sortira en général quelques heures plus tard du fait de sa bonne intégration professionnelle et sociale, avec en général un simple rappel à la loi. La répression reflète donc souvent les discriminations sociales et raciales.
C’est exactement ce qui s’est produit pour le député La France insoumise (LFI) Andy Kerbrat en novembre dernier, alors qu’il achetait pour sa consommation personnelle, cette fois dans le métro à Paris, un gramme d’une amphétamine à un livreur, mineur racisé venu de banlieue. Plusieurs fonctionnaires de police ont passé de nombreuses heures sur cette « affaire » d’un seul gramme de stupéfiant, interrogeant longuement le livreur, tentant certainement de « remonter la filière ». En vain, comme souvent. Car le livreur sait qu’il risque des représailles, pour lui-même ou ses proches, s’il « balance ».
Oui, les flics viennent plus souvent, ils gênent un peu le business, mais ils ne gagneront jamais.
En outre, il sait généralement bien peu du « réseau » pour lequel il a accepté cette « course », souvent pour 10 ou 20 euros. Ce mode de deal par livraison, facilité par les téléphones portables, parfois qualifié non sans humour d’« Ubershit », est de plus en plus courant et difficile à réprimer. Un « chouf » marseillais, ou guetteur, interrogé anonymement sur France Info expliquait le 21 janvier : « Oui, les flics viennent plus souvent, ils gênent un peu le business, mais ils ne gagneront jamais. Il y a surtout plus de livraisons. »
Violence et corruption en hausse
Si la France a l’une des législations européennes parmi les plus sévères, elle se distingue surtout par une consommation de stupéfiants bien supérieure à celle de ses voisins. Près de la moitié des Français de 15 à 64 ans a déjà consommé du cannabis et on estime à cinq millions les fumeurs réguliers. Quant à la cocaïne, ses usagers étaient estimés à 600 000 en 2017, chiffre qui aurait bondi à 1,1 million en 2023 (1).
Chiffres issus des rapports annuels de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT).
On évalue aujourd’hui le chiffre d’affaires des trafics dans l’Hexagone entre 3,5 et 6 milliards d’euros par an, multiplié par trois depuis 2010. L’échec de la politique répressive, avec l’augmentation des peines encourues de réforme en réforme, parfois annuelle, depuis l’adoption de la loi du 31 décembre 1970 qui organisa le régime de prohibition, est donc patent. Mais ce sont aujourd’hui la violence et la corruption qui augmentent sans cesse. En 2024, on recensait 182 homicides ou tentatives d’homicides – dont 42 morts au cours des seuls six premiers mois de l’année. De 2016 à 2023, ces homicides et tentatives ont augmenté de 78 % !
Si Marseille est connue pour ses règlements de compte violents, le phénomène touche de plus en plus de villes moyennes comme Grenoble, Nîmes, Valence, Besançon, Dijon, Sevran, Bagnols-sur-Cèze, etc. Cette hausse de la violence ne semble pas près de s’arrêter. Et ce ne sont pas les coups de menton de Gérald Darmanin ou de Bruno Retailleau, ministres de la Justice et de l’Intérieur, soutenant toujours plus de répression (voir encadré ci-dessous), qui semblent pouvoir enrayer le phénomène.
Avec Gérald Darmanin et Bruno Retailleau, la Ve République n’a jamais connu un duo aussi droitier à la Justice et à l’Intérieur. Depuis que le gouvernement de François Bayrou s’est mis en place, les deux ministres regorgent d’idées toujours plus répressives, réactionnaires ou sécuritaires pour lutter contre le narcotrafic.
Le premier souhaite le regroupement des « cent plus gros » narcotrafiquants dans une seule prison d’ici à l’été 2025. Darmanin s’est d’ailleurs rendu à Rome le 3 février pour voir de plus près le centre pénitentiaire de Rebibbia, où une cinquantaine de détenus liés au crime organisé sont isolés et très strictement surveillés. Un régime de détention régulièrement dénoncé par les ONG. Le ministre de la Justice a également signé une circulaire sur la politique pénale appelant à plus de fermeté et érigeant la lutte contre la criminalité organisée et le narcotrafic en « priorité absolue ».
Le second imagine une France en voie de « mexicanisation », attaquée par des « narco-racailles ». Bruno Retailleau estimait il y a quelques semaines que « fumer un joint ou prendre un rail de coke, c’est avoir du sang sur les mains ». Il plaide désormais pour la création d’un « état-major » contre la criminalité organisée, placé sous la tutelle de la direction nationale de la police judiciaire.
Si les deux hommes se livrent en coulisses une lutte d’influence sur la proposition de loi sur le narcotrafic débattue au Parlement, ils partagent le même imaginaire de violences et la même rhétorique ultra-répressive. Darmanin et Retailleau se sont lancés dans une course à l’échalote. Une manœuvre claire : les deux veulent occuper le terrain de la droite et de l’extrême droite. Un big bang autoritaire au service de leurs ambitions respectives ? Les deux hommes rêvent de prendre le leadership de la droite en vue de la présidentielle de 2027. L’échéance n’est pas pour tout de suite mais leur brouhaha sécuritaire est, lui, déjà omniprésent.
Les très répressifs États-Unis, après plus de dix ans de prohibition de l’alcool durant les années 1920 jusqu’en 1933, avaient bien dû changer de politique, submergés par la corruption et la violence (à la Al Capone), et se décider à réguler l’usage et le commerce des spiritueux. Aujourd’hui, en France, près de 95 % des fonds publics vont à la répression. Le reste allant à la prévention et au soin. On le sait, c’est une impasse.
Le Portugal, un exemple à suivre
Alors, que faire ? En Europe, les législations évoluent. L’Allemagne permet depuis avril 2024 de posséder, de consommer et même de cultiver du cannabis pour sa consommation personnelle. Malte a autorisé la consommation récréative de cette drogue en 2021, suivie deux ans plus tard par le Luxembourg. Et le Portugal a eu le courage de rompre avec le tout-répressif. Après la chute de la dictature en 1974, le pays est resté très pauvre et la libéralisation de la société a entraîné une vague d’usages de drogues, surtout d’héroïne. Les pouvoirs publics ont dû réagir.
En 2001, le Portugal a dépénalisé l’usage de tous les stupéfiants, en mettant en avant les politiques de réduction des risques. Si un usager est contrôlé en possession d’une petite quantité d’un produit illicite, il peut se voir condamné à une faible amende et doit surtout passer devant une « Commission pour la dissuasion de la toxicodépendance ». Quant aux forces de police, elles se concentrent sur le crime organisé et le gros trafic tenu par les organisations mafieuses.
Cette politique est une réussite : la consommation a fortement diminué (avec pour l’héroïne une baisse de 60 % entre 2001 et 2021), moins de 10 % de jeunes Portugais·es sont usagers de drogues aujourd’hui ; le taux de mortalité liée aux drogues est quatre fois inférieur à la moyenne européenne et celui de nouvelles infections par le VIH a été divisé par 18 en onze ans. Enfin, le nombre de détenu·es pour infraction à la législation sur les stupéfiants a baissé de plus de moitié, décongestionnant le système carcéral du pays et libérant la police de la très chronophage chasse à l’usager.
L’objectif, c’est d’ouvrir le débat qui est focalisé sur une question : comment chasser le narcotrafic ?
A. Souyris
C’est du succès portugais que s’inspire une courageuse proposition de loi de la sénatrice écologiste Anne Souyris, ancienne maire adjointe de Paris à la Santé. « Pour lutter contre le narcotrafic, il y a deux piliers : un pilier sécuritaire et un pilier sanitaire, explique l’écolo. L’objectif, c’est d’ouvrir le débat qui est focalisé sur une question : comment chasser le narcotrafic ? » Son texte propose de maintenir la lutte contre le trafic de stupéfiants mais veut abroger les « dispositions pénalisant l’usage illicite de substances [amende ou peine de prison] », selon l’exposé des motifs.
À la place de la pénalisation, le texte propose une convocation devant une commission médico-sociale composée du directeur général d’une agence régionale de santé, d’un addictologue et d’un travailleur social. La proposition « hétérodoxe », selon un collaborateur écolo, concerne le cannabis, mais aussi la MDMA ou la cocaïne.
À gauche, deux voies divergentes
À l’Assemblée, un insoumis travaille depuis des mois sur le sujet. Antoine Léaument, corapporteur d’une mission d’information visant à « évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants », tente d’imaginer des pistes alternatives « efficaces » pour combattre le narcotrafic car, selon lui, il « semble pour l’instant impossible de réfléchir autrement qu’avec le tout-répressif dans le débat public ».
Le député de l’Essonne espère, avec la publication mi-février de ce rapport (pour lequel 90 auditions ont été réalisées) listant ses recommandations et celles de Ludovic Mendes, corapporteur Ensemble pour la République (EPR), un « recentrage » du débat autour de la prévention, des causes sociales, de la question internationale et de la corruption.
Ce n’est pas qu’un enjeu sécuritaire.
A. Léaument
Parmi les constats du député : la faible participation de la France à l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) ; la non-formation des agents pour lutter contre le blanchiment ; le manque de moyens alloués à la justice et à la police judiciaire ; l’oubli de la question de la traite des êtres humains… L’idée est de mettre sur la table des sujets qui ne sont jamais abordés, comme la légalisation du cannabis, la police de proximité supprimée par Nicolas Sarkozy ou l’entrée dans la délinquance. « En dehors des grandes opérations de communication comme ‘Place nette’, le débat posé par Bruno Retailleau est en réalité très pauvre », dénonce Antoine Léaument.
Alors que la classe politique est focalisée sur la répression, la gauche tente de revoir le mode de pensée de la lutte contre le narcotrafic : « C’est aussi prendre en compte des enjeux sociaux. Soutenir les familles en difficulté, renforcer l’école et les structures sociales… Ce n’est pas qu’un enjeu sécuritaire », juge le député insoumis. Mais, en dehors de ces initiatives, la gauche se retrouve face à un dilemme. Comment sortir du procès en laxisme tout en refusant de reprendre le discours répressif cher à la droite et à l’extrême droite ?
Face à cette interrogation, plusieurs figures de gauche n’hésitent plus à piquer les mots et les idées de la droite. « C’est un mouvement d’ensemble que nous devons conduire face à ce phénomène qui fragilise la société », affirmait Michael Delafosse le 27 janvier sur France Inter. Le maire socialiste de Montpellier est notamment favorable à ce que les maires aient la possibilité d’autoriser ou non l’ouverture de commerces et assume l’expulsion de locataires de logements sociaux s’ils « pratiquent du deal ».
La proposition de loi sur le narcotrafic portée par le socialiste Jérôme Durain et le républicain Étienne Blanc, issue d’une commission d’enquête sénatoriale de longue durée, ne risque pas de sortir la France de la pensée prohibitionniste. Car le texte propose de mettre en place un arsenal très dur : création d’un parquet national anticriminalité organisée, alors qu’une juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée existe déjà, renforcement de l’Office anti-stupéfiants (Ofast) pour en faire une « DEA [Drug Enforcement Administration, N.D.L.R.] à la française », mise en place d’un « dossier coffre » empêchant à la défense de connaître les techniques d’enquêtes policières, restriction des nullités de procédure…
Au sein de la gauche sénatoriale, le texte ne crée pas de vagues. À l’Assemblée, qu’en sera-t-il ? « Il y a des différences entre les socialistes au Sénat et à l’Assemblée, croit un député insoumis. Tous les membres du Nouveau Front populaire sont d’accord en commission des lois. » Mais, en attendant, des alternatives politiques peinent à exister.
Pour aller plus loin…

À la Bourse du Travail à Paris, une journée pour dessiner une « sécurité sociale du logement »

La justice française refuse de livrer le militant antifasciste Gino à la Hongrie

Julie Couturier : « Attaquer l’État de droit, c’est attaquer la démocratie »