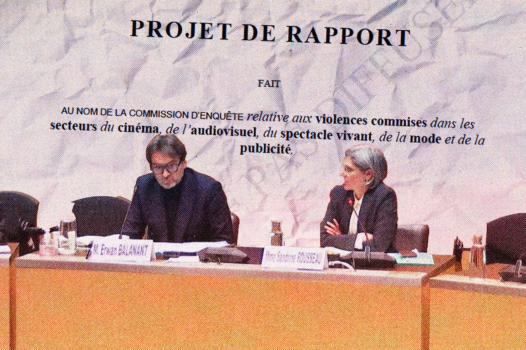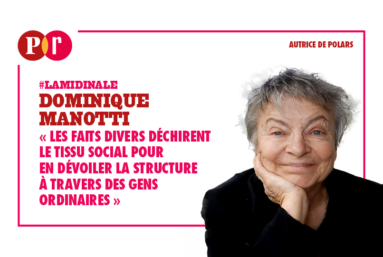François Hartog : « On est entrés à nouveau dans un monde où le droit n’existe plus, sinon le droit du plus fort »
L’historien émérite à l’EHESS observe dans un ouvrage érudit, Départager l’humanité, comment, de l’Antiquité à nos jours, l’homme a pu autant basculer dans l’inhumain.
dans l’hebdo N° 1848 Acheter ce numéro

© Maxime Sirvins
Départager l’humanité. Humains, humanismes, inhumains, François Hartog, Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires », 350 pages, 22,50 euros. Après Chronos. L’Occident aux prises avec le temps (paru en 2020 et réédité en Folio avec une préface inédite), l’historien poursuit ses interrogations sur l’évolution de notre rapport au temps, mais aussi sur le partage entre l’humain et l’inhumain, depuis l’anthropos grec jusqu’au XXe siècle, où l’homo inhumanus fut capable des pires horreurs.
Né en 1946, agrégé et docteur en histoire, helléniste formé notamment par Jean-Pierre Vernant, François Hartog a beaucoup travaillé sur l’évolution des expériences et approches du passé, du présent et du futur au fil des époques. Ce qu’il a désigné par le terme de « régimes d’historicité », complété par le concept de « présentisme », désignant la forme contemporaine de notre rapport au temps. Chercheur mondialement reconnu, il mène à la fois un travail d’historien et une recherche sur les formes d’écriture de l’histoire elle-même, en étudiant notre conception évolutive du temps selon les périodes.
Pourquoi vouloir départager – ou partager – l’humanité. Quel est l’objet de votre ouvrage ?
François Hartog : Partager est un verbe qui a plusieurs sens. C’est, d’un côté, trancher, séparer, donner à chacun sa part, son rang, sa place. Mais c’est aussi, de l’autre, partager quelque chose avec quelqu’un. Il y a ces deux possibilités contenues dans le mot lui-même. Si j’ai souhaité parler surtout du partage au sens de séparer, il y a quand même une présence à l’arrière-plan de l’autre signification, sur laquelle je n’ai pas centré mon propos. Parce que ma question était celle des figures de l’humain à travers les siècles, qui est un sujet à peu près sans fin.
Il me fallait donc essayer de choisir, et de suivre si possible, un fil directeur qui, justement, serait celui de ces gestes eux-mêmes de partage. Et des façons dont ils ont été repris, réinterprétés, transformés, voire critiqués ou récusés. C’est-à-dire de donner une perspective, ou une limite, puisqu’il ne s’agissait pas, comme je le dis au début, de faire un traité métaphysique – ce n’est pas mon métier – s’interrogeant sur « qu’est-ce que l’homme ? » Ceci étant indiqué, j’ai voulu m’en tenir aux « partages fondamentaux », ou les premiers partages, qui sont finalement ceux entre humains, Dieu et animaux.
Avez-vous aussi voulu, vous qui êtes historien, écrire un livre de philosophie, voire d’ontologie ?
Non, ce n’est pas un livre de philosophie, mais c’est un livre qui s’essaie à faire une espèce de philosophie historique, si les philosophes admettent que l’on puisse travailler ainsi. Je fais appel à toute une série de textes, dont un certain nombre sont des textes de philosophie, auxquels je ne pose pas de questions philosophiques proprement dites, mais de philosophie historique, ou plutôt, pour employer un terme un peu savant, de sémantique historique, c’est-à-dire ce que j’appelle l’histoire conceptuelle.
Trump affirme peut-être moins la volonté de départager l’humanité que désormais l’Amérique.
Plus loin de la philosophie historique, nous sommes au lendemain du discours d’investiture de Donald Trump à la Maison blanche. Diriez-vous qu’il vous a semblé exprimer une volonté de « départager l’humanité » ?
Votre question renvoie un peu à ce je dis à la fin du livre. Je dirais qu’il affirme peut-être moins la volonté de départager l’humanité que désormais l’Amérique, puisque le grand partage qu’il veut exprimer est plutôt entre l’Amérique (ou plutôt les États-Unis) et les autres. Entre « America first, first, first » et le reste du monde. Il y a bien là un vrai partage. Mais, après, il a aussi dit ceci : que l’on soit blanc, noir, jaune ou autre, tout le monde devait être à égalité (pour les Américains évidemment). Qu’en est-il ensuite dans l’effectivité des choses ? C’est un autre problème !
Mais il n’y a pas de perspective, dans ce discours, ouvertement raciste, me semble-t-il. Il y a, certes, une perspective nationaliste, chauvine, qui voudrait que tous les illégaux soient des criminels, sans savoir où les mettre dans l’humanité. Mais ils ne sont pas américains : le grand partage est là ! Les Noirs et les Hispaniques qui ont la nationalité états-unienne sont états-uniens. On ne se préoccupe pas de comment ils le sont devenus, ni comment d’autres pourraient le devenir.
Dans le chapitre VI de l’ouvrage, vous abordez ce que vous nommez « l’époque de l’homo inhumanus », marquée par les camps (nazis, goulag, etc.) Le « partage » ne devient-il pas alors irrémédiable, en frappant également les bourreaux ?
Bien sûr, il ne faut pas considérer que l’homo inhumanus n’est réservé qu’au XXe siècle. Même si le siècle dernier a été, si je puis dire, particulièrement « brillant » en la matière. Il faut bien considérer qu’en Europe, car c’est quand même l’Europe qui est concernée la première, cela commence en 1914, avec ce qu’on a appelé la « brutalisation des sociétés » et une violence devenue quasiment ordinaire. Cela va durer jusqu’en 1945 – même si cela ne signifie pas que cela ne se poursuit pas ensuite – comme un grand moment de paroxysme de l’inhumanité, qui va passer à travers des institutions que sont surtout les camps et qui vont être une rationalisation de l’inhumanisation.
La question que je pose, à travers les témoins que je convoque (en premier lieu Primo Levi, Varlam Chalamov ou Vassili Grossman), peut s’énoncer ainsi : est-il possible de rester humain dans un monde inhumain ? Il y a chez ces trois-là (et bien d’autres qu’eux) cette idée que le simple fait de demeurer face aux bourreaux revient à maintenir son humanité et, en même temps, à faire entrer le bourreau dans sa propre inhumanité. C’est, je crois, ce mouvement-là qu’il est capital de saisir.
Comment expliquer que certains continuent dans le processus de déshumanisation, à l’instar des Trump, Poutine, Netanyahou, ou Orban, Meloni ? Alors que 1945 est déjà bien loin de nous…
1945 a été ce moment où l’on a voulu faire quelque chose, où l’on a plus ou moins pris conscience de ce qui s’était passé. On a voulu juger l’inhumain (aux procès de Nuremberg et dans une certaine mesure de Tokyo) et faire en sorte que l’inhumain soit banni, avec la création des institutions internationales des Nations unies puis la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948. C’était une espèce d’utopie qui avait quand même comme effet que, pour la première fois, l’humanité, ou ce qu’on appelait alors « la famille humaine », devenait un sujet de droit.
Cela a été quelque chose d’important, marqué d’abord par la reconnaissance du crime contre l’humanité puis celle, en 1948, du génocide. Comme une conséquence de ce qu’on pourrait appeler le « festival d’inhumanités » qui avait débuté en 1914 et culminé dans l’horreur dans les années 1940. Il est certain qu’on s’en est peu à peu éloigné. Avec Trump, c’est encore plus évident – même si je ne dis pas que Trump installera des camps. On est entrés à nouveau dans un monde où le droit n’existe plus, sinon le droit du plus fort. À partir de là, tous ces comportements dits « décomplexés » deviennent légitimes – du moins aux yeux de ceux qui les pratiquent !
Il y a eu certes nombre de crimes de masse, sinon de génocides, depuis 1945, ne serait-ce que ceux au Rwanda ou au Cambodge. Mais ce que l’on constate depuis 1945, c’est que cet ordre est de plus en plus contesté, puisqu’il est contesté comme étant « occidental ». Tous les potentats se sont donc précipités dans cette voie pour dénoncer ce partage inégal. Non pour en établir un autre qui serait plus égalitaire, ce n’est évidemment pas du tout leur objectif. Mais bien pour le démolir. Et l’un des démolisseurs en chef aujourd’hui, c’est Poutine. Mais cet ordre s’est trouvé aussi contesté de l’intérieur, de l’Occident, du monde occidental. C’est là qu’interviennent toutes ces mises en question, que j’évoque à la fin du livre, d’un propre de l’homme.
Ce qui me paraît le plus frappant, c’est la désorientation dans laquelle nous sommes.
Pour des raisons qui sont internes à diverses disciplines ou réflexions, comme l’anthropologie, la paléontologie, les sciences cognitives, la biologie, qui se sont développées depuis une cinquantaine d’années, cette mise en cause d’un propre de l’homme retentit forcément sur ce qui avait été instauré au nom d’un propre de l’homme dans les années 1945 et 1950. Sans vouloir rompre avec tout cela, ces potentats se servent d’une vision qu’ils ont fabriquée de l’Occident – lieu de décadence généralisée, où tout le monde serait homosexuel, transgenre ou que sais-je encore – pour dire qu’il faut en finir avec ce monde-là.
Vous écrivez en somme que l’homo humanus semble avoir fait son temps. Seriez-vous en proie à une certaine dépression vis-à-vis de l’homme ?
Ce n’est pas ainsi que je dirais les choses. Je vois, je constate, j’observe ces phénomènes. Et je ne peux pas dire que c’est particulièrement roboratif ! Mais j’essaie aussi de prendre quelques distances et, vu mon âge, comme je ne dois pas être très loin de la fin, je ne veux pas dire que le monde s’arrête avec moi. En aucune manière. Si j’ignore ce qui se passera dans les vingt-cinq prochaines années, je ne me mets pas, dans ce livre, dans la position de dire que le monde va s’arrêter avec moi. Cependant, face au changement climatique, à tout ce qui relève de l’anthropocène, à ces phénomènes auxquels on ne s’attendait pas, on se trouve aujourd’hui en pleine incertitude, dans une vraie ignorance, face à une conjonction de choses, de conflits, sur divers plans et qu’on ne sait pas maîtriser. Ce qui me paraît le plus frappant, c’est la désorientation dans laquelle nous sommes.
Lorsque vous travailliez avec Jean-Pierre Vernant (1) sur l’homme dans la Grèce antique, vous aviez eu l’intuition qu’en échangeant avec lui sur l’homme grec et sur la « belle mort » des héros de l’Illiade, celle des héros au combat, il parlait aussi en creux de la Résistance et des Résistants. Vous sembliez encore croire en l’homme, cet homo humanus. Cette croyance s’est-elle amenuisée aujourd’hui ? Ce livre exprime-t-il une diminution de cette croyance, ou de cette volonté de croyance ?
Professeur au Collège de France, historien, anthropologue et grand spécialiste de la Grèce antique, Jean-Pierre Vernant fut un résistant de la première heure, jusqu’à diriger comme colonel des FFI la libération de Toulouse à l’été 1944. Il raconte dans ses Mémoires que François Hartog lui demanda si, lorsqu’ils travaillaient sur la « belle mort » des héros de l’Illiade, cela ne le renvoyait pas à son expérience de la lutte armée contre l’occupant nazi. Surpris, après un temps d’arrêt, il en convint. Cf. La Traversée des frontières. Entre mythe et politique (T. II),Seuil, coll. « La Librairie du XXe siècle », 2004, p. 19.
Comme vous l’avez constaté, le livre a un épilogue. Je ne l’ai pas appelé « conclusion », je n’ai pas voulu écrire une conclusion proprement dite. J’ai été frappé du fait que, dans les années 1970, il y avait d’un côté tout un mouvement de pensée, de recherches, de réflexions, qui avaient au fond comme dénominateur commun qu’il n’y avait pas de « propre de l’homme » ; de l’autre, exactement à la même période, concomitamment, on assiste à l’émergence des « humanitaires », qui sont ces jeunes médecins urgentistes de Médecins sans frontière et qui disent au contraire qu’il faut intervenir, auprès des victimes, quelles qu’elles soient, au nom justement de la dignité de l’humain. Sans faire non plus de traité de métaphysique sur l’homme !
Mais il y a là l’affirmation d’un « propre de l’humain ». Et d’une dignité qu’on ne saurait ignorer, qu’il faut préserver, sans doute à tout prix. Je crois que cette affirmation, face à la violence des temps présents, ne saurait être balayée d’un revers de main. Et je veux croire que l’humanisme, ou les humanismes, indique des voies pour être toujours plus humain. Même si l’inhumain, ou homo inhumanus, semble, du Donbass à Kaboul, de Khartoum à Gaza, avoir encore de beaux jours devant lui.
Vous commencez ce livre par un chapitre sur l’homme grec antique. Or vous le terminez en poursuivant vos réflexions sur l’homme, autour des manifestations actuelles de son inhumanité, comme en Ukraine ou à Gaza. Au vu de vos retours fidèles à cet homme grec, avons-nous finalement si peu appris depuis Socrate, Platon, Hérodote ou Aristote ?
Je crois qu’il faut se demander d’où vient cet homme grec. Sans doute d’une réponse à donner au scandale de la mort. Au fait que les hommes sont mortels. À partir de là, s’est constituée toute une anthropologie. Mais dans un univers polythéiste, où les dieux existent et sont présents au quotidien. Aussi, pour penser cette mortalité, on pose le fait qu’il y a des dieux immortels, des êtres immortels. On pense donc la mortalité à partir de l’immortalité d’autres êtres. Se crée alors une anthropologie dont Hésiode est le grand ordonnateur.
Pour aller plus loin…

À la Bourse du Travail à Paris, une journée pour dessiner une « sécurité sociale du logement »

La justice française refuse de livrer le militant antifasciste Gino à la Hongrie

Julie Couturier : « Attaquer l’État de droit, c’est attaquer la démocratie »