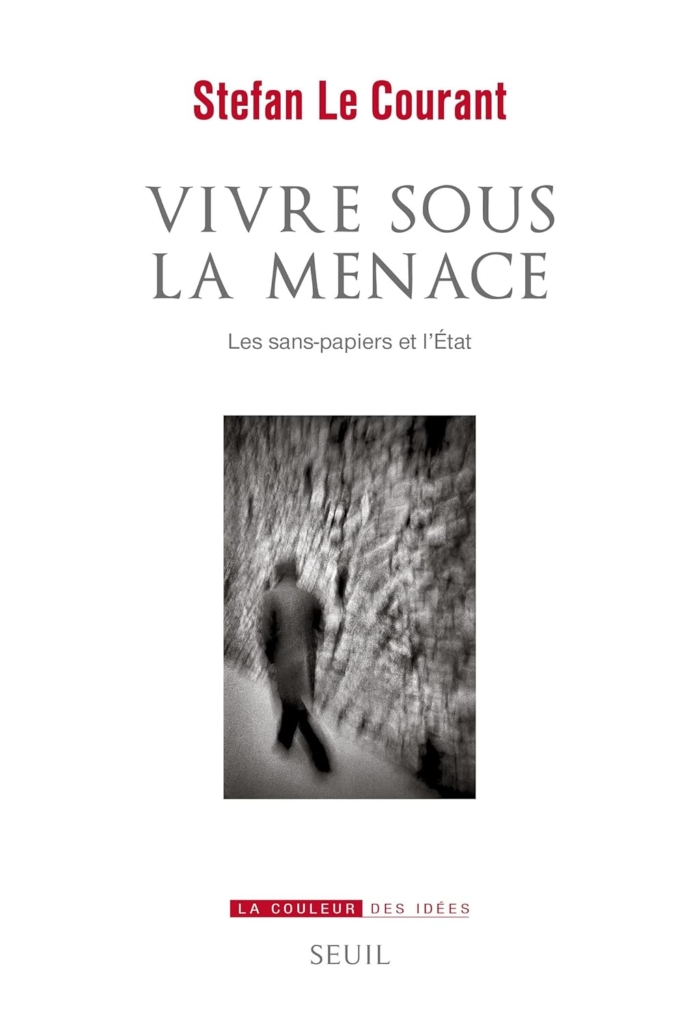Stefan Le Courant raconte les vies empêchées des sans-papiers
« Avec la menace de l’expulsion, explique l’anthropologue, toute une partie de la population est contrôlée dans ses mouvements, ses aspirations, ses possibilités de vivre la vie comme elle l’entend. » Entretien.

© Emmanuel Dunand / AFP
Dans le même dossier…
Rétention administrative : la gauche cherche sa voie « Qu’est-ce que cet acharnement à vouloir expulser des gens à tout prix ? » La vie en suspens d’Abdi, sous OQTF pour « menace à l’ordre public », 15 ans après les faits En centre de rétention, des conditions « pires que la prison »Les discours racistes sur l’immigration prolifèrent et les idées d’extrême droite sont aujourd’hui portées par une large partie du spectre politique. Au-delà des discours, les politiques menées par l’État en matière d’immigration ont un effet concret sur le quotidien des personnes sans papiers. Pour les étrangers, dont les possibilités d’accéder à un statut régulier sont restreintes par les lois et circulaires successives, la menace de la dénonciation ou l’arrestation structure le quotidien.
Vivre sous la menace : L’État et les sans-papiers, Stefan Le Courant, collection La Couleur des idées, Seuil, 368 pages.
La menace est ainsi une politique de gouvernement en soi, qui a des effets concrets sur la liberté de mouvement et d’être au monde. Cette menace renforce également les rapports de domination et de pouvoir pouvant exister dans des sphères a priori non étatiques, comme le travail ou les relations amoureuses. Ce sont toutes ces questions qu’aborde Stefan Le Courant, anthropologue, dans son ouvrage Vivre sous la menace : L’État et les sans-papiers (Seuil. 2022), écrit à l’issue d’une enquête de plusieurs années durant lesquelles il a suivi une quarantaine de personnes sans papiers. Interview.
En introduction de votre ouvrage, vous expliquez que la figure du « clandestin » a remplacé celle de « l’irrégulier ». En janvier, dans son discours de politique générale, le premier ministre François Bayrou a utilisé le terme « d’illégaux ». Que traduisent ces changements sémantiques ?
Stefan Le Courant : À une époque où la main d’œuvre immigrée était bienvenue, un irrégulier était une personne qui potentiellement serait régularisée très rapidement. Avec le durcissement successif des lois au début des années 70, puis dans les années 80-90, les personnes ont été écartées de la légalité de séjour plus longtemps et se sont installées dans une forme de vie irrégulière. Le terme de clandestin vient appuyer cette volonté politique non seulement de les faire repartir dans leur pays d’origine, mais charrie aussi tout un vocabulaire de criminalisation. Ce terme renvoie à l’idée que les personnes se tiendraient sciemment en marge de la régularité et en tireraient profit.
Le mot « clandestin » inverse la charge de la responsabilité.
On voit très bien quand on fait du terrain que ces personnes passent leur temps à essayer de régulariser leur situation. Ce n’est pas du tout une volonté de leur part de rester en dehors du cadre légal. Le mot « clandestin » inverse la charge de la responsabilité. Ce serait la personne elle-même qui serait responsable de sa situation. Alors que le mot sans-papier insiste bien sur le rapport des individus à l’État et sur la possibilité qui leur est donnée ou non d’accéder à un statut légal.
Vous avez accompagné et suivi sur plusieurs années une quarantaine de personnes sans papiers, pour la plupart rencontrées en rétention, et avez observé que la menace de l’arrestation s’exerçait bien au-delà de ce lieu d’enfermement. Quel était le sens de votre démarche ?
Au départ, je m’intéressais à la question des enfermements et des formes de politisation, de résistance, d’opposition aux expulsions qui pouvaient naître de la part des étrangers eux-mêmes depuis les centres de rétention. Au fur et à mesure, le terrain s’est de plus en plus éloigné de la rétention. La majeure partie de l’enquête, finalement, s’est faite à l’extérieur. Et ce qui m’a semblé assez notable en suivant le quotidien des personnes qui avaient été enfermées et qui ensuite sont retournées sur le territoire français, c’était la menace de constamment pouvoir faire l’objet d’une arrestation. Je voulais comprendre concrètement ce que cette expulsabilité, le fait que l’expulsion est constamment une possibilité, faisait au quotidien.
Ayant l’idée que le fait d’être arrêté est toujours possible, elles se demandent à quel moment peut avoir lieu l’arrestation ou qui peut en être l’auteur. J’ai essayé de montrer que ce rapport au monde peut être très différencié d’une personne à une autre. Pour certains, tout devient signe de danger. Est-ce que derrière un simple passant, il y a un policier en civil qui se cacherait ? Est-ce qu’un ami ne finira pas par vous dénoncer dans le futur ? Qui va trahir, dévoiler une situation ? Ou plus simplement : que feront les gens quand ils sauront ? Est-ce qu’un patron qui sait que je suis sans-papiers ne va pas abuser de moi ? Tout peut devenir source d’inquiétude et d’interrogation, alors que pour d’autres, il y a une possibilité de mettre ça à distance et de quand même avoir des espaces de confiance.
Ce qui fait la différence dans la vie quotidienne des personnes en situation irrégulière, c’est le fait de bénéficier de conseils de l’entourage ou d’être livré à soi-même.
D’un point de vue géographique, on peut très souvent dire que les endroits perçus comme dangereux sont les espaces publics où les contrôles d’identité sont possibles. Mais il y a toujours des situations où finalement, la menace vient s’immiscer là on ne s’y attendait pas, et qui rappellent qu’il n’y a pas beaucoup d’espaces de réelle sécurité. Un de mes interlocuteurs avait découvert un jour par hasard que dans son foyer de travailleurs migrants vivait un policier.
Vous expliquez qu’au-delà de l’exclusion légale un des effets des politiques migratoires est une exclusion spatiale, les personnes adoptant des stratégies pour ne pas être arrêtées par la police. Comment ces politiques affectent-elles la liberté de circuler dans la vie de tous les jours ?
C’est très variable d’une personne à l’autre. Ce qui fait la différence dans la vie quotidienne des personnes en situation irrégulière, c’est le fait de bénéficier de conseils de l’entourage ou d’être livré à soi-même. Ceux qui reçoivent des conseils de leurs proches, on leur dit d’éviter certains espaces, de toujours prendre leur ticket quand ils se déplacent, d’éviter les endroits où la police est souvent présente. Ça veut dire que le chemin le plus court n’est pas souvent le chemin qu’on emploie quand on est en situation irrégulière. C’est le cas de toute personne qui se sent en danger ou qui vit en ayant l’impression qu’il y a un danger quelque part et qui va contourner ces espaces de danger.
La police, suite à une réquisition du procureur, peut être amenée à contrôler certaines zones dans le but d’interpeller des personnes en situation irrégulière, par exemple aux sorties de métro et RER. Mais, plus généralement, les personnes auprès de qui j’ai enquêté se savent être la cible des contrôles de police. L’enjeu est de tout faire pour se défaire d’un stigmate d’apparence qui pourrait les identifier à des sans-papiers. Il y a des stratégies à la fois sur la manière de se présenter, mais aussi dans la manière d’agir : essayer de ne pas montrer qu’on a peur, s’habiller d’une certaine façon.
Si la rétention n’aboutit pas à ce à quoi elle est censée aboutir, c’est-à-dire l’expulsion, il n’en demeure pas moins que ses effets sont très concrets dans la vie des gens.
Ils savent aussi qu’ils sont repérés parce que « noirs » ou « arabes ». Dans ce cas certains vont au contraire s’exposer en comptant sur le fait que la police n’osera pas les interpeller de peur de voir révélés les motifs discriminatoires de l’arrestation. Erving Goffman a défini cela comme le « problème circulaire du dissimulateur ». Il faut à la fois tout observer, tout voir à l’avance, en donnant l’impression qu’on ne fait attention à rien et qu’on est extrêmement détendu. Ces compétences se répartissent de manière très inégale entre les personnes que j’ai pu rencontrer.
Quel rapport à l’État construit cette menace constante ?
C’est un rapport très ambigu. À la fois l’État est menaçant car il rappelle très régulièrement à travers des discours politiques qui se multiplient, que ces personnes sont potentiellement arrêtables et expulsables. Et en même temps, c’est auprès de ce même État qu’elles doivent demander la régularisation. On attend la protection de la même entité qui nous menace. Pour certain, jusque dans la préfecture, ils ne savent pas à quelle face de l’État ils vont avoir affaire : la face protectrice qui peut vous permettre d’être régularisé ou la phase répressive qui peut vous arrêter et vous expulser.
Une des personnes dont vous racontez l’histoire dans le livre finit en rétention après avoir été convoquée au commissariat pour son mariage…
Tout à fait. C’est une personne qui avait été convoquée au commissariat de police dans le cadre d’une enquête préalable à son mariage. Il savait que c’était un mariage tout à fait dans les règles et non pas un mariage blanc. Il s’y est rendu sans aucune appréhension avec son passeport qu’on lui avait demandé. Sur place, il a été arrêté. Deux jours après, il m’appelait, il était à Alger. Parce que la préfecture avait déjà son passeport il n’y avait plus aucune entrave à son expulsion. Très souvent, c’est le document de voyage manquant qui fait que les gens ne sont pas expulsés.
Vous décrivez dans votre travail le fait que la menace est un instrument de gouvernement et un des mécanismes du pouvoir de l’État. Qu’est-ce que vous entendez concrètement par-là ?
Si on regarde les chiffres, moins d’un étranger sur deux en rétention aujourd’hui est expulsé, à l’exception de ce qui se passe à Mayotte. Face à ce constat, il y a plusieurs positions critiques. Une position politique consistant à rejeter le fait même d’expulser des gens. Une position pragmatique : « Ça ne fonctionne pas, il faut changer cette politique. » Ou une position économique : « Ça coûte extrêmement cher pour très peu de résultats, il faut penser à la réformer. »
En tant qu’anthropologue, je me suis demandé ce qu’on pouvait dire de plus. Et j’ai voulu montrer justement, que si la rétention n’aboutit pas à ce à quoi elle est censée aboutir, c’est-à-dire l’expulsion, il n’en demeure pas moins que ses effets sont très concrets dans la vie des gens. Quand on est arrêté, qu’on perd son travail, qu’on perd son logement, eh bien « on recommence à zéro ». C’est une expression qui revenait beaucoup dans la bouche de mes interlocuteurs. Concrètement, toute une partie de la population est contrôlée par cette menace qui pèse sur la tête. Contrôlée dans ses mouvements, contrôlée dans ses aspirations, contrôlée dans ses possibilités de vivre la vie comme elle l’entend. À défaut de pouvoir réellement expulser, la menace est présente sur le territoire.
Un des effets de la menace est d’enfermer des personnes dans une temporalité statique.
C’est comme s’il y avait des frontières intérieures au sein de l’espace européen qui contiennent un certain nombre de personnes et qui les empêchent à la fois de se déplacer concrètement, physiquement, mais aussi plus largement de prendre une véritable place dans l’espace, dans la société dans laquelle ils sont arrivés. Et c’est là, à mon sens, que la question de la frontière prend une dimension temporelle qui s’ajoute à la dimension géographique.
Car un des effets de la menace est d’enfermer des personnes dans une temporalité statique. C’est-à-dire que quand vous arrivez, vous savez que pendant un certain nombre d’années, vous ne pourrez pas avoir accès aux mêmes droits que les autres. Les dernières réformes, pour citer la circulaire Retailleau qui pousse à sept ans le nombre d’années sur le territoire avant de pouvoir demander un titre de séjour, ne font que renforcer ces effets-là.
Dans Le Monde, François Héran montrait que cette circulaire aurait un effet extrêmement marginal sur la régularisation et sur la présence de personnes étrangères sur le territoire. Ce sont donc des réformes qui ont des effets sur les personnes qu’elles visent, mais dont les résultats prétendus seront très limités. Cette circulaire ne fait que renforcer l’injonction paradoxale faite aux sans-papiers : celle de mener la vie la plus normale possible (travailler, avoir des fiches de paie, etc.) dans un contexte où tout est fait pour rendre leurs existences impossibles. Désormais ils vont en plus devoir échapper aux contrôles policiers puisque les OQTF, même anciennes, empêcheront les régularisations.
En quoi les catégories administratives créées par l’État à l’égard des personnes sans-papiers instaurent des relations de pouvoir, bien au-delà du seul contrôle policier ?
Il y a de plus en plus d’espaces sociaux, d’institutions sociales à qui on demande de participer à la politique migratoire, en leur disant qu’il faut dénoncer les sans-papiers, qu’il ne faut pas les accepter. France Travail, par exemple. À un moment, il a aussi été question que les hôpitaux dénoncent auprès des préfectures les personnes en situation irrégulière. Ça élargit l’espace du contrôle policier, puisque les personnes sans-papiers sont contrôlées à travers toutes ces différentes institutions.
Il m’arrivait parfois de voir, au local de rétention administrative de Choisy-le-Roi, des hommes qui avaient été arrêtés suite à une dénonciation par leur conjointe après une dispute.
En fait, ces catégories administratives créent des rapports de domination même dans des sphères non étatiques. Par exemple, au travail, il faut être capable de présenter un titre de séjour permettant de travailler. Il faut donc trouver des intermédiaires prêts à prêter un titre de séjour ou une carte d’identité française qui permet de travailler, ce qui peut mettre dans une situation de dépendance. Ça impacte aussi les relations amoureuses. Il m’arrivait parfois de voir, au local de rétention administrative de Choisy-le-Roi, des hommes qui avaient été arrêtés suite à une dénonciation par leur conjointe après une dispute.
Ce sont des moments où certaines personnes ou institutions peuvent se saisir de l’irrégularité à leur avantage, et cette possibilité peut constituer une menace pour les personnes sans papiers. Dans tous ces espaces-là où on pourrait penser que l’État n’est pas présent, ce sont pourtant des catégories administratives qui créent des rapports de domination, des rapports de pouvoir qui n’existeraient pas sous cette forme-là.
Il y a dans la loi ce concept flou de « menace à l’ordre public », qui est utilisé notamment par les préfectures pour justifier les OQTF et les placements en rétention. Comment comprenez-vous l’emploi de cette notion de menace ?
Pour comprendre la période actuelle, il faut rappeler qu’il y a eu un long glissement successif du discours sur l’immigration devenu de plus en plus répressif, mais aussi de plus en plus inspiré par les thématiques de l’extrême droite, comme c’est le cas pour la « submersion migratoire ». Dans les années 60-70, la menace à l’ordre public, c’était une catégorie qui permettait d’englober des syndicalistes, des politiques, mais aussi potentiellement des criminels. C’était une manière d’expulser des individus.
Tous les étrangers en situation irrégulière sont présentés comme menaçants par leur simple présence.
Le glissement qui a eu lieu à partir des années 80-90, c’est que finalement tous les étrangers en situation irrégulière sont présentés comme menaçants par leur simple présence : menaces pour l’économie, menaces pour le système de santé, menaces pour l’identité nationale. Désormais, dans le discours politique, ce n’est plus un individu qui est menaçant, mais c’est la somme de la présence des individus, construite comme une masse et qui justifierait des expulsions en masse.
Aujourd’hui, François Bayrou veut reprendre le débat sur l’identité nationale, qu’il avait lui-même critiqué à l’époque de Nicolas Sarkozy. Ce qui est sorti finalement de ce débat, c’est qu’il est très difficile de définir une identité, mais qu’il est plus facile, au contraire, de désigner ce qui la met supposément en péril. Cela permet de pointer du doigt des étrangers, particulièrement les étrangers en situation irrégulière, qui deviennent responsables de l’impossibilité d’intégration des autres.
Ça fait aussi passer un message du côté des étrangers en situation irrégulière : « Tenez-vous bien à carreau, parce que potentiellement, la ligne qui vous sépare de ceux qui sont exclus n’est pas épaisse. » Et puis, bien sûr au-delà des étrangers, il y a toute la rhétorique autour des musulmans, de l’islam, de la compatibilité ou non de l’islam avec la République, qui probablement vont faire partie des choses qui vont revenir sur le devant de la scène à l’occasion de ce nouveau débat sur l’identité nationale.
Pour aller plus loin…

Face au fichage de « Frontières », les collaborateurs parlementaires exigent des mesures concrètes

À la Bourse du Travail à Paris, une journée pour dessiner une « sécurité sociale du logement »

La justice française refuse de livrer le militant antifasciste Gino à la Hongrie